
Jean-Pierre Laffont:–Souvenirs d’un officier


EOR à Cherchell
en attente des piqures ...
Pendant une première phase, et selon un programme approprié, l’E.O.R. perfectionnait son instruction individuelle au cours d’une série d’exercices de combat menés jusqu’à l’échelon du groupe, acquerrait ou découvrait la valeur de la discipline, le goût de l’action et de l’effort, s’initiait à l’entraînement physique militaire (parcours du combattant, combat rapproché) en un mot devenait un exécutant parfait. Des cours de Topographie, Armement, Transmissions et Génie complétaient cette formation sur le plan théorique.Chaque semaine étaient effectués de nombreux tirs aux armes individuelles ou collectives de la Section.Des exercices exigeant des efforts prolongés étaient faits de jour et de nuit dans des conditions de difficulté croissante.Cette première phase était sanctionnée par un examen éliminatoire.
Les rallyes, de chef de groupe et de chef de section, épreuves individuelles destinées à tester, outre les connaissances acquises, les qualités de résistance et de volonté, étaient redoutés par les E.O.R.Voici deux expériences de rallyes de chef de groupe vécues, la première par Jean Mourot, promo 803 (1958) et la seconde par Arnaud de Vial, promo 102(1960-61)
Rallye individuel
Nous étions partis un matin de la fin février, l’arme à la bretelle, pour notre premier “rallye" ; nous devions en connaître deux autres. C’était encore une innovation de notre colonel. Dans le passé, certains de nos prédécesseurs en avaient bien connu un, mais un seul,et en fin de stage. Pour notre compte, nous devions subir le rallye individuel du combattant, celui du chef de groupe et, pour couronner le tout, celui du chef de section qui devait fortement compter pour le classement final.
Sur un itinéraire tracé à dessein de façon à multiplier les accidents de terrain, nous devions alternativement passer de l’altitude 1 ou 2 à l’altitude 100, 150, 200, en évitant le plus possible les routes et les pistes. Des ateliers, tenus par des instructeurs galonnés, jalonnaient l’itinéraire. Nous devions y répondre à des questions le plus souvent d’ordre pratique, effectuer quelques exercices (lire une carte, mettre en œuvre un poste de radio, faire exploser un pétard de dynamite), exécuter un tir (au fusil, au P.M.), en utilisant une arme présentée entièrement démontée, se hisser en haut d’une corde, franchir les obstacles les plus divers... épreuves bien entendu notées pour enrichir notre dossier personnel. Pour ce premier rallye, nous devions décrire, à partir de l’École, le contour d’un vaste cœur sur une trentaine de kilomètres. Le circuit était chronométré et les départs donnés toutes les cinq minutes. J’avais attendu mon coéquipier à l’atelier précédent. J’avais cru, bien naïvement, à la solidarité dans l’équipe et la réciprocité des bons procédés. Je n’avais pas compté avec l’esprit de compétition qui commençait à faire ses ravages parmi nous. Je me résignai à continuer seul. Ce n’était pas pour me déplaire: n’ayant plus de responsabilités qu’à l’égard de moi seul, j’allais pouvoir adopter l’allure raisonnable qui me convenait. Je m'éloignai tranquillement de la ferme abandonnée où je venais de lancer quelques grenades...
Au Plateau Sud j’avais exécuté quelques acrobaties dans les bâtiments délabrés de la ferme Brincourt, longé des vignes à l’abandon, parcouru des champs d’artichauts quand se présenta le premier obstacle sérieux: un oued abondant, d’une dizaine de mètres de large. Pas question de traverser à pied sec: il aurait fallu monter sur un bourricot et aucun ne pointait le bout de ses oreilles dans les parages. Restait à me déchausser. Ce que je fis tranquillement. Le bas du pantalon retroussé, j’entrai avec précaution dans l’eau froide jusqu'à mi-jambe... Arrivé sur l’autre berge, je pris le temps de me faire sécher. Après quoi je me rechaussai et j’entrepris posément l’ascension d’une colline boisée en haut de laquelle une poignée d’examinateurs devaient attendre le client, d’après les coordonnées qui m’avaient été communiquées au précédent atelier. J’arrivai juste pour recevoir les premières gouttes d’un orage qui menaçait depuis quelque temps. Je n’avais encore parcouru que le tiers de l’itinéraire.De gros nuages noirs avaient envahi le ciel, bousculés par d’autres, aussi peu rassurants.
Après quelques minutes passées à l’abri, je dus me rendre à l’évidence: il n'y aurait pas d’accalmie avant longtemps. Il fallait y aller résolument et se résigner à la douche glacée... Je ne tardai pas à être complètement trempé, les vêtements traversés jusqu’à la peau. Je me réchauffais en grignotant de temps en temps des morceaux de sucre dont la provision commençait à se dissoudre au fond de mes poches. L’heure d’une collation plus substantielle me semblant arrivée, je m’arrêtai sous un arbre et j’ouvris une boîte de pâté. Des concurrents zélés me dépassaient à la hâte, avalant quelques bouchées sans s’arrêter. Une telle soumission aux règles du jeu me consternait, sans pour autant me couper l’appétit. Je mastiquai avec application le contenu de ma boîte avec un morceau de pain humide.Transformé en éponge des pieds à la tête, je n’avais plus de sec que mes pieds dans leurs rangers et un espace intime au bas du ventre. La pluie n'avait pas cessé de tomber, et le ciel était toujours aussi noir. Devant moi l’oued El Hachem non loin de son embouchure, large et froid. Je n’avais plus le courage de m’arrêter pour me déchausser. D’ailleurs, à quoi bon! Mon treillis trempé me glaçait la peau: il me fallait du mouvement. Tant pis pour ce qui était encore sec! Je choisis dans une courbe un passage apparemment praticable, l’onde limpide laissant voir le sable du fond, tout près de la surface que criblaient les gouttes de pluie, et je m’y engageai résolument. L’eau de l’oued me parut chaude, tant était glaciale celle qui tombait du ciel. J’en avais jusqu’à la cheville. Je pouvais y aller, il me resterait encore un endroit préservé entre les jambes! Je devais cependant m’attendre à ce que ce fût un peu plus profond en face, au pied de la rive concave. Les jambes de mon pantalon étant déjà bonnes à tordre, je ne risquais plus rien. Encore quelques pas et.... “Merde! ” Je m’étais brutalement affaissé jusqu’à la ceinture, basculant en avant, le canon de mon fusil s’enfonçant dans la boue du rivage. L’eau tiède avait atteint mes derniers retranchements.Un rétablissement et je me retrouvai sur la terre molle, dégoûtant et dégoûté. Je rinçai mon fusil dans l’oued après l’avoir tant bien que mal débouché à l’aide d'une brindille(3) et je me lançai à l’assaut de cette fameuse cote 181 (4) à laquelle on accédait par les non-moins fameuses “Échelles de Jacob”, un long et abrupt sentier en lacets que les trombes d’eau avaient rendu ce jour-là extrêmement glissant.Redescendu de 181, j’avais traversé l’Oued Bellah accroché par les pieds et les mains à une corde reliant les deux rives à quelques mètres au-dessus de l’eau et j’avais atteint la route nationale Alger-Ténès. Je m’étonnais de patauger dans mes rangers sans être le moins du monde incommodé: aucun échauffement, aucune ampoule, aucune écorchure, comme si l’eau se comportait en élément protecteur. Des champions de marathon me dépassaient parfois, se déhanchant frénétiquement pour gagner quelques minutes dont je me demandais ce qu’ils en feraient et disparaissaient bientôt derrière le rideau liquide qui reculait sans cesse. Je traversai Cherchell accompagné par le regard ahuri et vaguement apitoyé des habitants qui nous suivaient des yeux, bien à l’abri dans l’embrasure de leur porte.Dans le fond de mes poches, le sucre était devenu sirop et je ne pus allumer la dernière cigarette que la pluie avait épargnée, mes allumettes étant désormais impropres à leur usage habituel.À Rocher Rouge, on tirait au fusil: tir instinctif, en déplacement.On courait de cible en cible, s’immobilisant devant chacune pour lâcher une balle au jugé... Mes résultats ne furent guère brillants. Mais le canon de mon arme termina l’épreuve orné d’une étonnante enflure vers l’une de ses extrémités. En terminant le nettoyage entrepris à l’oued El Hachem, les balles avaient dilaté leur guide d’acier au passage... Il me restait à remonter vers la Tour Espagnole qui dominait de sa masse géométrique et crénelée la petite ville coincée entre ses remparts et la mer, en pataugeant dans la boue rouge et visqueuse des champs qu’il fallait traverser en évitant les chutes, particulièrement désagréables sur ce genre de terrain...Enfin, ce fut l’École, le Quartier Dubourdieu... Un dernier contrôle... Je me réjouissais à l’avance de pouvoir bientôt me déshabiller et me sécher... Eh bien non! Il fallait encore subir une ultime épreuve. Dans une salle que quelques haut-parleurs remplissaient d’un vacarme assourdissant fait de cris, de ronflements de moteurs, d’explosions, de coups de feu, il fallut répondre à un questionnaire désarmant de simplicité et bourré de tautologies ou de contradictions qu’il nous fallait confirmer ou infirmer. Exemple: “Population actuelle de l'Algérie? ” J’eus envie de répondre n’importe quoi. C’eût été faire le jeu des organisateurs.On voulait manifestement juger de notre état de fraîcheur intellectuelle à l’arrivée et de notre résistance à l’abrutissement.Je répondis au mieux et rapidement puis je rejoignis la chambre 91 que j’avais quittée neuf heures auparavant.Le Plateau Sud dérivait dans la grisaille. La pluie continuait de tomber... 3/ Plus malchanceux que moi, un camarade perdit son arme au cours de cette traversée. ll fallut sonder l’oued sur plusieurs dizaines de mètres pour la retrouver. 4 /...de l’altitude zéro à l'altitude 181.
Jean Mourot SOUS LES DRAPEAUX DE DEUX REPUBLIQUES (Extrait de A CHERCHELL avec ceux de la 803)
Les bleus au rallye
Nous nous apercevons bientôt que nous n’avons encore fait qu’effleurer de nos lèvres la coupe amère des épreuves longuement distillées par le brain-trust de l’école. Un bruit lancé par le téléphone arabe fait rapidement le tour de la compagnie : le « Rallye des chefs de groupe » doit avoir lieu très rapidement.La nouvelle est exacte et nous nous retrouvons au petit matin à la ferme tenue par les G.M.S. (Groupes Mobiles de Sécurité).Nous démarrons par l’atelier transmission. Il faut caler l’émission des différents postes, convertir des fréquences en « channel » avant de passer par l’instructeur « Arabe » où les traditionnels « tebni el mechta grib essas : tu construiras ta mechta près de la S.A.S. (Organisation chargée des Affaires Sociales) et « Ouin sebt hâdi el moukh’arla » (où as-tu trouvé le fusil ?) sont de rigueur.
L’oued Bellah est franchi à gué, l’atelier de Brincourt nous questionne sur la manière de réduire une fracture. Dans la foulée, nous abordons le « Neurkache » où nous avons à réduire une résistance ennemie en manœuvrant avec l’appui d’un fusil mitrailleur.Par les lignes de crête, nous rejoignons le pied du Tbaïent ( cote 348).Là nous vidons un chargeur de pistolet mitrailleur sur une silhouette d’homme debout. Il nous faut gagner l’atelier topo en dévalant à la course les longues pentes de l’oued el Kantara. ( Le rallye est noté sur le temps qu’il nous aura fallu pour boucler le circuit et sur la moyenne des notes obtenues aux ateliers)De l’autre coté c’est l’ascension du versant est du talweg, extrêmement raide. La fatigue habituelle s’insinue lentement dans nos équipes. Le soleil se rappelle à notre bon souvenir et les oranges font rapidement concurrence au vitascorbol et aux cachets de sel.Bientôt, c’est la marche à la boussole, chacun pour soi. Une fiche nous indique le cap à tenir.Maintenant seul, je grimpe sur la ligne de crête et de là, je prends mon angle de marche en effectuant une visée lointaine sur les mamelons dominant l’oued Rassous.Après avoir empoché ma boussole je cours à perdre haleine en zigzaguant à travers les touffes de genêts et les arbres rabougris de la montagne ; passage à gué de l’oued presque à sec. J’atterris tout près du contrôle, je récupère Givone et nous planchons ensemble à l’atelier topo- estimation des distances à la réglette.
Dans la foulée nous continuons sur Pointe Rouge où nous expédions d’un tir au Mas 49-56 une silhouette d’homme couché dans l’autre monde. C’est ensuite la marche forcée sur la route de Cherchell, nous retraversons l’oued el Kantara vers deux heures de l’après-midi et sans prendre le temps de regarder la Méditerranée, nous grimpons péniblement à Sidi-Yaya, où nous arrivons complètement hébétés de fatigue.Il faut maintenant organiser un combat de nuit, avec un groupe qui doit reconnaître un groupe de mechtas au pied de l’oued Faïfer. J’en profite pour ouvrir mon sachet de ravitaillement et je mange en marche, comme les tirailleurs tout en me dirigeant vers la ferme Tripier où m’attend l’atelier « explosifs ».J’ai un tronc d’arbre à faire sauter !C’est encore au pas de course que nous gagnons la cote 211 et face à la mer, nous repérons sur notre carte des points remarquables que nous signale un dessin panoramique.L’oued Bellah, en contrebas, est franchi sur un énorme tuyau d’irrigation de 3 mètres de diamètre et c’est le lancer de grenades, avant d’effectuer de périlleux rétablissements dans les poutres d’une gare démolie.Je pars en courant vers le dernier atelier, situé à plus de 35 km du départ. Mais je suis trahi par une crampe ; Martinez de Hoz me double et je ne réussis à le rejoindre qu’au « bordj Ghobrini », devant la « salade d’armes » mélange de pièces de toutes les armes d’instruction disponibles : fusils, pistolets-mitrailleurs, F.M…. qu’il faut bien sûr trier et réassembler le plus rapidement possible.Il ne me reste qu’à rejoindre notre ligne d’arrivée, et à me faire pointer au contrôle, avant de m’écrouler dans l’herbe haute, avec quelques camarades.Nous rentrons à Brincourt hagards, mais nous sommes heureux d’avoir réussi sans craquer cette épreuve qui fait de nous de jeunes anciens (les bleus au rallye !) Arnaud de Vial «CEUX de CHERCHELL»2° édition, 2009,EDITIONS FONSCOUVERTE
http://escoub5.free.fr/divers/EOR.htm
"La guerre a fait de moi un homme"
Entretien de Jean-Pierre Chevènement à la revue Charles, propos recueillis par Loris Boichot, octobre 2017.
Jean-Pierre Chevènement: Devenir Président de la République à trente-neuf ans, c’est une expérience qui vaut mieux que l’expérience de la guerre. La guerre change profondément les hommes. En bien ou en mal. Quelquefois les deux.
Et vous, comment vous a-t-elle changé ?
Oh, elle a fait de moi un homme. Je n’étais pas un homme quand je suis parti en Algérie. J’étaisun grand adolescent à peine sorti de la belle bibliothèque de Sciences Po. L’essentiel de mon temps, je l’avais consacré à la rédaction d’un mémoire sur « La droite nationaliste française et l’Allemagne de 1870 à 1960 ». C’était pour moi, petit provincial sociologiquement « de gauche » un moyen de connaître la droite et ses différentes familles de pensée. Mais je n’avais que 21 ans. Quand je suis rentré deux ans et demi plus tard d’Algérie, j’avais été façonné par une expérience qui m’avait mis au cœur d’évènements où j’avais vu des gens tués près de moi et une société basculer. J’avais vu le massacre de Saint-Denis-du-Sig (un massacre de harkis le 19 mars 1962 suivi d’une « reprise en mains » sanglante, NDLR). Pendant l’insurrection de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), j’avais vu des femmes de ménage algériennes assassinées dans la rue, le port d’Oran bombardé puis incendié. J’avais vu des officiers français assassinés par l’OAS : le général Ginestet et le colonel Randon. J’avais vu beaucoup de choses de très près… Quand on a fait la guerre, on est moins manichéen et en même temps on acquiert un certain sens de l’Histoire. On relativise et en même temps on anticipe mieux les choses … C’est ce que j’ai voulu faire à mon retour d’Algérie en 1963 en préparant « l’après de Gaulle », tout en essayant de conserver de son héritage ce qui méritait de l’être...
Oui, j’ai gardé le souvenir de l’occupation du premier étage de la maison-école où nous habitions ma mère et moi, dans un petit village du Haut-Doubs, Le Luhier. Cela devait être au début de 1943. Les soldats allemands s’étaient installés au premier étage. Ma mère m’interdisait d’y monter, au prétexte que les bonbons que les soldats allemands me donneraient serait empoisonnés, selon l’habitude qu’ils avaient déjà, selon elle, dans les régions occupées pendant la Première Guerre mondiale. Mais j’ai enfreint la consigne maternelle et je mangeais les oranges que m’offraient les soldats allemands, constatant ainsi à l’âge de quatre ans qu’ils ne méritaient pas tout à fait leur réputation ...
De cette période de guerre, gardez-vous d’autres souvenirs d’enfant ?
Bien sûr. Les trois maisons de ma grand-mère incendiées à Frambouhans, petit village voisin du Luhier, le 18 juin 1940. Des soldats français ont eu l’idée de résister aux envahisseurs au lendemain du discours de Pétain. Ils ont tué des motocyclistes allemands. Les chars qui n’arrivaient pas très loin derrière, ont détruit les sept ou huit maisons à l’entrée du village. Alors on a reconstruit après la guerre, parce que c’était l’hôtel-restaurant de ma grand-mère. J’ajoute que mon père était prisonnier dans un stalag. Il travaillait dans une carrière, et pour des raisons médicales – il avait fait un début de tuberculose –, on l’avait envoyé dans une ferme où il a passé le reste de la guerre, aux travaux des champs. Institutrice, ma mère a donc passé toute cette période dans le village du Luhier, dans l’attente de la libération ou de l’évasion de mon père. Je ne dirais pas qu’elle était résistante active, mais enfin elle faisait des tracts avec la postière contre les « Boches » et Vichy, et la Gestapo de Montbéliard l’y avait convoquée. On m’avait mis pendant ce temps chez une voisine, Mme Journot. Je revois donc la séparation d’avec ma mère. On ne savait pas si elle allait revenir. Et elle est revenue. Et mon père aussi, en avril 1945.
Vous souvenez-vous de la Libération, cette année-là ?
J’ai le souvenir des bals de la Libération. Un bal à Bonnétage. Je revois ma mère avec un turban - c’était la mode de l’époque, lancée par les « tabors » marocains. Elle chantait. Elle avait une très jolie voix. Ma prime enfance a donc été marquée par cette période de la guerre. On sentait l’occupant, on vivait la chute de la France et sa libération. Ca ne s’oublie pas …
Après vos études à Sciences Po, vous sortez en 1961 d’une école militaire, en Algérie, comme jeune officier de réserve. Vous êtes à l’aube de votre service militaire…
Je suis sorti de Cherchell, l’école où l’on formait les sous-lieutenants du contingent qui encadraient la masse des appelés. Je suis sorti de l’école dans un assez bon rang parmi les 400 élèves officiers de ma promotion pour pouvoir choisir ce qui me plaisait : je me suis orienté vers les sections administratives spécialisées (SAS). Aussi appelées « Affaires algériennes », elles sont les lointaines descendantes des « bureaux arabes » de l’Armée d’Afrique. Il s’agit d’un travail de proximité au contact des « populations musulmanes », comme on disait à l’époque. J’ai été affecté à Saint-Denis-du-Sig, et après la dissolution des SAS, à la fin du mois de mars 1962, j’ai été volontaire pour servir de chef de cabinet adjoint chargé des affaires militaires à la préfecture d’Oran. Sous-lieutenant, j’étais affecté au 21ème régiment d’infanterie, et par ordre du général Ginestet, mis à la disposition du préfet régional.
Vous avez répondu à l’appel, alors que vous aviez auparavant milité à l’UNEF en faveur de l’indépendance ?
Oui, j’étais tout à fait conscient que l’Algérie allait devenir indépendante, mais je ne voulais pas déserter. Comme le disait le général de Gaulle, si l’Algérie devait devenir indépendante, il valait mieux que ce soit avec la France que contre elle. Je n’étais pas du tout antigaulliste, au contraire. Je considérais que De Gaulle avait raison, que lui seul pouvait trancher le nœud gordien qu’était l’indépendance de l’Algérie dans l’intérêt de la France. Je me suis donc déterminé en patriote, mais en patriote éclairé, pas en patriote borné. Parce qu’il y avait aussi des patriotes, certainement, parmi les gens de l’OAS. Je ne le nie pas. Mais c’étaient vraiment, en dehors des pieds-noirs que je pouvais comprendre, des sacrés connards. Je leur en voulais de leur myopie et de leur violence à l’égard des populations algériennes. Le bombardement de la ville musulmane qu’on appelait aimablement « le village nègre » d’Oran, ou bien encore l’assassinat des dockers sur le port, tous ces meurtres gratuits avaient pour but de créer la guerre civile. La folie de l’OAS n’a malheureusement que trop bien réussi …
Comment avez-vous traversé cette période ?
Je suis arrivé à Alger dans un contexte très dur, au lendemain du putsch des généraux (le 21 avril 1961, NDLR). La présence des appelés en Algérie a d’ailleurs été décisive dans l’échec du putsch. En fait, mon véritable engagement a été le choix que j’ai fait d’aller à Oran dans une période difficile. Dans la préfecture d’Oran, nous étions attaqués presque tous les jours par les gens de l’OAS. Mais comme la préfecture était un immeuble très haut - nous étions au 17ème étage -, les tirs étaient obliques, et à condition de ne pas se mettre trop près de la fenêtre, nous avions de bonnes chances d’en réchapper,
Vous avez vous-même été attaqué ?
Ah oui, j’ai le souvenir d’attaques à la 12.7 (une mitrailleuse lourde, NDLR) et même au bazooka. Les gens de l’OAS étaient souvent liés aux policiers pieds-noirs, qui occupaient les étages inférieurs du bâtiment de la préfecture. Ils savaient que l’état-major de la préfecture était composé de fonctionnaires ou de militaires qui entendaient maintenir une structure administrative aux ordres du gouvernement. Ils voulaient donc nous rendre la vie un peu difficile. Ils ont ainsi fait sauter mon bureau. En mon absence, je le précise.
Dans Le Courage de décider, publié en 2002, vous écrivez avoir « bien failli disparaître dans la tourmente » du massacre d’Oran, le 5 juillet 1962, trois mois et demi après le cessez-le-feu. Que s’est-il passé ?
En effet. J'ai failli me faire descendre alors que je sortais du port d’Oran. J’avais fait embarquer une tapisserie pour le compte du préfet - une mission assez prosaïque. Et, descendant du bateau, me retrouvant sur le quai, j’ai été pris dans les remous de la foule. Il y avait eu un coup de feu à l’origine inconnue, qui avait marqué le début d’incidents. Un certain nombre d’Européens ont été raflés. Moi-même je me suis retrouvé avec un pistolet mitrailleur sur l’abdomen, culasse en arrière, tenu par un ATO (auxiliaire temporaire occasionnel, NDLR) inexpérimenté, recruté à la va-vite, membre d’une police qui dépendait de l’Exécutif provisoire d’Abderrahmane Farès mis en place pour assurer la transition entre l’administration française et la future administration algérienne. J’ai vu tout de suite le péril mortel que je courais, car il suffisait d’une petite secousse pour faire partir la culasse en avant. Heureusement, il y a eu un incident, un cri, de l’autre côté de la rue. Ce jeune ATO a tourné sa mitraillette dans l’autre direction. J’en ai profité pour prendre le large. Ma voiture était garée à cent mètres. Croyez-moi, j’ai fait un sprint rapide. C’était le chaos. Il n’y avait plus d’autorité, ni française puisque l’Algérie était devenue indépendante le matin même, ni algérienne car il y avait une querelle de légitimité entre le gouvernement provisoire de Benkhedda à Alger et le « groupe d’Oudjda », c’est-à-dire Ben Bella et Boumédiène.
Vous ne parlez pas de massacre, vous parlez du « chaos du 5 juillet 1962 » ? Vous aviez pourtant annoncé 807 morts…
Non, j'ai dit que le consulat avait enregistré plus de 800 disparus déclarés. Mais il est apparu que certaines de ces personnes avaient réussi à embarquer. D’autres sont passées en Espagne. Je ne connais pas le nombre exact de disparus. Personne ne le connaît d’ailleurs. C’est un évènement qui ne peut se comprendre que par le désordre résultant de la complète vacance de toute légalité. Il faut le dire par souci de la vérité historique. Il n’est pas imputable à une consigne qui aurait été donnée par une autorité politique quelle qu’elle soit. Il y a eu certainement un massacre. Je ne l’ai pas vu, je n’ai pas vu de gens à terre mais j’ai vu le désordre. J’ai été pris au cœur de ce désordre. J’ai ensuite accompagné le nouveau Consul général pour rencontrer Ben Bella et Boumédiène qui commandait l’armée des frontières, à Tlemcen – cela devait être le 10 juillet 1962 – afin d’obtenir la libération des personnes enlevées – une petite vingtaine. J’étais le premier Français à rencontrer Ben Bella après l’indépendance, avec le consul général M. Herly bien entendu. J’ai vécu des choses que l’on n’a pas l’habitude de vivre à 23 ans. Et parce qu’un de mes amis m’appelait « colonel », les Algériens croyaient que j’avais réellement ce grade : ils m’appelaient « Mon colonel »...


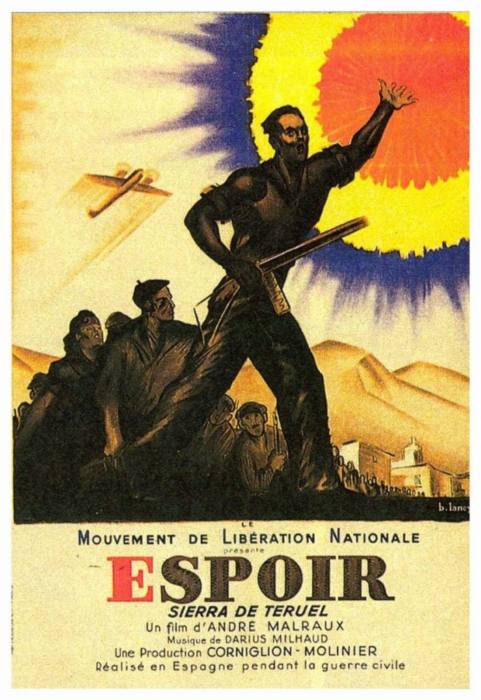
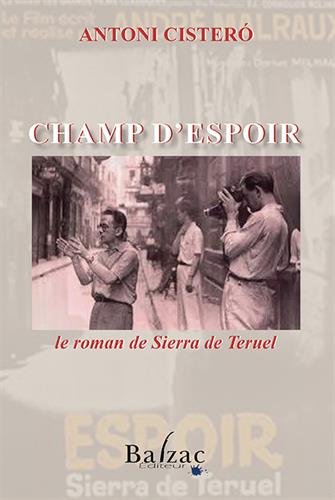









Les commentaires récents