
Nous sommes tous partis d’Algérie un jour maussade du printemps 1962 pour un voyage sans retour. Mais outre la valise en carton ou la cantine militaire, nous avons tous emporté avec nous des images de bonheur et aussi et surtout, sans trop le savoir la plupart du temps, une réserve inépuisable d’odeurs mémorisées.Qui a pu oublier en effet cette exquise senteur du maquis des collines algéroises ?Ces cistes et ces myrtes, qui s’associant au lentisque faisaient de nos cueillettes de cyclamens des harmonies olfactives délicates et enivrantes. Toutes ces notes agrestes mélangées enchantaient les narines et quand, au détour d’un bosquet, l’humus du sol, d’où, bientôt, surgirait le « sanguin » bien tendre, ajoutait sa petite note terreuse et phénolique, la fragrance sylvestre était alors complète et faisait que, tout à coup, nous n’avions plus envie que la journée se termine. Nous rentrions pourtant un peu honteux toutefois d’avoir cueilli le cyclamen. J’ai, en effet, toujours eu ce sentiment de culpabilité, quand j’ôte la vie d’une fleur sauvage et particulièrement de celle-ci. Cette gentille corolle, qui fait littéralement une acrobatie en courbant son échine pour mieux remonter ses pétales vers le haut, n’est jamais aussi gracile que bien plantée sur son bulbe, à l’abri de son humidité nourricière. Et le spectacle affligeant d’un bouquet tuméfié, qu’on plaçait dans un vase, quand cela n’était pas malheureusement dans un verre à moutarde, me navrait d’autant que j’étais encore sous le charme du cyclamen fièrement dressé, parmi ses belles petites feuilles aux harmonies de verts différents, bien à l’ombre de ses lentisque et myrte protecteurs. La seule circonstance atténuante, que j’accordais alors au bouquet de cyclamens, était sa concentration en odeurs, alors addition de celles de 30 à 40 fleurs, et sa si subtile couleur violine. On dit d’ailleurs souvent cyclamen, le nom devenant adjectif, pour définir ce type de coloration. Nous rentrions le soir toujours très fatigués, mais en même temps très odorants. Il était facile en effet de constater l’énorme supériorité olfactive du lentisque, qui imprégnait nos vêtements et épidermes. Comme nous, les bambins ou adolescents, finissions toujours par une guérilla de sarbacanes, dont la munition était la baie rouge de lentisque, nos bouches étaient noircies par la gomme, exsudée par les baies, et nos vêtements, que les rameaux fouettaient lors de nos courses, ramenaient la note très verte jusque dans la penderie familiale. Cette invasion odorante n’était pas très appréciée par nos ménagères de mères, qui ne faisaient pas forcément partie des promeneurs. La réprimande était alors à la mesure de la « pollution » olfactive, mais elle n’empêchait pas la longue nuit réparatrice et les beaux rêves engendrés par de telles journées.
La mer non plus n’était pas avare d’odeurs exquises. Celle, exhalée par ma petite plage de galets humides, toujours à l’ombre de mon boulevard Pitolet natal, était d’une subtilité si fine qu’elle m’a poursuivi toute ma vie. Elle était due pour l’essentiel à la présence de posidonies mortes éparses sur les galets et à de minuscules carcasses de petits crustacés. Elle était tout à la fois très iodée, musquée et légèrement phénolique, mais certains jours, ou plutôt à certaines heures, très puissante. Je l’ai « retrouvée » souvent à un virage très particulier de l’usine de parfumerie naturelle, où j’ai effectué toute une carrière professionnelle. Elle me surprenait à proximité du stockage des infusions de musc, d’ambrette, de vanille ou de castoréum. C’était alors un choc olfactif violent, qui me transportait instantanément sur mes galets humides, à l’ombre du boulevard, à plus de 800 kilomètres de mon lieu de vie du moment.
Sur cette même plage un certain matin d’été des camarades, plus âgés que moi à l’époque, avaient pêché une somptueuse « bouillabaisse ». Ils avaient alors déposé leur panier d’osier rempli de girelles, vidroits et racaos sur les galets humides de la plage. Tous ces poissons multicolores offraient ainsi le spectacle d’une palette de couleurs extraordinairement diversifiée. Mais surtout cette belle pêche était agrémentée d’une odeur marine très fine, apanage de poissons bien frais, « sortant de l’eau ». J’ai, bien sûr, toujours gardé en mémoire olfactive cette note particulière. Et je me surprends souvent, encore aujourd’hui, à mettre le nez sur du poisson frais exposé à l’étal d’une poissonnerie de manière à retrouver le charme olfactif ressenti ce jour-là. Je m’agace d’ailleurs très vite quand j’entends la phrase, sempiternelle, prononcée par des gens pour moi ignares, « qui n’aiment pas le poisson », parce que disent-ils : Cela sent mauvais. Non, le poisson frais ne sent pas mauvais, il sent au contraire délicieusement bon, quelle que soit l’espèce exposée. Mais je reconnais que, dans la grande majorité des cas, les étals de poissonnerie de France, peuplés de poissons à la fraîcheur plus que douteuse, sont souvent nauséabonds et ce à ma grande consternation.
Nous pouvons continuer à explorer les notes marines en imaginant un panier d’oursins bien rempli. Ils exhalent alors, bien que vivants, en faisant gesticuler leurs innombrables piquants, une superbe odeur très particulière, très iodée et reconnaissable, entre toutes, les yeux fermés. Là encore la palette colorée est somptueuse et s’enrichit, après l’ouverture des crustacés, du corail orangé, rouge carmin ou jaunâtre des « tranches », que nos petites cuillers ou nos morceaux de pain vont mettre à mal. Il y a en plus le goût, qui intervient lors de la dégustation en même temps que l’odeur, qui elle varie encore par rapport au panier d’échinodermes vivants et entiers. Cela ressemble à un feu d’artifice de nuances odorantes, qui envahit mais très délicieusement nos narines… et comble nos papilles. Quand on se souvient que les oursins, en Algérie du moins, étaient souvent présentés sur un lit d’algues particulières, on devine une autre petite harmonie olfactive due à celle-ci. Il s’agissait de Cystoseires (Cystoseira stricta), qui présentent une forme en grappe de raisins et une très belle couleur jaune vert. Mettez votre nez dans une grappe de cette algue fraîchement cueillie et appréciez la note, vous ne serez pas très loin du fameux septième ciel.
Pour rester dans les algues, ma mémoire olfactive est toujours sous le charme d’une marée basse dans le petit paradis marin que représente pour moi l’île de Jersey. Nous venions d’arriver à Saint-Hélier et après avoir loué un véhicule, nous avons commencé une exploration méthodique de l’île. En direction de l’est de la capitale, nous avons suivi la route du bord de mer et sommes arrivés vers onze heures du matin sur un petit port de pêche à marée basse. Dès la sortie de l’automobile, nous fûmes littéralement transportés par une puissante note marine, iodée, voire musquée, qui était un pur enchantement. Je suis resté une bonne demi-heure à renifler ce paradis des sens, faisant le tour des quais. J’eus le plus grand mal à grimper dans la Renault 5 neuve, que nous avions louée et dont, en d’autres temps et lieux, j’aurais peut-être apprécié les odeurs de plastiques et skaïs neufs. Mais vraiment ce ne fut pas le cas ce matin-là.
D’autres fragrances viennent enrichir mes souvenirs d’enfant ou d’adolescent ! Je me souviens toujours des ragoûts de ma grand-mère maternelle, qui mijotaient doucement dans la cocotte familiale. Ils montaient de ce récipient une symphonie d’odeurs, dues pour l’essentiel à la feuille de l’arbuste roi, qui porte le joli nom de Laurier Noble. Je salue l’adjectif, il est rarement aussi bien porté que par Laurus nobilis. Froissez donc gentiment une feuille de laurier à peine cueillie de la branche et humez-en les débris. Vous êtes alors très proche de l’extase et pouvez apprécier une des notes naturelles les plus accomplies, qui soit. J’ai longuement appris à mes enfants, quand ils étaient en bas âge, à sentir systématiquement les différentes merveilles olfactives que sont le laurier, le thym, le romarin, la marjolaine, la sarriette, la lavande, le ciste, la myrte, les menthes poivrée, pouliot ou crépue, qui font des collines azuréennes des champs d’expériences olfactives enchanteresses. Mais la reine des odeurs en ce domaine très particulier de la Provence me paraît être sans conteste le Chèvrefeuille sauvage (Lonicera caprifolium). Il pousse en liberté dans les Alpilles et les contreforts des Alpes. La fleur, plus petite que celle du cultivé, exhale une odeur lourde, jasminée, aux relents de vanille très subtils. C’est celle d’un parfum quasiment complet, qui est due à dame nature et seulement à elle. Si vous passez près d’un bosquet de chèvrefeuille, ne ratez surtout pas l’occasion d’approcher le paradis.
Nous pouvons maintenant faire un tour du côté des animaux terrestres. J’ai en effet la plus grande nostalgie des odeurs de ferme. Dans la propriété Nocchi aux Deux-Moulins, il y avait une ferme merveilleuse pour mes yeux et mes sens de gosse, qui s’éveillait à la vie. L’enclos enfermait quasiment tous les animaux de basse-cour et il jouxtait un autre réduit où gambadaient des porcs d’un rose fascinant. Nous restions des heures, les yeux écarquillés, à scruter le coq dominateur, les poules craintives, les pintades caquetantes, les canards assourdissants ou les fières oies, qui ne gardaient pas le Capitole. Et de cette foule bigarrée s’élevait une délicieuse odeur de fientes. C’était subtil, animal et très puissant mais agréable à humer. Cette odeur est très ronde, comme disent les spécialistes, et depuis j’ai dans le nez les odeurs très agréables pour moi de fiente de basse-cour, de crottin de cheval ou d’âne, de migon de moutons ou même de bouses de vache. Seule la chèvre, pourtant très odorante par elle-même, ne nous offre dans sa célèbre crotte ronde que peu de rêves odorants. Le crottin frais présente sûrement la note la plus attractive et la plus fine. Dans tous ces cas d’olfaction, je vous demande de vous référer, comme pour le poisson, à des émissions très fraîches. Encore que pour le migon et le crottin, la longévité apporte, peut-être, des nuances olfactives, pleines de charme.
Aussi professionnellement, quand j’ai eu toute liberté, j’ai pu faire des extractions expérimentales d’odeurs fécales très intéressantes. Malheureusement aujourd’hui en parfumerie naturelle, les problèmes de vache folle et de trembleuse de mouton ont réduit à néant le devenir d’odeurs animales. Ils ont même mis fin au règne sans partage des ténors établis, qu’étaient le musc du bouquetin porte-musc, le castoréum des poches de castor, la crème de civette et l’ambre gris, curieuse concrétion stomacale du cachalot. Les produits parfumant dérivés de ces ex-têtes d’affiche du parfum animal, aux vertus aphrodisiaques avérées, ne sont malheureusement plus autorisés en parfumerie fine. Pour moi cela ressemble à un désastre !
Mais quelque part dans mon subconscient, quelques neurones spécialisés me gardent intact le souvenir de ces enchantements olfactifs animaux, qui ont bercé mes vertes années et mes débuts professionnels.
Nous allons nous quitter sur un rappel indispensable pour le professionnel des odeurs naturelles que je suis. Je ne vous ai parlé que de notes, qui vous sont directement accessibles dans votre vie de tous les jours. Mais sachez que vous n’avez malheureusement pas accès facilement à la grande noblesse olfactive que sont les absolues florales.
Les absolues sont dérivées des concrètes florales, obtenues par des extractions au moyen de solvants volatils. Le solvant, une fois évaporé par des moyens sophistiqués, laisse une pâte onctueuse très parfumée, qui porte le nom de concrète. Cette concrète, elle-même traitée par l’alcool éthylique, est rendue soluble dans ce solvant et prend alors le nom d’absolue. Celle-ci est liquide et très colorée et dégage une très puissante odeur, très concentrée du végétal traité. L’absolue jasmin est bien sûr la reine incontestée de ce métier mystérieux qu’est la parfumerie de luxe. Mais ses rivales que sont les absolues de rose, de lavande, de lichens, de ciste ou de feuilles de violette, voire de cassie ou de chèvrefeuilles lui tiennent la dragée haute et en étonneraient plus d’un d’entre vous, si je pouvais vous les faire découvrir. J’ai eu cette chance pendant trente-cinq ans de montrer la palette extraordinaire des odeurs naturelles à des visiteurs d’usine de parfumerie, qui repartaient littéralement enivrés, fascinés et ensorcelés par la richesse et la complexité des trésors olfactifs présentés.
Olfactivement vôtre.
Marc STAGLIANO
http://www.enpa-capmatifou.com/Enpa3/VARIETEDELA-BAS/STAGLIANO/Souvenirs%20olfactifs.html
.

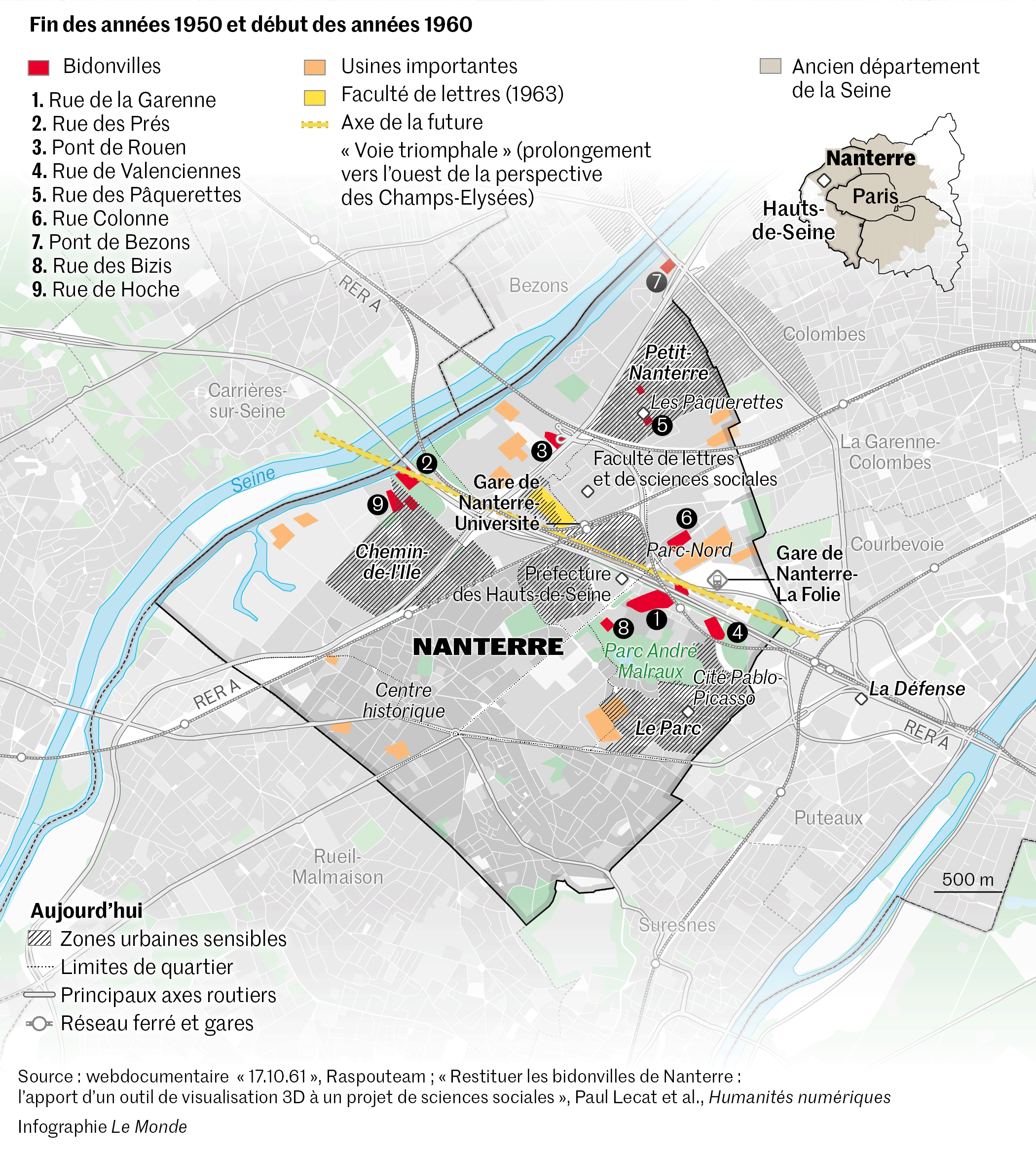



Les commentaires récents