Il y a quelques temps, le cinéaste suisse Richard Dindo avait caressé le projet de réaliser un documentaire sur l’enfance de l’écrivain pied-noir d’expression française Albert Camus. Dans ce récit de vie, quelques entretiens avec des intellectuels algériens donnaient lieu à un rappel des rapports tendus que le prix Nobel de 1957 a entretenus avec la question du colonialisme en Algérie.
Après avoir contacté la famille Camus pour acquérir les droits sur les textes du romancier, le cinéaste s’est rapidement heurté à un mur infranchissable une fois la problématique abordée. Alors que le 50ème anniversaire de la tragique disparition de Camus à récemment été commémoré, ce refus illustre bien l’importance d’une controverse qui a lourdement pesé sur la carrière et l’héritage laissé par l’écrivain.
J’ai grandi dans la mer et la pauvreté m’a été fastueuse, puis j’ai perdu la mer, tous les luxes m’ont alors paru gris, la misère intolérable [1]
Camus c’est avant tout la célébration des cinq sens, la communion avec la nature, les plaisirs de la vie. La mer, les femmes, le football, les marques de sa jeunesse à Alger. Né en 1913 d’une femme de ménage majorquine et d’un caviste français, le destin du jeune Albert est rapidement marqué par la mort de son père, le mutisme pathologique ainsi que l’analphabétisme de sa mère. Un rapport au langage fait d’amour et de rejet, le poids d’une enfance passée dans le quartier populaire de Belcourt, loin de la culture et des livres de la jeunesse sartrienne. C’est la relation avec sa mère qui cristalise toute la complexité et la richesse du personnage. Amour absolu, gratitude et culpabilité : « O mère pardonne à ton fils d’avoir fui la nuit de ta vérité ». C’est d’ailleurs par ces mots que Camus dédie son dernier roman à sa mère, l’inachevé Premier Homme: « A toi qui ne pourras jamais lire ce livre ». Car être un pied-noir dans un milieu défavorisé de l’Algérie coloniale, cela laisse des cicatrices, un éternel sentiment de vulnérabilité: « Ma mère qui est la plus grande cause que je connaisse au monde ».
Le futur écrivain apprend à grandir avec sa condition, célèbre le « grand libertinage de la nature et de la mer », l’odeur des absinthes, la beauté du corps qui encore « tout parfumé des essences de la terre » plonge dans une « mer cuirassée d’argent » pour s’y rafraichir. Grâce à son instituteur, Camus accède à des études auxquelles il ne semblait pas prédestiné. A présent il écrit, s’insurge, multiplie les reportages dont une série d’articles sur la « misère en Kabylie ». Il dénonce l’administration coloniale, le dénuement, la famine et l’iniquité. Le jeune journaliste rend la France responsable de la situation en Kabylie, affirme le besoin de «rendre toute justice au peuple arabe d’Algérie et de le libérer du système colonial ». Pourtant, il ne fait pas mention des rapports que les Arabes entretiennent avec les Français, il ne remet pas en cause le système, la présence française. Camus croit toujours en une Nation commune, un équilibre improbable. Pourtant, la « grande entreprise » française n’aura de cesse de s’atteler à sa « mission supérieure » d’assimilation: concrètement, la saisie des terres et l’expulsion des Algériens ainsi que la cession de ses biens aux colons venus de la métropole. Aux discours de « l’exception culturelle » française s’est ajouté le récit d’une terre vide, improductive avant l’arrivée des occidentaux et l’accomplissement de leur grande mission « civilisatrice »[2].
La tyrannie totalitaire ne s’édifie pas sur les vertus des totalitaires. Elle s’édifie sur les fautes des libéraux. [3]
Albert Camus s’est exprimé sur toutes les grandes problématiques de son temps, il a participé au mouvement de résistance contre les nazis, dénoncé la pauvreté et l’injustice sociale, le pacte du silence suite à l’avènement de Franco. Il a également été l’un des premiers à condamner les crimes du stalinisme ainsi que toutes les dérives totalitaires. Le prix Nobel de 1957 est celui de la fermeté morale, de l’humanisme libre (cf. Le mythe de Sisyphe), il a pris la valeur absolue d’un idéal. C’est pour toutes ces raisons que beaucoup auront du mal à pardonner les faiblesses, les limitations d’un Camus par trop marqué par son passé sur cette terre qu’il chérit. Pour Edward Saïd, l’écrivain « représente l’impuissance tragique de la conscience française face à la crise de l’Europe, à l’approche d’une de ses grandes fractures ». L’auteur de La Peste s’oppose publiquement et violemment à toute revendication nationaliste. « L’indépendance nationale est une forme purement passionnelle. Il n’y a jamais eu encore de nation algérienne […], les Arabes ne forment pas à eux seuls toute l’Algérie. […] une Algérie purement arabe ne pourrait accéder à l’indépendance économique […] ».
D’un point de vue plus littéraire, les romans de Camus se déroulent la plupart du temps dans un cadre géographique algérien. Pourtant, la structure narrative s’entête à exclure systématiquement tous les Arabes. Si l’on se réfère uniquement à deux de ses romans les plus célèbres L’Etranger et La Peste, la constante de la non-présence d’un peuple -qui est pourtant majoritaire- est particulièrement significative. C’est bien un indigène que tue Meursault mais un indigène sans nom, sans famille; figurant, sans aucune « densité » narrative. De même, les Arabes qui meurent à Oran dans La Peste, ne sont pas nommés non plus. Tous ces personnages affichent une « impassibilité muette »[4] dans l’œuvre de Camus, un droit à la parole confisqué, la déshumanisation de tout un peuple. D’autre part, le choix des lieux et des personnages revêt également son importance. Le recueil de nouvelles l’Exil et le Royaume met en scène dans la plupart des cas des exilés ayant un contact supérieur, fusionnel avec une terre non-européenne. Une terre maternelle, une terre possédée. L’adultère narre « l’aventure » d’une femme française qui, lors d’un moment de communion avec la terre algérienne, découvre « le centre obscur de son être », son identité de pied-noir. Ainsi, pour O’Brien, les romans de Camus constituent une « justification furtive ou inconsciente de la domination française »[5]. De nouveau, dans La Peste, les morts que le docteur Rieux et Tarrou tentent vainement de sauver sont indigènes. Les institutions françaises dans le chaos Algérien, la représentation des problèmes de conscience français. Au sujet de Camus, O’Brien a écrit : « Il est probable qu’aucun auteur européen de son temps n’a si profondément marqué l’imaginaire et aussi la conscience morale et politique de sa propre génération […]. Aucun autre écrivain, pas même Conrad, n’est plus représentatif de l’attention et de la conscience occidentale à l’égard du monde non occidental ». Ainsi, ses écrits contribuent au façonnement, à la représentation d’une certaine Algérie –terre aride et déserte avant l’arrivée des Occidentaux-, au développement de toute une série de « structures d’attitudes et de références » dont le résultat, inconscient ou pas, n’est autre que de s’immiscer dans la culture et l’imaginaire collectif et de favoriser la mise en place d’un système colonial.
Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice [6]
Jusqu’au bout Camus aura crut en une « communauté de destin », refusé l’idée de fractures et de « fossés artificiels ». Pour lui, le déracinement d’un million et demi de Français « installés depuis plusieurs générations et passionnément attachés à leur pays » ne peut constituer une alternative soutenable. Jusqu’au bout, il condamne le terrorisme de manière absolue, répudie l’idée de responsabilité collective appelant à la raison, côté arabe, à la justice, côté français. Il prétend stopper l’engrenage terreur-répression en redonnant aux indigènes des raisons de croire en un avenir meilleur, une égalité juridique[7]. Les rêves camusiens d’une grande communauté sur le sol algérien traduisent la volonté d’approfondissement et de concrétisation du processus d’assimilation et son refus de considérer la simple présence coloniale française comme liberticide et humiliante. Finalement, Camus refusera jusqu’à sa mort de concéder une quelconque autonomie au peuple algérien, d’admettre qu’une présence française -si bienveillante fut-elle- est désormais incompatible avec la dignité.
Dans tous les romans camusiens, l’évocation du concept des deux nations, de la fracture, qui agite l’Algérie est soigneusement évitée. Pourtant, Camus vit avec la résistance algérienne depuis 1954. Il est impossible que ces enjeux n’aient pas été présents à son esprit lorsqu’il écrivait. Au contraire, tous ces récits contribuent à l’institutionnalisation d’une présence étrangère, une communauté qui se dit, qui se raconte. Les cérémonies de noces avec le territoire (Meursault, Tarrou, Rieux, Janine…) sont à analyser à la lumière de la commémoration de la survie d’une collectivité: des pieds-noirs sans perspectives, sans nul part d’autre où aller[8]… Il est significatif que la famille de Camus soit restée en Algérie après son installation en France. En quelque sorte, son engagement contre le FLN représentait pour lui une question de vie ou de mort alors qu’un attentat aveugle menaçait à tout moment la sécurité de sa mère. Comme l’écrira Sartre, l’éternellement jeune Albert n’est autre qu’un « homme en marche », avec tous ses défauts et ses qualités. Malgré une brouille qui n’est « autre qu’une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue, il réaffirme l’indispensabilité de la pensée de Camus, avec ou contre lui[9]. Puisque l’indépendance de l’Algérie aurait supposé l’exode de milliers d’innocents, l’éviction des siens… Un Camus qui, comme le dira Bernard-Henri Lévy, « fais le deuil de cette justice en soi, de cette transcendance des valeurs, […] de cet universalisme qu’il a passé sa vie à essayer de fonder »[10] mais finalement un intellectuel qui renonce au « sûr chemin de la morale » par amour pour les siens, parce qu’il ne peut supporter la souffrance, parce que ce qu’il aime le plus profondément ce sont ses semblables. Contre les raisons de l’Histoire, il demeure inconcevable d’avoir raison contre Camus et contre son histoire.
.
[1] Camus, Albert, La mer au plus près, journal de bord, 1953, Editions Gallimard.[2] Culture et impérialisme, Editions Fayard, Paris: 2000.
[3] Camus, Albert, Pourquoi l’Espagne? dans Combat, 25 novembre 1945, Actuelles. Chroniques 1944-1948, Editions Gallimard.
[4] Saïd, Edward W., Culture et impérialisme, Editions Fayard, Paris: 2000.
[5] Saïd, Edward W., Culture et impérialisme, Editions Fayard, Paris: 2000.
[6] Camus, Albert, réponse à un étudiant algérien lors de la conférence de presse préalable à la remise du Prix Nobel de littérature, Stockholm, 24 octobre 1957.
[7] Camus, Albert, Terrorisme et Répression dans L’Express, 9 juillet 1955.
[8] Saïd, Edward W., Culture et impérialisme, Editions Fayard, Paris: 2000.
[9] Sartre, Jean-Paul, Un homme en marche dans France Observateur, 7 janvier 1960.
[10] Lévy, Berard-Henri, Portrait: Un philosophe artiste dans Hors-Série Le Monde, 6 janvier 2010.
.
Auteur Adria Budry Carbo



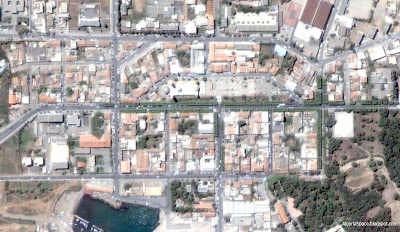

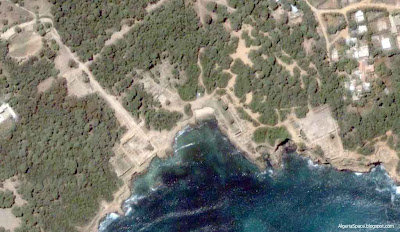


Les commentaires récents