
Pertinente, opportune, stimulante: telle est bien cette idée de redécouvrir l’actualité de Camus et de la souligner. Actualité qui explose avec la publication simultanée de trois livres dont on voudrait que l’un ne nuise pas aux deux autres tant leurs thèmes sont imbriqués ou complémentaires. Le dernier volume des «Cahiers Albert Camus» (1) contient tous les éditoriaux et articles écrits pour «Combat» de 1944 à 1947. Une édition heureusement établie et préfacée par Jacqueline Lévi-Valensi. C’est la même présidente de la Société des Etudes camusiennes qui a eu, d’autre part, le mérite de réunir un certain nombre de textes de Camus consacrés au terrorisme (2). A les relire, on se demande comment on n’y avait pas pensé plus tôt. Enfin c’est, je crois, Catherine Camus qui, justement impatientée par les clichés à propos du «silence» supposé de son père sur l’Algérie, a décidé, il faut l’en remercier, de republier dans la collection Folio les «Chroniques algériennes» écrites de 1939 à 1958 et qui constituaient déjà le tome III des «Actuelles».
Dans ces trois livres, il est question de la Résistance et de la révolution, de l’Algérie et de la violence, de l’honneur et de la révolte. Le thème dominant est en somme celui du Mal. Et la question, posée pour la première fois sous cet angle non religieux, est de savoir si la fameuse parole de Hegel, répétée par tous les idéologues et les idolâtres de l’Etat, selon laquelle «la violence est accoucheuse d’histoire», n’est pas souvent l’alibi du déshonneur et la source d’un malheur ajouté à tous ceux de la condition humaine. C’est à cette question que répond, chez Camus, le résistant français, le journaliste pied-noir et l’écrivain méditerranéen.
«Combat»
«De la Résistance à la révolution»
Les éditoriaux de Camus à «Combat», celui de la grande époque, c’est-à-dire pendant la clandestinité et après la Libération, donnent la nostalgie des sociétés où ne régnaient ni la dérision, ni le dénigrement, ni le dilettantisme des nihilistes, ni le confort intellectuel des résignés. Une tension épique les soutient. Un frémissement pascalien au lyrisme ténébreux entraîne le lecteur au-delà même des impasses du tragique. Quelle tension! Pendant quelques semaines, Camus, malade, est obligé de quitter le journal. François Mauriac avait l’habitude de polémiquer avec son jeune confrère. Il écrit: «A vrai dire, depuis que M. Albert Camus n’est plus là, les admirateurs de "Combat", parmi lesquels je m’honore de figurer, vivent du parfum d’un vase non certes brisé mais aux trois quarts vide.» Cela souligne la connivence chrétienne et justicière du grand romancier catholique avec l’incroyant qui affirmait que l’on pouvait être chrétien sans Dieu.
On retrouve dans ce recueil les classiques, c’est-à-dire les fameux articles où, seul de toute la presse, Camus refuse de se réjouir du bombardement atomique d’Hiroshima; la protestation, toujours solitaire, au milieu des fêtes de la Libération, contre les massacres d’Algériens après des manifestations dans le Constantinois; l’éloge d’une charte pour la presse qui interdirait aux «marchands» d’avilir «le plus beau métier du monde» (le journalisme); la formule assassine, enfin, lorsque Claudel, en décembre 1944, publie un poème dans lequel la France demande à de Gaulle de la regarder dans les yeux et l’appelle: «Mon Général qui êtes mon fils», et le Général répond: «Femme, tais-toi!» Alors Camus: «Nous avons pour les grandes œuvres de M. Claudel l’admiration qu’il faut. Nous avons pour le général de Gaulle le respect que l’on doit. Mais il est bien évident que ce poème ridiculise l’un et l’autre et que cela est regrettable. […] On peut avoir réussi l’image de la Bible et manquer celle d’Epinal.» Mais c’est dans «Combat» aussi que Camus publie l’importante série d’articles intitulée «Ni victimes ni bourreaux», qui traduit sa première hostilité théorisée au bolchevisme.
Algérie
Du bonheur à la malédiction
Le dernier article publié dans les «Cahiers Albert Camus» fait un lien avec celui qui rassemble les textes sur l’Algérie. Il ne s’agit de rien de moins que d’une lettre signée «Albert Camus et René Char» à propos de la condamnation à mort par le tribunal militaire d’Alger de deux tirailleurs algériens pour désertion à l’ennemi, neuf ans auparavant, au moment de la débâcle de 1940. «Nous vous demandons de bien vouloir rapprocher cette implacable sentence (compte tenu du climat de 1940) de celle qui a frappé avec beaucoup de modération des généraux accusés d’avoir offert leurs services à l’ennemi, étant prisonniers de l’armée allemande.» D’autant que les Algériens de l’époque n’étaient pas des citoyens français.
A vrai dire, il faut le rappeler et le répéter, Camus a été l’un des premiers et peut-être le seul, avec l’historien Charles-André Julien, à tout dire sur l’Algérie depuis 1935. On cite toujours ses grands reportages sur la misère en Kabylie, premier et unique pavé dans la mare de la presse française d’Algérie, et en effet ces articles en imposent. Mais il faut relire les phrases prémonitoires, inspirées et baignées de gratitude du jeune Camus lorsqu’il accueille les premières déclarations citoyennes et françaises du futur président algérien Ferhat Abbas, dont il va soutenir sans cesse les revendications, alors si modérées. Camus, qui s’était jusque-là intéressé aux nationalistes algériens au point de reprocher à ses amis communistes leurs distances à l’égard des indépendantistes de Messali Hadj, distingue soudain en Ferhat Abbas l’homme qui, miraculeusement, pourrait effacer le péché de la colonisation grâce à une révolution égalitaire accompagnée par la France. Refuser la citoyenneté française à ces colonisés qui veulent bien la demander, c’était évidemment «un crime». Cela n’a pas échappé à Camus, qui enrage. Il le dénoncera à nouveau aussitôt après la Libération.
En fait, Camus ne va cesser de redouter que la conjonction de la misère et de la répression ne conduise le peuple algérien au ressentiment, à la révolte et au soulèvement. A ce moment-là, disait-il, personne ne sera plus maître de rien. «Pour une nation comme la France, il est d’abord une forme suprême de démission qui s’appelle l’injustice. En Algérie, cette démission a précédé la révolte arabe et elle explique sa naissance, même si elle ne justifie pas ses excès.» Mais il conclut: «Déjà, depuis le 20 août, il n’y a plus d’innocents en Algérie, sauf ceux, d’où qu’ils viennent, qui meurent. En dehors d’eux, il n’y a que des culpabilités dont la différence est que l’une est très ancienne, l’autre toute récente. […] Quand l’opprimé prend les armes au nom de la justice, il fait un pas sur la terre de l’injustice.»
Camus pense au massacre contre les civils, dont il ne va se lasser d’affirmer qu’il salit et aliène toutes les causes. C’est après la dénonciation profonde, solennelle, pathétique des violences contre les innocents que Camus va lancer son «Appel pour une trêve civile en Algérie». Dans les locaux de «l’Express» où il partageait mon bureau les jours où il venait écrire son éditorial, il s’alarmait devant moi de la couverture médiatique tantôt indifférente, tantôt partisane des violences. A vrai dire, sa réflexion politique va se nourrir de plus en plus de sa protestation contre la violence. Camus voudrait une trêve pour négocier une paix qui ne peut pas être celle du FLN, laquelle, comme il le dit, risquerait de n’être que celle de l’islam. De toute façon, on n’a pas le droit de livrer l’Algérie tout entière au seul caprice d’un parti unique.
Une grande discussion continue encore aujourd’hui sur ce qu’on a appelé le «silence» de Camus à partir de ce moment. Or Camus s’est manifesté, il est vrai, sous bien d’autres formes, et l’ouvrage publié par Catherine Camus le prouve. Mais le mot «silence» n’est pas une invention de ses ennemis. Voici ce que Camus écrivait le 28 mai 1956 dans une lettre réclamant la liberté de son ami Jean de Maisonseul. «[…] Je me suis jusqu’ici obligé au silence sur l’affaire algérienne afin de ne pas ajouter au malheur français et parce que, finalement, je n’approuvais rien de ce qui se disait à droite comme à gauche.» C’est en 1958 que Camus écrira sa profession de foi la plus importante, d’où l’on peut extraire ces phrases: « […] Il n’y a encore jamais eu de nation algérienne. Les juifs, les Turcs, les Grecs, les Italiens, les Berbères auraient autant le droit à réclamer la direction de cette nation virtuelle. Les Arabes ne forment pas à eux seuls toute l’Algérie. […] Les Arabes peuvent du moins se réclamer de leur appartenance non à une nation mais à une sorte d’empire musulman spirituel ou temporel. Spirituellement, cet empire existe, son ciment et sa doctrine étant l’islam, mais il existe aussi un empire chrétien, au moins aussi important, qu’il n’est pas question de faire rentrer comme tel dans l’histoire temporelle.»
Camus propose de déclarer que l’ère du colonialisme est terminée et que la France, reconnaissant ses erreurs passées et présentes, est disposée à les réparer. Mais une injustice ne pouvant en réparer une autre, il exige que la France refuse de capituler devant la violence et de servir le rêve de ce qu’il appelle l’«empire arabe». Il sera finalement conduit à préconiser une solution fédérale développée par un professeur de droit, M. Marc Lauriol, et qui aboutirait, selon ce dernier, à un Commonwealth français.
Justice
«Plutôt ma mère...»
Si désireux que l’on soit de rendre justice à Camus, et l’on devine que c’est mon cas, si soucieux que l’on puisse être de rappeler notre dette envers un homme qui avait pratiquement tout prévu, si attentif, enfin, que l’on s’impose d’être aux significations de l’exode des jeunes Algériens qui choisissent aujourd’hui la République française pour être mieux fidèles à leurs origines, on ne peut faire autrement que de constater l’irréalisme des positions politiques de Camus. Au moment où il propose le fédéralisme, les jeux, hélas, sont faits. La Tunisie et le Maroc sont indépendants. L’émancipation des peuples colonisés a été célébrée au cours de la solennelle conférence de Bandung (Indonésie). Le nationalisme arabe a tous les visages de la libération, et son élan décolonisateur entraîne dans un souffle exemplaire, du Vietnam à Cuba, tous les peuples privés de dignité. On voit mal, dans ces conditions – personnellement, je ne vois pas –, comment l’on pourrait échapper à la solution, sans doute historiquement injuste et moralement ambiguë, de l’octroi de l’indépendance au seul profit d’un FLN sacralisé. L’idée d’isoler l’Algérie à l’intérieur du monde arabe pour y construire une sorte de Liban résiste mal à un examen sérieux. C’est Raymond Aron, alors, qui aura raison contre Camus en préconisant assez froidement de préparer sans attendre le retour en France des Français d’Algérie.
Un certain nombre d’intellectuels et d’écrivains algériens n’en souhaitent pas moins aujourd’hui réintégrer Camus dans leur patrimoine, soulignant que personne n’a jamais parlé de manière plus charnelle de la patrie algérienne et que, d’autre part, les soubresauts tragiques de la nouvelle et dernière guerre d’Algérie atténuent singulièrement l’aura des partisans de la rupture avec la France. «J’ai aimé avec passion, a écrit Camus, cette terre où je suis né, j’y ai puisé tout ce que je suis et je n’ai jamais séparé, dans mon amitié, aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu’ils soient. Bien que j’aie connu et partagé les misères qui ne lui manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l’énergie et de la création, et je ne puis me résigner à la voir devenir pour longtemps la terre du malheur et de la haine.»
«Le terrorisme tel qu’il est pratiqué en Algérie a beaucoup influencé mon inquiétude. Quand le destin des hommes et des femmes de son propre sang se trouve lié, directement ou non, à ces articles qu’on écrit si facilement dans le confort du bureau […], je ne cesse de craindre, en faisant état des longues erreurs françaises, de donner un alibi, sans aucun risque pour moi, au fou criminel qui jettera sa bombe sur une foule innocente où se trouvent les miens.» Camus déclare plus loin qu’il ne sera jamais de la race de ceux qui pensent que le frère doit périr plutôt que les principes. Alors, la mère plutôt que la justice? En fait, Camus se demande simplement ce que peut être une justice qui met sa mère en danger et qui exige qu’il ne se soucie pas d’elle.
Sur la torture, il ajoute: «Les représailles [de l’armée française] contre les populations civiles et les pratiques de tortures sont des crimes dont nous sommes tous solidaires. Que ces faits aient pu se produire parmi nous, c’est une humiliation à quoi il faudra désormais faire face. En attendant, nous devons du moins refuser toute justification, fût-ce par l’efficacité, à ces méthodes. Dès l’instant, en effet, où, même indirectement, on les justifie, il n’y a plus de règles ni de valeurs, toutes les causes se valent et la guerre sans buts ni lois consacre le triomphe du nihilisme. […]
Mais, pour être utiles autant qu’équitables, nous devons condamner avec la même force et sans précautions de langage le terrorisme appliqué par le FLN aux civils français comme, d’ailleurs, et dans une proportion plus grande, aux civils arabes. Ce terrorisme est un crime qu’on ne peut ni excuser ni laisser se développer. Sous la forme où il est pratiqué, aucun mouvement révolutionnaire ne l’a jamais admis et les terroristes russes de 1905, par exemple, seraient morts (ils en ont donné la preuve) plutôt que de s’y abaisser. Après tout, Gandhi a prouvé qu’on pouvait lutter pour son peuple et vaincre sans cesser un seul jour de rester estimable. Quelle que soit la cause que l’on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d’une foule innocente où le tueur sait d’avance qu’il atteindra la femme et l’enfant.»
On peut dire à la fois que toute la morale de Camus est contenue dans cette attitude, plus précisément définie ainsi dans un autre passage: «Lorsque la violence répond à la violence dans un délire qui s’exaspère et rend impossible le simple langage de raison, le rôle des intellectuels ne peut être, comme on le lit tous les jours, d’excuser de loin l’une des violences et de condamner l’autre, ce qui a pour double effet d’indigner jusqu’à la fureur le violent condamné et d’encourager à plus de violence le violent innocenté.» On ne peut pas lire ces lignes sans penser à la seconde guerre d’Algérie, car les frères ennemis s’y entre-déchirent dans une intimité atroce et un aveuglement indistinct. L’Algérie de ces dernières années donne un irrépressible sentiment de malédiction. Mais contraints, de nos jours, à être les notaires des abominations et les chroniqueurs de l’horreur dans les rangs des Israéliens et des Palestiniens, il est vrai que les propos de Camus s’imposent à nous comme une lumière à la fois impitoyable et solaire.
Violence
La terreur, les innocents, l’honneur
Restent les thèses générales sur la terreur et ses agents d’exécution. Que la fin ne justifie jamais les moyens, que la violence contre l’injustice doive elle-même s’imposer des limites, que le mal finisse par ne plus accoucher que du mal, qu’il faille souvent, enfin, se placer au milieu de ceux qui s’affrontent plutôt que dans un camp contre l’autre, tout cela peut très bien inspirer directement les mêmes comportements aujourd’hui et hier. Mais quelque chose a changé depuis l’époque où écrivait Camus, et il semble que cela ait échappé aux sages regards des deux juristes chargés de commenter ces «Réflexions sur le terrorisme». Ce qui a changé, c’est que l’on tue de plus en plus directement et de moins en moins par procuration. Ce qui a changé, c’est le prix de la vie non, bien sûr, aux yeux des gouvernants mais à ceux des masses. La peur de la mort, le cauchemar à l’idée d’être soi-même blessé ou de perdre un être cher, le goût du bonheur et de la vie ont déserté le camp des kamikazes qui organisent les attentats suicides et se transforment en bombes humaines. On peut en dire autant de certains de leurs ennemis depuis que l’on a vu le tueur d’Hébron et l’assassin de Rabin intégrer leur propre mort dans leur acte, et l’on a très bien compris que les inspirateurs d’un intégrisme juif préfèrent souvent le sang des reconquêtes à la paix du partage et des compromis. Camus avait tout prévu sauf la fascination des meurtriers pour le suicide au nom de Dieu.
Cependant, en dépit de la véritable régression opérée dans l’éthique de la violence, malgré le fait que nous ne soyons plus surpris de lire, dans notre journal du matin, le récit d’égorgements d’enfants, d’éventrations de femmes enceintes, de décapitations de vieillards à la hache, quelque chose d’essentiel demeure dans l’obsession camusienne sur les limites absolues que doit connaître l’usage de la violence. Le meilleur exemple, les deux guerres d’Algérie nous le procurent. De novembre 1954 à juillet 1962, les atrocités contre les civils, qu’ils fussent d’ailleurs français ou non, musulmans ou non, n’ont cessé de répondre à la torture, aux rafles, aux déplacements de populations et aux bombardements de la répression française. Les compagnons de route des insurgés du FLN croyaient pouvoir affirmer alors deux choses. La première consistait à sous-estimer de manière systématique la dimension islamique du combat des Algériens. La seconde, à justifier ce qu’ils appelaient «les bombardements du pauvre», à savoir le terrorisme indistinct. Ces deux affirmations se sont révélées fausses. Je n’insisterai pas ici sur la première, qui concerne l’islam, bien que cette erreur d’appréciation soit tragiquement confirmée par les plus récents événements. La philosophie tiers-mondiste, qui consiste à uniformiser toutes les révoltes en les expliquant par une relation de l’opprimé avec l’oppresseur, si justifiée qu’elle demeure en bien des domaines, est loin de rendre compte de l’émergence des renaissances religieuses.
Mais pour ce qui est de l’usage de la violence indistincte et de sa justification au nom d’un zèle passionnel et compassionnel, deux observations soulignent le caractère erroné (et peut-être aussi irresponsable) des jugements d’absolution. La première concerne l’éthique stratégique des insurgés algériens. Ont-ils tous et toujours approuvé les méthodes qu’ils préconisaient pour les autres et qu’ils appliquaient souvent eux-mêmes? Nous avons cru que c’était le cas. Les derniers historiens algériens de la première guerre d’Algérie (3) ont établi le contraire. La perte de la bataille d’Alger, nettement gagnée par les colonels tortionnaires du général Massu, a été attribuée à la peur qu’a inspirée dans tous les rangs, aussi bien algériens que français, le terrorisme aux dépens des civils dans les lieux publics. L’impopularité de ces massacres a été plus grande que l’indignation suscitée par la répression et même par l’usage de la torture. Les responsables du FLN en ont aussitôt tiré les conclusions et ont stoppé juste à temps l’ordre donné aux Algériens résidant en France métropolitaine de procéder à des attentats un peu partout, et surtout dans les transports. S’est-il agi d’un doute unique sur l’inefficacité de la violence aveugle? En tout cas, pas pour tout le monde. Un rapport a circulé chez les responsables du FLN sur les atteintes portées à l’honneur de la révolution par certaines violences sadiques et aveugles.
La deuxième observation sur les conséquences de l’indulgence professée à l’égard de certaines pratiques d’insurrection concerne les traces qu’elles ont laissées dans le peuple comme des braises mal éteintes qui se sont réveillées dès qu’une occasion de fanatisme est arrivée. Les fameux «Afghans» du GIA n’auraient été, somme toute, que les héritiers des tueurs de la première guerre. Par exemple, le fait de raser entièrement des villages contre lesquels on exerçait une punition collective pourrait avoir pour origine le souvenir des règlements de comptes entre civils qui avaient accompagné la guerre d’indépendance. Sur tous ces points Camus a eu raison. «A la justification marxiste des violences prolétariennes et anticolonialistes, Camus oppose l’exceptionnalité de toute violence.» C’est ce que remarque Denis Salas, magistrat qui commente avec Antoine Garapon, autre magistrat, ces «Réflexions sur le terrorisme».
A vrai dire, lorsque Camus évoque cette montée aux extrêmes dans chaque camp, qui a pour fin d’anéantir toute espèce de médiation politique; lorsqu’il dénonce le «mimétisme destructeur» qui conduit les adversaires à mourir ensemble; lorsqu’il dit que répondre au mal par le mal a pour résultat de l’accroître et non de l’éradiquer; quand, enfin, le même Denis Salas, résumant Camus, énonce que «le nihilisme de l’efficacité du terrorisme culmine quand les rôles de bourreaux et de victimes deviennent interchangeables», alors il est difficile de ne pas penser à l’impasse tragique où s’enferment Israéliens et Palestiniens. En se suicidant en même temps qu’ils assassinent, les nouveaux kamikazes, se faisant à la fois victimes et bourreaux, échappent à la justice des hommes pour présenter à Dieu les furieuses épousailles et les dépouilles maudites de deux ennemis plus que jamais et définitivement intimes.

JEAN DANIEL
(1) Gallimard.
(2) «Albert Camus. Réflexions sur le terrorisme», Editions Nicolas Philip.
(3) «Une vie debout : Mémoires politiques (tome I, 1945-1962), par Mohammed Harbi, La Découverte.
Dans la rubrique "l'Edito de Jean Daniel" : du Nouvel Observateur.
Document proposé et présent sur le site du Nouvel observateur.
Semaine du jeudi 14 novembre 2002 - n°1984 - l'Edito de Jean Daniel Le Nouvel Observateur 2002/2003
Octobre 2010
.
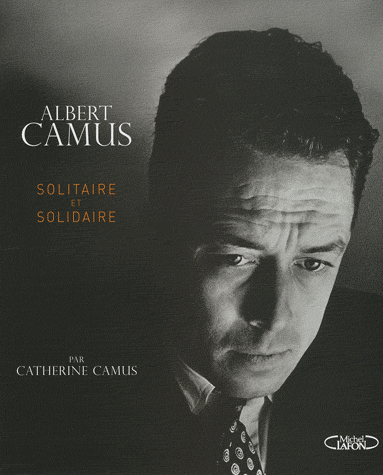













Les commentaires récents