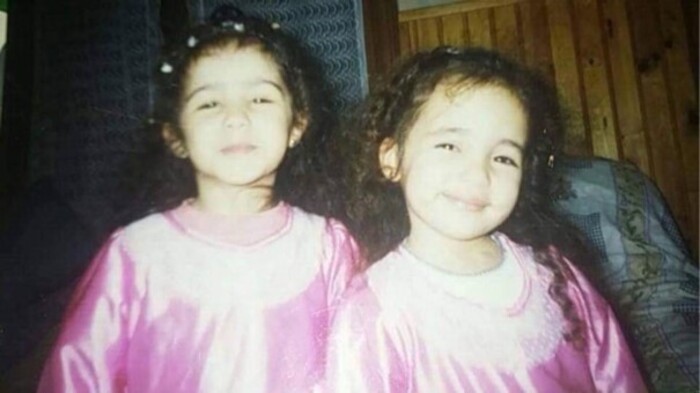
Ma sœur jumelle et moi. © Khedidja Zerouali
Quand on est racisé·e dans ce pays, on naît en apnée, on vit en apnée et on risque de mourir étouffé·e. La violence des mots, de la répression, du rejet que l’on subit en France est devenue intenable.
Je ne vis plus tranquillement depuis qu’un policier a mis une balle dans le thorax de Nahel, un enfant de 17 ans, arabe et habitant dans un quartier populaire de Nanterre.
Quand on est arabes et noir·es, racisé·es dans ce pays, on naît en apnée, on vit en apnée et on risque de mourir étouffé·e. Je suis tellement en colère que même les gens heureux m’agacent ces jours-ci. Comment peux-tu vivre heureux dans un pays qui suinte le racisme par tous ses pores ? Qui tue, qui justifie, qui punit ses enfants qui osent se lever contre l’injustice ? Ce n’est pas le premier et pourtant cet homicide-là, et tout ce qui a suivi, nous marquera durablement.
Le policier qui a tué a été soutenu financièrement par le ministre de l’intérieur, qui lui a permis de maintenir son salaire. Des Français·es, comme celles et ceux qu’on croise tous les jours, et des bourgeois·es gêné·es par quelques milliers d’euros en trop sur leurs comptes, ont nourri une caisse de soutien de plus d’un million d’euros. Une fille avec qui j’étais au lycée et que j’aimais beaucoup a partagé la cagnotte pour le policier sur Facebook. Ceux qui pensent qu’on peut de cette manière ôter la vie d’un jeune homme de 17 ans sont partout autour de nous. C’est aussi des gens bien, comme cette poignée de profs de mon ancien lycée qui estiment que, quand même, ce petit Nahel l’avait peut-être un peu cherché.
Que faire avec toute cette colère ?
Quand de jeunes gens de quartiers populaires, qui auraient pu être Nahel, ont dit leur colère dans le feu et le fracas, ils ont été envoyés, fissa, en comparution immédiate. Prison, prison, prison.
Quand des familles de victimes de violences policières, comme la famille Traoré, ont voulu marcher et se recueillir, l’État les en a empêchées par deux fois. Le 8 juillet 2023, elles ont marché quand même, à Paris, et en hommage à Adama Traoré comme elles le font chaque année depuis sept ans. Cela a valu à la sœur Assa une procédure judiciaire par la préfecture de Paris. Cela a valu au frère Yssoufou une arrestation d’une violence inouïe, à tel point qu’une enquête pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique » a été ouverte. Peu importe les raisons pour lesquelles ils l’ont arrêté, la violence de l’arrestation m’a retourné le ventre.

À Nanterre le 30 juin 2023. © Laurent Grandguillot / REA
’étais dans le train, il y a deux jours, quand j’ai entendu le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, qui s’est si longtemps drapé dans son combat contre l’extrême droite, inviter le Rassemblement national à saisir la justice contre les élu·es de gauche qui avaient marché aux côtés de la famille Traoré, malgré l’interdiction préfectorale. Ce n’est pas que j’accorde un quelconque crédit politique à Éric Dupond-Moretti mais qu’on en soit rendus là m’a scotchée. Je ne pleure pas facilement (à part devant des films), mais j’ai eu subitement très envie de pleurer devant l’abîme. Que vais-je donc faire avec toute cette colère ? Peut-être me mettre enfin au sport, peut-être aller dehors crier, peut-être tout dire dans un billet de blog, et puis quoi après ? Peut-être quitter ce pays.
Je me suis dit, quelque part entre Nîmes-Gare et Nîmes-Centre, que le fascisme, on ne s’y rend pas, on y est déjà. Ils peuvent faire pire, ils ont de la marge dans l’ignoble, mais on y est.
À ce moment-là, tout s’est mélangé dans mon esprit : le contrôle des corps des jeunes lycéennes musulmanes, les petits qui jouent à la prière dans la cour et contre qui on lâche l’appareil d’État, tous ces jeunes gens morts de violences policières, ceux légitimement en colère qu’on envoie au trou, le RN qui passe pour timoré à côté de la droite classique, le sort réservé aux migrant·es en France, en Tunisie, en mer, ailleurs, la déliquescence d’une partie de la gauche sur ces questions… L’impression d’être toujours seul·es, face à une violence qui nous dépasse.
Pas avare en provocations, ce mercredi, le ministre de l’intérieur a annoncé qu’il demandait l’interdiction de la manifestation contre les violences policières qui doit se tenir en fin de semaine. Encore. Je compte m’y rendre pour crier avec les autres, mais je me demande si on n’a pas déjà perdu.
C’est qui, la racaille ?
Désormais, les habitant·es des quartiers populaires qui ont vu l’un de leurs enfants mourir en direct, qui ont vu leurs voitures et leurs mobiliers urbains partir en fumée, sont puni·es une troisième fois. Plus de transports le soir et tant pis pour les darons qui s’en servent pour revenir du travail. Plus d’activités estivales au Blanc-Mesnil : sur l’affiche de « Beach Mesnil », on peut lire : « Annulé, les économies réalisées permettront de repérer les dégâts commis par les émeutiers. » Le sénateur Les Républicains Thierry Meignen, maire du Blanc-Mesnil avant de céder sa place pour ne pas cumuler, a jugé nécessaire d’ajouter l’insulte à la punition collective : « J’en ai marre de cette poignée de petits connards qui ne sont pas tenus par leurs parents ! »

À la mairie de Saint-Ouen, plus aucun bus ne passe après 20 heures ce lundi 3 juillet 2023. © Khedidja Zerouali / Mediapart
Par ailleurs, la punition collective n’est pas circonscrite au Blanc-Mesnil, elle devient règle nationale puisque l’extrême droite et la droite (dont Renaissance) réfléchissent à la manière de punir financièrement les familles des jeunes révolté·es. « Il faudrait qu’à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles », a lancé, toute honte bue, le président de la République, qui s’enferme dans une pratique du pouvoir toujours plus autoritaire, méconnaissant l’individualisation des peines qui vaut dans la justice française.
Et de notre côté, on souffle, on s’inquiète, on ne parle plus que de ça, on s’imagine partir dans un autre pays quand on voit qu’un sénateur de droite – BRUNO RETAILLEAU – peut dire en tout décontraction que les « émeutes » procèdent d’une « régression vers les origines ethniques » sur un plateau de télévision sans être repris, sans être exclu de son groupe, sans qu’aucune conséquence d’aucune sorte ne punisse ce racisme décomplexé. C’est la ligne.
Il n’est pas le seul. Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR elle aussi, a versé dans le même registre, sans que cela ne lui soit reproché : « Vous allez me dire : la plupart des gens qui sont arrêtés sont français, d’accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd’hui. Ils sont comment français ? » Elle le répète, avec de grands gestes de politicienne pour appuyer ses inepties, arguant que ces « enfants d’immigrés » ont « la haine de la France ».
Effectivement, si j’étais une jeune fille de Saint-Gratien (Val-d’Oise), la ville dont elle a été maire et sur laquelle elle exerce toujours un pouvoir certain, j’aurais probablement la haine. La même a mené localement une guerre contre les quartiers populaires sans précédent, comme le racontait Streetpress en 2020. Le quartier des Raguenets s’était mobilisé tout entier contre la destruction du mini-stade de foot synthétique du coin… une destruction notamment portée par la sénatrice, la mairie, et soutenue par l’extrême droite. Ils ont détruit le mobilier urbain de leur propre ville, justifiant la chose par des « règles sanitaires non respectées », des tournois clandestins et des « nuisances pour les habitants car ce terrain synthétique est enclavé et n’a jamais été conçu pour y recevoir du public ».
La sénatrice n’avait pas supporté, l’année d’auparavant, l’organisation d’une grande CAN des quartiers qui prenait notamment place sur le petit terrain. De jeunes gens racisé·es et issu·es des quartiers populaires qui s’amusent dans sa commune, ça avait tellement agacé la mairie qu’elle avait posé des blocs de béton en plein milieu du tournoi. C’est toujours la même élue qui qualifiait les jeunes de Saint-Gratien de « racailles » et qui approuvait l’idée d’envoyer une milice « leur casser les dents ». C’est qui, la racaille ?
Les élus qui mettent de l’huile sur le feu ces derniers jours le font à dessein, dans un combat idéologique et civilisationnel qu’ils mènent contre nous depuis des années. Ils ne veulent plus de nos gueules de métèques ici, ils nous le font comprendre. Partir serait leur donner raison mais rester à quel prix ? Et puis pour partir où ?
Pendant que le cirque médiatique bat son plein, dépassant toujours les limites de la décence, que des élus nous piétinent de leur violence, des jeunes gens dorment en prison pour avoir usé du seul moyen d’expression qu’on leur laisse.
« [Les autorités] n’attendent de nous que le crachat, le crachat et la violence, car [elles] ne peuvent pas nous imaginer autrement »
On a vu, inquiet·ètes, l’avenir de ces centaines de jeunes gens être brisé par la volonté de mater la révolte par une violence nouvelle. J’ai 26 ans et je suis du côté des journalistes qui couvrent l’événement, mais dix ans plus tôt, j’aurais tout à fait pu être l’une de ces jeunes gens qui veulent rendre les coups… Peut-être qu’en cachette j’aurais pris un bus jusqu’à Perpignan pour lancer une pierre ou deux. Même bêtement, même par le feu, même si ce qui part en fumée se trouve juste en bas de chez moi. J’avais la même rage dans le ventre et j’aurais pu faire la même chose, obsédée par deux seules questions : que vaut une vitrine cassée, un abribus brûlé, à côté de la vie de l’un des nôtres ? Et puisqu’on ne nous prête de l’attention que quand on se montre violent·es, pourquoi rester sages et se condamner à rester inécouté·es ?
Tout cela me fait penser à un texte d’un metteur en scène un peu fou, Lazare, qui avait accepté de donner des cours à des élèves éloigné·es du théâtre sans qu’ils ou elles ne déboursent un euro. J’étais l’une d’entre eux. Dans ce texte, il disait à propos du rapport des autorités aux jeunes gens racisé·es qu’elles « n’attendent de nous que le crachat, le crachat et la violence, car [elles] ne peuvent pas nous imaginer autrement ». Je trouvais cette phrase si juste que je l’ai relue plusieurs fois depuis. Et je l’ai dite à un tas de gens. Elle me revient ces temps-ci. Il y a quelques jours, j’ai rencontré Farid lors d’un reportage, il me rapportait cette phrase que lui avait dite un jour un jeune qu’il suivait en tant qu’éducateur de rue : « On nous traite comme des animaux, on se révolte comme des sauvages. »
Dans le groupe Facebook de ma famille, après la mort de Nahel, ma tante a prédit des « émeutes », mon oncle a répondu « et c’est tant mieux ». Certains d’entre eux ont en mémoire des morts et des traumatismes anciens. C’est ça, la vie des Arabes en France, des Noirs, des racisé·es, de toutes celles et ceux qui retiennent leur respiration en passant à côté d’un policier.
Douce France, beau pays de mon enfance
Dix ans avant ma naissance, Malik Oussekine a été matraqué à mort par deux policiers. C’était en 1986, mon père vivait encore en Algérie, enseignait la langue des colons à des enfants encore traumatisé·es par la violence française. Il n’avait pas eu le choix : il était enfant de pauvres dans un village de pauvres, le nouvel État algérien avait choisi pour lui sa carrière. Mon père et ma mère connaissent le sort qui a été réservé à Malik Oussekine, et s’en souviennent. Mon père, qui ne regarde que des documentaires animaliers et des vidéos sur Facebook, m’a demandé récemment de le mettre devant la série qui a été consacrée au sort de ce jeune homme de 22 ans.
Ils savent que c’est notre histoire aussi. C’est la même police française qui, dans ses heures coloniales, a tenu mon grand-père en joug, l’a enfermé, a usé de la gégène sur le corps d’enfant de ma grand-tante, etc.
Mes parents se sont rencontrés dans les Pyrénées-Orientales, un an après qu’Aïssa Ihich est mort d’un malaise cardiaque en garde à vue, en 1991. Son nom a été oublié depuis, je ne pense pas que mes parents le connaissent. Sandrine Rousseau l’a fait vivre quelques instants à l’Assemblée nationale il y a deux jours, le ministre de l’intérieur a soufflé et détourné le regard. La violence s’ajoute à la violence, et la nausée revient.
En 1991, le maire de Perpignan, c’était Paul Alduy, un ancien résistant, un socialiste qui avait trahi en se rapprochant des gaullistes. Il est resté maire 34 ans, a enfanté et a fait de son fils, Jean-Paul Alduy, le maire d’après. De droite, bien bien de droite. La droite perpignanaise, déjà affreusement proche des idées d’extrême droite et nostalgique de l’Algérie française, a depuis laissé sa place au Front national, Louis Aliot ayant pris la tête de la ville depuis 2020. Ça fait trois ans que quand je rentre chez moi, j’évite le plus possible de mettre les pieds à Perpignan, ville où l’on fleurit chaque année une stèle en hommage aux terroristes de l’OAS. Le maire veut désormais installer une esplanade au nom de l’ancien chef de l’OAS après avoir inauguré, en 2022, un square au nom d’un député de l’Algérie française, proche de Jean-Marie Le Pen. Les gens de chez moi, qui partagent mon accent et l’amour des bunyettes, votent à l’extrême droite à presque chaque élection et n’hésitent plus à te cracher leur racisme au visage. Heureux comme des Algériens en France.
J’avais déjà six ans – et un tas de bêtises derrière moi – quand les deux policiers responsables de la mort d’Aïssa Ihich ont été reconnus coupables de violences aggravées. Quelques mois de sursis et puis s’en va. C’est à peu près à cet âge-là que mes parents ont fait comprendre à ma sœur et moi qu’il fallait qu’on soit des petites filles sages, plus sages que les autres parce qu’on est « chez eux ». Ils me le disent encore parfois quand je m’emporte dans des tirades antiracistes. Ma mère s’inquiète aussi du sort que les policiers pourraient réserver à une jeune journaliste venue couvrir les manifestations, puisqu’elle sait comme je sais que pour eux, nous ne sommes que des Arabes comme les autres.
Depuis le drame du 27 juin 2023, c’est sans se cacher que des confrères, des consœurs et des élu·es nous crachent tous les jours dessus. En plus de cette horde de gens anonymes sur les réseaux sociaux : on ne m’a jamais autant traitée de sale Arabe que ces derniers jours. Mon amoureux filtre mes notifications Twitter quand je dors, pour que je ne puisse voir que les interactions des gens que je suis, mais dans une démarche malsaine, je remets souvent les notifications parce que je veux savoir. Je n’écris pas pour me plaindre, j’écris parce qu’il fallait un lieu pour déverser un peu de ma colère, et je l’ai trouvé ici, à défaut de faire du sport. Avec autant de rancœur, on ne respire pas bien.
Pensée à nos petites sœurs

Ma sœur Asma. © Khedidja Zerouali
Dans un très juste billet du Bondy Blog, « Heureux comme un Arabe en France », mon confrère Ayoub Simour pose la question : « Comment se construit-on dans ce contexte où l’on se fait constamment cracher dessus ? » Il pense à son petit frère, 8 ans, qui reconnaît dans le visage de Zemmour celui d’un raciste, quand nos responsables politiques peinent encore à qualifier CNews pour la chaîne qu’elle est : d’extrême droite. Quand l’un, moins aveugle que les autres, se risque à mettre des mots sur la réalité, il est lâché par tous les autres.
J’ai honte de ce qu’est devenu ce pays pour le petit frère d’Ayoub et pour ma petite sœur à moi, Asma. Elle vient d’avoir son bac, brillamment. Elle est en colère, comme moi, mais ne se trimballe pas de manifestation en assemblée générale comme je le faisais à son âge. Il y a quelques mois, elle s’est levée contre l’injustice : elle a défendu l’une de ses camarades de classe venue en abaya et exclue de cours pour cela. Avec une autre de leurs copines, arborant une Vierge Marie autour du cou et dénonçant le deux poids deux mesures puisqu’elle n’avait jamais été inquiétée à ce sujet, elles ont toutes les trois atterri dans le bureau de la proviseure. Asma a défendu le droit de sa camarade de classe à venir avec une robe large, arguant que ce n’était pas un signe religieux et que la démarche du professeur était discriminante.
De son côté, la proviseure répétait les éléments de langage qu’on entend depuis des semaines sur les chaînes de télévision nourrissant la haine. Je connais ma sœur, elle devait trembler comme une feuille mais elle a tenu, et c’est peut-être la seule chose qui me réjouit dans toute cette affaire. Son portable a sonné au milieu de la brimade, c’était l’appel à la prière qu’elle avait oublié de mettre en silencieux. D’un geste d’autorité, la proviseure a exigé de ma petite sœur qu’elle supprime l’application de son portable. La laïcité appliquée à l’intime, jusqu’aux portables des jeunes filles musulmanes dont il ne faut pas seulement contrôler l’habit mais aussi l’iPhone. Elle s’est exécutée, de peur de représailles trop importantes sur sa scolarité. Quand elle m’a raconté tout ça, le feu de la haine a consumé ce qu’il me restait d’espoir dans ce pays.
J’ai cherché une issue positive à ce texte, mais je n’ai pas trouvé. Je ne vois, dans cet océan de racisme et d’autoritarisme, rien de positif. Comme le dit la rappeuse Casey, « des fois, c’est un crachat dans ta gueule que j’ai envie d’envoyer pour que tu comprennes ».
SOURCE : Accablée comme une Arabe en France | Le Club (mediapart.fr)
Par micheldandelot1 dans Accueil le 18 Février 2024 à 19:35
https://blogs.mediapart.fr/khedidja-zerouali/blog/130723/accablee-comme-une-arabe-en-france
.

Les commentaires récents