« MA » guerre d’Algérie par Antoine BERAUD. Conférence du 5 mars 2001 Lions Club Cholet-Mauges
AVANT-PROPOS Je n’ai jamais eu l’intention ni la prétention de vous faire une conférence sur « LA GUERRE D’ALGÉRIE », le sujet est trop vaste, la question trop complexe et les spécialistes n’ont pas encore terminé leurs travaux sur cette période douloureuse de notre histoire. Je veux simplement vous apporter mon témoignage, vous raconter mes quatre années passées là-bas sous le képi bleu des « AFFAIRES ALGÉRIENNES », comme Lieutenant chef d’une SAS dans le bled du Sud oranais, au contact direct des populations locales et non dans un bureau d’État-Major, et vous apporter peut-être un début de réponse aux questions que vous pourriez vous poser encore aujourd’hui sur ces évènements auxquels on n’a jamais jusqu’à ce jour donné des réponses franches ni satisfaisantes.
Nous pourrons en débattre à la fin de l’exposé. Cela va m’amener à parler de moi, ce n’est pas là mon fort. J’irai même jusqu’à me dévoiler, vous faire des révélations que je n’ai encore jamais faites même pas à mes proches. Il aura fallu pour cela attendre 40 ans. La raison vous la découvrirez peut-être au fil de l’exposé.
Pour lire le document au format pdf, cliquer sur le képi bleu

- « MA » guerre d’Algérie. Conférence du 5/03/2001 Lions Club Cholet-Mauges
- Je veux simplement vous apporter mon témoignage, vous raconter mes quatre années passées là-bas sous le képi bleu des « AFFAIRES ALGÉRIENNES », comme Lieutenant chef d’une SAS dans le bled du Sud oranais, au contact direct des populations locales et non dans un bureau d’État-Major,
Pour commencer, le rappel de quelques généralités puis par ordre chronologique le résumé des principaux faits marquants de cette époque.
La GUERRE D’ALGÉRIE, pour nous Français, a été le dernier épisode tragique de la décolonisation, et pour le peuple algérien sa guerre d’indépendance.
Elle fut tout à la fois : une guerre classique qui engagea des moyens et des armes lourdes, l’artillerie, les blindés, l’aviation... une guerre anti-terroriste, anti-guérilla, et vous savez que cette guerre-là est l’une des plus difficiles à mener sur le terrain. Une guerre « pacificatrice », j’ai conscience du paradoxisme, je m’en expliquerai longuement tout à l’heure. Une guerre civile algéro-algérienne qui fit beaucoup de victimes parmi la population indigène. Ça continue d’ailleurs encore aujourd’hui. Enfin une guerre civile franco-française, parce que des Français ont tiré volontairement sur d’autres Français tuant un certain nombre de leurs compatriotes.
Elle a duré 8 ans du 1er novembre 1954 au 3 juillet 1962 et commence dans la nuit du 31 octobre par le mitraillage de plusieurs gendarmeries, l’enlèvement de quelques gardes champêtres et l’incendie d’une dizaine de fermes isolées dans les montagnes, mais aussi, et c’est cela que l’histoire a retenu, par l’assassinat d’un jeune instituteur fraîchement débarqué de métropole qui rejoignait son poste dans les AURES, en compagnie de son épouse. Il fut tué sur place sa femme grièvement blessée décédera quelques jours plus tard à l’hôpital. Elle se termine dans la tragédie, un territoire mis à feu et à sang et l’exode d’environ 1 million de personnes dans des conditions pitoyables indignes d’un pays civilisé comme le nôtre. En 1954 il y avait peu de troupes en Algérie, essentiellement des forces de gendarmerie et des Unités territoriales, environ 30 000 hommes, l’Armée française était encore en Indochine. Rappelez-vous, DIEN-BIEN-PHU mai 1954 et nous sommes en novembre 1954. Au début on se refusait à parler de guerre on évoquait des opérations de maintien de l’ordre. Pourquoi ? Parce que l’Algérie partie intégrante du territoire français avec ses départements à la française, ses députés représentés au Parlement... ne pouvait pas juridiquement être en guerre contre elle-même.
En 1955 après les massacres de PHILIPPEVILLE et plus tard ceux de MELOUZZA qui firent plus de 200 morts parmi la population de souche européenne et plus de 5 000 en représailles parmi la population indigène, l’état d’urgence fût décrété.
En 1956 les pouvoirs spéciaux seront votés par le Parlement et approuvés par toute la classe politique de l’époque y compris les communistes. Ils donnaient tout pouvoir au Délégué Général contraint de s’établir sur place à Alger. Je rappelle sans vouloir faire de politique partisane que Jacques SOUSTELLE et Robert LACOSTE nommés par les gouvernements socialistes de l’époque ont été les plus ardents défenseurs de l’Algérie française, François MITTERRAND quant à lui était ministre de l’Intérieur. C’est en 1956 également que l’on rappellera les réservistes, 100 000 environ, et qu’on décidera de maintenir sous les drapeaux jusqu’à 24 mois, voire 28 mois les classes libérables, l’Armée réclamait alors plus de 300 000 hommes pour faire face à la situation. En 1957, bataille d’Alger gagnée avec les méthodes que l’on sait par les parachutistes de BIGEARD et de MASSU, à qui on avait donné carte blanche pour accomplir cette sale besogne, mettre fin aux attentats terroristes qui chaque jour ensanglantaient la ville d’Alger. À signaler déjà que les deux enquêtes parlementaires diligentées sur place n’avaient rien trouvé de répréhensible à ces méthodes. Déjà l’hypocrisie des pouvoirs publics... 13 mai 1958 : coup d’État militaire. L’Armée d’Algérie s’empare de tous les pouvoirs civil et militaire, chasse les préfets, les sous-préfets, les administrateurs civils et s’installe à leur place. La quatrième République agonise. C’est l’appel solennel des Généraux SALAN du bout des lèvres, et MASSU avec beaucoup de conviction, pour le retour au pouvoir du Général De GAULLE. C’est l’avènement de la cinquième République, conséquence indirecte de ce coup d’état réalisé par l’Armée en Algérie le 13 mai 1958, cela on a tendance à l’oublier aujourd’hui. Octobre 1958 : discours de CONSTANTINE par lequel le Général De GAULLE dégage des milliards de crédits et de subventions pour mettre en oeuvre un gigantesque plan de développement et sortir l’Algérie de son retard dans les domaines social et économique : construction de 1 000 villages, 2 000 écoles, 20 000 logements, ouverture de grands chantiers, aide à l’agriculture, etc... tout cela dans le but unique et déclaré, mener une politique d’intégration de l’Algérie à la France. Jusqu’à la fin de l’année 1958, dans l’esprit de tous les Français, il n’était question que d’Algérie française. C’est au cours de l’année 1959 que le pouvoir politique commence à se dérober, se désengage, fait marche arrière, cela dans la plus grande confusion, l’équivoque la plus totale, et pour l’avoir vécu sur le terrain je peux le dire, dans l’hypocrisie et le mensonge. C’est d’autant plus incompréhensible de la part d’un grand homme, d’un grand Général rappelé au pouvoir pour garder l’Algérie à la France. Janvier 1960 : première révolte des Pieds-Noirs dans Alger avec la semaine des barricades. Le pouvoir de nouveau est dans la rue. LAGAILLARDE et ses troupes comme au temps de la Commune y construisent des barricades interdisant toute circulation. L’Armée hésite à réprimer malgré les ordres, De GAULLE se fâche envoie des renforts de métropole et LAGAILLARDE capitule, mais défilera dans Alger à la tête de ses troupes sous les applaudissements de la population. Au final c’est un échec, mais un premier avertissement. Avril 1961 : Putsch des Généraux par un « quarteron de Généraux félons », je rappelle leurs noms, SALAN, JOUHAUD, CHALLE, ZELLER, tous Généraux cinq étoiles, le plus haut grade dans l’Armée.
Sur place l’Armée est divisée, mais en France c’est l’affolement, on craint la guerre civile et on s’attend à voir des parachutistes sauter sur Paris, l’inquiétude est partout manifeste, la fermeté du Général De GAULLE fera échouer une seconde fois cette tentative de coup d’état. L’Armée reprochera longtemps au Général De GAULLE d’avoir fait appel pour cela à la désobéissance et à l’insoumission des appelés du contingent.
SALAN rentre dans la clandestinité et crée l’O.A.S. (Organisation de l’Armée Secrète). Il a le soutien des Pieds-Noirs et la sympathie de beaucoup de cadres de l’Armée, il sera cependant arrêté 14 mois plus tard, CHALLE et ZELLER se rendent, JOUHAUD natif d’Oran se réfugie dans sa famille, mais sera arrêté lui aussi quelques mois plus tard. 19 mars 1962 : C’est le cessez-le-feu suite aux accords d’Évian signés la veille et approuvés à une très large majorité par les Français de métropole consultés par référendum. À Alger dans la foulée c’est la fusillade de la rue d’ISLY où l’on voit l’Armée française tirer sur une centaine de manifestants pieds-noirs qui défilaient dans les rues faisant une trentaine de victimes. 3 juillet 1962 : Proclamation de l’indépendance après un référendum organisé une seconde fois uniquement en métropole qui donnera 90 % de votes favorables à l’indépendance. Cette date du 3 juillet sera déplacée par la suite au 5 juillet, jour anniversaire de la rentrée des troupes françaises dans Alger en 1830.
C’est le début de la grande panique, le point de départ de l’exode massif de la population pied-noir dans des conditions déplorables. Le gouvernement de l’époque n’admettait pas cet exode et ne fit rien bien au contraire pour faciliter le départ de toutes ces personnes, pas d’avions, pas de bateaux, aucune structure d’accueil en métropole à l’exception des associations caritatives traditionnelles, Croix-Rouge, Secours Catholique, etc... Ce fut le KOSOVO avant l’heure sans la boue, mais avec la soif et le soleil en plus et au cœur de ces compatriotes le sentiment d’être mal acceptés dans leur propre pays.
En 1954 il y avait 984 000 Pieds-Noirs recensés, il n’en restait pas 20 000 à la fin de l’année 1962. Cela veut dire qu’en l’espace de quelques mois 850 000 d’entre eux étaient rentrés en France, 100 000 avaient préféré l’Espagne ou le Canada et qu’une majorité de Juifs avaient émigré en Israël.
Il faut ajouter à ces chiffres les 10/15 000 HARKIS ou supplétifs indigènes soit environ 60 000 personnes avec leurs femmes et enfants, rapatriés clandestinement malgré les consignes formelles du Gouvernement. C’est la honte de la France d’avoir abandonné aux mains de leur pire ennemi ceux qui l’avaient fidèlement servie. Nous en reparlerons tout à l’heure. Ces 60 000 HARKIS ont été parqués dans des camps soi-disant provisoires sans que leur soit proposé un travail ou la possibilité de s’intégrer dans la communauté française. Certains y sont encore aujourd’hui, et pendant ce temps on s’en allait chercher des travailleurs au Maroc ou en Afrique noire pour faire tourner nos usines... ! Voici le bilan de cette guerre, il est tiré des documents du Ministère des Armées en date de 1994. Ces chiffres sont à considérer comme des minima. Côté français : 70 000 blessés et un peu moins de 30 000 morts dont 1 000 portés disparus, auxquels il faut ajouter la disparition entre mars et décembre 1962, c’est-à-dire après le cessez-le-feu, de 5 à 10 000 Pieds-Noirs dont on n’a jamais retrouvé pour eux non plus ni les corps ni la trace.
Côté algérien : # 300 000 morts selon les sources françaises, plus d’un million selon les sources algériennes ! la vérité se situe probablement entre ces deux chiffres et les spécialistes avancent aujourd’hui le chiffre de 600 000 victimes pour une population estimée à l’époque à # 8 000 000 de personnes. Elles se répartissent de la manière suivante : # 150 000 tués au combat au cours des affrontements avec les forces militaires. # 150 000 à la suite de règlements de comptes entre bandes rivales ou partis politiques opposés (M.N.A et F.L.N). Des combats fratricides se déroulèrent entre ces deux mouvements et des charniers qu’on aurait bien voulu rendre responsable l’Armée française ont été découverts quelques années plus tard. Dans ce chiffre sont également comptabilisées les victimes de l’élimination systématique de tous ceux qui manifestaient leur sympathie pour la France, anciens combattants, gardes champêtres ou ouvriers agricoles... assassinés avec la même sauvagerie que celle pratiquée encore aujourd’hui par les groupes islamistes (G.I.A en particulier). # 150 000 harkis, moghzanis et autres supplétifs suppliciés comme au moyen-âge, massacrés dans des conditions inimaginables après le départ des troupes françaises en juillet 1962. Parmi ceux-là un certain nombre que j’ai connus et que j’estimais particulièrement. # 150 000 disparus sans que l’on sache très bien de quel côté ils se situaient. Ce chiffre peut paraître exagéré, mais vous verrez tout à l’heure pour quelles raisons il est tout à fait plausible (absence d’état civil). Enfin sachez qu’environ 2 000 000 de jeunes Français appelés du contingent ont fait un séjour plus ou moins long en Algérie durant cette guerre, la plupart d’entre eux pour y assurer le quadrillage du terrain. Il y en avait 450 000 au plus fort des années de guerre : 57/58/59.
À partir de 1960 on pouvait considérer que la guerre avait été gagnée par l’Armée française. Sur le plan militaire, il n’y avait plus d’infiltrations aux frontières marocaines et tunisiennes, les barrages électrifiés étaient devenus très efficaces et les bandes rebelles réfugiées dans les djebels de l’intérieur avaient été décimées. Une sécurité relative régnait sur l’ensemble du territoire, toutes les voies de communication avaient été réouvertes, mais le pays n’était pas pour autant pacifié, le terrorisme n’avait pas été extirpé, une guerre de guérilla avait pris la relève : attentats, mines, incendies....
Tandis que sur le plan international et diplomatique la France était mise au ban de la communauté internationale, sur le plan intérieur les prises de position se radicalisèrent.
En 1962 un certain nombre de nos compatriotes se réjouirent de cette issue et de l’indépendance accordée au peuple algérien, pour eux en effet la chaîne du boulet de la colonisation venait d’être brisée.
Pour d’autres au contraire cet échec était grave et lourd de conséquences : l’exode de la population pied-noir, la perte du Sahara avec ses richesses prometteuses de gaz et de pétrole, la crise morale sans précédent dans l’Armée furent très mal vécus et certains d’entre eux ne l’acceptèrent jamais. TOUS cependant s’accordèrent pour OUBLIER.
Le monde politique d’abord, le peuple français dans sa grande majorité y compris les appelés du contingent, l’Armée et même les Algériens pour des raisons différentes sont tombés d’accord pour tourner la page au plus vite. On ne voulait pas remuer la boue ni d’un côté ni de l’autre, les uns rentrèrent dans une période de croissance économique sans précédent qui facilita l’oubli, les autres s’entretuèrent pour le pouvoir pendant un certain temps puis se mirent à l’ouvrage.
Mais le deuil de l’Algérie n’avait pas été fait, et c’est pour cela que de temps en temps des éruptions urticantes se manifestent. Tant que la lumière n’aura pas été faite par les historiens en toute objectivité sur cette période douloureuse de notre histoire et sur ces évènements qu’on a cherché à occulter, tant que l’abcès n’aura pas été crevé, des miasmes remonteront en surface. Voilà pour les généralités. Voici maintenant mon témoignage, ma vérité.

- Les Wilayas de l’ALN découpage de 1956
Je débarque à Alger fin août 1958 quelques mois seulement après le coup d’État et la prise par l’Armée de tous les pouvoirs civils et militaires. Sur place c’est encore l’euphorie, manifestations quasi quotidiennes de fraternisation dans la rue, défilés d’anciens combattants avec drapeaux en tête, création de comités de Salut Public dans tous les quartiers de la ville avec la participation active des indigènes. C’était partout la joie, la fête, car le retour aux affaires du général De Gaulle laissait présager une paix prochaine. Je reste persuadé qu’une belle occasion de faire la paix a été gâchée à ce moment-là. Par la suite hélas il y eut beaucoup d’autres occasions manquées par les uns et les autres...
J’arrivais du Maroc où je venais de passer 2 ans au 1er Régiment de Spahis marocains comme sous-lieutenant chef de peloton d’E.B.R. (Engins Blindés de Reconnaissance) - je suis de formation A.B.C. (Arme Blindée Cavalerie) - pendant lesquelles j’avais patrouillé dans tout le sud marocain entre Marrakech, Agadir, Taroudant, Ouarzazate, (des noms qui disent quelque chose aux touristes d’aujourd’hui) avec mes engins blindés pour empêcher les nouvelles recrues algériennes de se constituer en unités combattantes sur le territoire marocain et les gêner dans leurs déplacements vers leurs zones de combat en Algérie. Sans aucun succès. Je n’ai pas vu le moindre chèche d’un seul fellagha durant toute cette période, les camps de formation et d’entraînement se situaient beaucoup plus au nord dans la région d’Oujda ou beaucoup plus au sud vers Colomb-Bechar et les territoires sahariens.
À la fin de mon séjour au Maroc j’aurais pu comme tout militaire qui passait 2 ans outre-mer me faire affecter dans un régiment en France ou en Allemagne. J’ai préféré me porter volontaire pour l’Algérie. Je voulais me battre, un officier c’est fait pour ça, gagner des médailles, des galons que sais-je encore, et je voulais surtout participer à ce grand effort de « pacification » entrepris alors par l’Armée et auquel personnellement et très sincèrement je croyais.
J’ai demandé à être muté au Service des Affaires Algériennes, c’est-à-dire les S.A.S. Je vous dirai tout à l’heure ce qu’étaient les S.A.S. La tache y était passionnante le fait qu’elle y fut également dangereuse ne me déplaisait aucunement. (Il faut savoir que, mises à part les troupes aéroportées, parachutistes, Légion Étrangère, commandos de marine... qui ont mené les combats au corps à corps sur le terrain et qui ont eu un nombre très élevé d’officiers et de sous-officiers tués au combat, c’est tout de suite après dans les S.A.S, où toutes proportions gardées il y a eu le plus grand nombre de morts parmi les officiers victimes d’attentats individuels pour la grande majorité d’entre eux, plus de 100 morts). Je passe 2 mois à Alger au siège du Gouvernement Général (G.G) pour suivre un stage de formation accélérée, cours d’administration générale, rudiments de langue arabe, connaissance de l’Islam, action psychologique auprès des populations... etc... À la fin du stage je reçois ma deuxième barrette et c’est comme Lieutenant que je me présente aux Affaires Algériennes d’Oran, où je me porte aussitôt volontaire pour le sud. Pourquoi le sud ? D’abord parce que je venais de goûter aux grands espaces du Sud marocain et que cela m’avait plu et confidentiellement je vous avouerais que le désert m’avait toujours attiré. Mes rêves d’adolescent me transportaient souvent au Sahara chevauchant à la tête d’une compagnie méharienne. Auparavant je dus accomplir un autre stage pratique celui-là dans une S.A.S récemment créée à l’est de Sidi Bel Abbés dans une région de productions agricoles au pied des massifs de l’Ouarsenis, au lieu-dit Boudjebaa. Cette S.A.S était reconnue exemplaire, son chef par la suite fit une très belle carrière militaire. J’y suis resté un mois environ pour y apprendre sur le tas mon métier, contact avec les élus, les associations, démarches auprès des organismes administratifs.... et aussi à ma demande participation avec les unités combattantes du secteur aux opérations de ratissage qui s’y déroulaient. J’avais hâte de subir l’épreuve du feu, d’entendre les balles siffler sur ma tête. J’étais comme ça, je n’y peux rien.
Je n’ai pas vu le moindre fellagha au cours de ces opérations, mais c’est là par contre, où j’ai fait connaissance avec la rébellion et le terrorisme et que j’ai vu les atrocités commises par ces massacreurs d’en face qui faisaient de la terreur et de la barbarie leur arme de guerre privilégiée. J’ai vu de mes yeux des fermes de colons brûlées dans la nuit et découvert en arrivant aussitôt sur les lieux les ouvriers agricoles indigènes, qui gardaient la ferme pendant l’absence de leurs patrons réfugiés en ville pour la nuit, morts égorgés, membres amputés, les femmes violées, le bétail abattu à l’arme blanche et croyez-moi un tel spectacle dans la nuit et l’insécurité environnante vous fait passer des frissons dans le dos.
C’est au cours de ce stage également que j’ai vu pour la première fois, et cela aussi m’a fait un choc terrible, fonctionner la « gégène » électrique c’est-à-dire pratiquer la torture. On en reparlera tout à l’heure.
Quand je reçois mon affectation, je suis tout heureux d’apprendre que je dois rejoindre dans les plus brefs délais la Division militaire de Méchéria, à 200 kilomètres plus au sud dans les territoires pré-sahariens, pour être mis à la disposition de l’administration civile locale.
J’arrive à Méchéria fin novembre 1958, le Général qui me reçoit m’adresse illico au Commandant Filippi, officier des Affaires Sahariennes qui occupait à titre provisoire la place de l’administrateur civil évincé quelques mois plus tôt. On m’y attendait. Je passe plusieurs jours sur place dans les bureaux pour y étudier les dossiers économiques et sociaux de la région, car on vient de me confier la création d’une S.A.S, la première de la région, dans un endroit situé à 30 kilomètres plus au nord en pleine brousse. Je dois m’y rendre dans les meilleurs délais, le lieu s’appelle EL BIOD, la blanche.
Une jeep toute neuve, un chauffeur, un pistolet automatique sont mis à ma disposition dans l’attente d’une livraison d’armes et de matériel qu’on me promet pour bientôt. Et en avant…. L’aventure pour moi allait vraiment commencer !

- Le Lt Beraud
C’est le moment de faire le point et avant d’aller plus loin, de répondre à 2 questions que vous devez certainement vous poser : 1) une S.A.S c’était quoi ? 2) quelle était la situation générale à mon arrivée sur zone ? S.A.S : SECTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE.
Les S.A.S étaient des centres administratifs avancés, implantés dans les lieux les plus reculés du territoire, là où l’Administration même avec un « petit a » avait été jusqu’alors négligée voire inexistante. Créées en 1956 par le service des Affaires Algériennes elles étaient dirigées par des officiers et se flattaient d’être « le cœur de la France qui battait dans chaque douar » comme l’a dit un jour celui qui en avait été l’inspirateur.
Tous les historiens aujourd’hui le reconnaissent, elles ont accompli dans leur ensemble un travail considérable, remarquable et ont joué un rôle essentiel dans ce qu’on a appelé la PACIFICATION. Elles ont par leur présence sur le terrain, leurs activités au plus près des populations isolées considérablement contrecarré l’implantation de l’O.P.A. ennemie (Organisation Politico Administrative) qui cherchait par tous les moyens à les contrôler et à les maintenir sous sa coupe.
C’est à l’officier chef de S.A.S. qu’était confiée la tâche de régler les litiges entre les familles, d’apaiser les querelles de voisinage ou de pâturages appelées « chikayas », de faire bénéficier les anciens combattants des pensions auxquelles ils avaient droit, d’ouvrir des chantiers, de créer des centres d’apprentissage, des maisons de jeunes, de distribuer les secours de première urgence...,etc.„.etc.... Et cela en plus des trois missions essentielles qui leur avaient été dévolues et qui sont restées les mêmes du début jusqu’à la fin : le contrôle de la population : recensement, déplacement, état d’esprit, collecte de renseignements.... L’aide médicale gratuite accessible à tous, Et la scolarisation du plus grand nombre par l’ouverture de classes partout où les besoins se faisaient sentir.
Tâche immense, exaltante à bien des égards et tout à fait dans l’esprit d’une stratégie de pacification voulue et mise en place par l’Armée pour pallier la déficience des pouvoirs publics en ce domaine après la suppression des Bureaux Arabes sous la Illème République.
Personnellement il m’incombera en plus une autre tâche tout aussi passionnante, celle de créer à partir de rien une commune avec ses bâtiments administratifs, ses conseillers municipaux élus et son maire, son budget de fonctionnement et tous les services qui s’y rattachent. J’y reviendrai.
Deuxième interrogation : quelle était la situation d’ensemble à mon arrivée sur les lieux ?
Au plan géographique et climatique, c’est le SUD ! C’est le bled, c’est la steppe comme il l’est écrit sur cette carte. La région est un vaste territoire pré-désertique de hauts plateaux, entre 1000 et 1200 mètres d’altitude, qui relie deux massifs montagneux l’Atlas Tellien au nord, l’Atlas Saharien au sud. Dans les dépressions de terrain qu’on appelle « Chotts » se déversent les oueds qui ne vont jamais à la mer, ce sont des lieux de mirage par excellence, on s’y croirait au bord d’un lac alors qu’il n’y a pas une seule goutte d’eau en surface. Quelques sommets dénudés dans le lointain, sinon RIEN à l’horizon, jusqu’à 20 ou 30 kilomètres la platitude totale et la voûte du ciel à 180°. Pas un arbre, aucune ombre, le silence !
Il y fait chaud, très chaud dans la journée et les nuits sont fraîches. Un vent de sable qu’on appelle « chergui » ou « sirocco » selon qu’il souffle de l’est ou du sud soulève une poussière fine qui s’infiltre partout. Des scorpions sous les pierres, quelques vipères à sonnettes, des gazelles et des chacals en grand nombre et des mouches par milliards.
Une seule route récemment goudronnée et une voie ferrée appartenant aux Chemins de Fer Algériens la traversent du nord au sud. Partout ailleurs ce ne sont que pistes poussiéreuses et non entretenues. L’unique centre attractif de toute cette région c’est Méchéria, ancienne redoute construite par LYAUTEY au tout début du siècle dernier devenue petite ville 100% arabe de 3000 à 4000 âmes et lieu du marché hebdomadaire. Outre les militaires qui s’y étaient installés n’y résidaient qu’une petite dizaine de Français de souche européenne (F.S.E) : personnel administratif, employés du chemin de fer, commerçants ou boutiquiers, la plupart d’entre eux d’ailleurs interdits de séjour en métropole.
ORAN est à 350 kilomètres, SAIDA la petite ville européenne la plus proche à 150 kilomètres et COLOMB-BECHAR dans le grand sud à plus de 250 kilomètres. Bref c’est le bled, si vous avez vu le film « Fort-Saganne », c’est « Fort-Saganne »…. ! Au plan socio-économique, deux uniques ressources permettaient à une population 100 % nomade d’y survivre : le ramassage de l’alfa, cet alfa avec lequel on fabriquait le plus beau papier du monde, mais aussi plus prosaïquement de la ficelle ou des semelles d’espadrilles. À cette époque pour des raisons faciles à comprendre, toute exploitation était arrêtée. et I ’élevage par nomadisme pastoral. De maigres troupeaux de moutons, de chèvres, quelques dromadaires, l’indispensable bourricot et le cheval pour les chefs de famille fortunés, se déplaçaient çà et là au gré des pluies, à la recherche des meilleurs pâturages. Quelques puits assuraient l’approvisionnement en eau, encore fallait-il savoir où ils se trouvaient. Au printemps quand les pluies le permettaient quelques-uns de ces nomades se faisaient agriculteurs et semaient des céréales de blé dur dans les légères dépressions du terrain pour récolter avant l’été. Le rendement était décevant, les quelques quintaux recueillis réservés à la fabrication des galettes « kesras » étaient stockés en terre dans des trous creusés qu’on appelait « matmoras » dont l’ouverture étroite était camouflée par une touffe d’alfa et qui allaient devenir plus tard des caches idéales pour les fellaghas.

- Le regroupement des tentes, vu d’en bas
Ces nomades vivaient sous des tentes appelées « khaïmas » fabriquées avec la laine des chèvres ou mieux encore les poils des dromadaires. Ils vivaient en tribus qui ne se mélangeaient guère, chacune de ces tribus ayant son territoire de pâturage assez bien délimité et son chef qui était selon l’importance de la tribu ou selon les services rendus à l’administration : Caïd, Agha ou Bachaga. Vous avez entendu parler du Bachaga Boualem. Au plan administratif, là aussi c’était le désert ! L’Algérie des années 50 malgré la Loi-cadre votée en 1947, mais qui n’avait pas encore été mise en application vivait sous les Lois de la Illème République. Cela voulait dire, qu’à cette époque le territoire algérien était divisé en deux, le SAHARA constituant par ailleurs une entité administrative différente avec un statut particulier. Il y avait les Territoires du nord découpés en 9 départements copies conformes à ceux de Métropole, avec leur préfecture, sous-préfectures, communes, et leurs députés élus selon la Loi du double collège, c’est-à-dire un député F.S.E (Français de Souche Européenne) pour un député indigène F.S.N.A (Français de Souche Nord-Africaine), malheureusement très peu d’indigènes avaient la nationalité française à cette époque, 100 000 tout au plus.
Et les Territoires du sud, ceux qui nous intéressent aujourd’hui où le statut de l’indigène était toujours en vigueur, qui étaient administrés par des Communes Mixtes. Méchéria était le centre d’une de ces communes mixtes, on y trouvait un administrateur civil avec 2 ou 3 autres fonctionnaires ventripotents plus ou moins compétents, parfois même mutés disciplinaires et une poignée de gendarmes et de supplétifs. C’était tout.... ! Ces communes mixtes avaient la charge de contrôler et d’administrer 20 000, 30 000, voire 40 000 nomades éparpillés sur un territoire aussi vaste qu’un département français.
C’était aux chefs des tribus c’est-à-dire aux Caïds qu’était confiée la charge d’administrer ces populations : collecter l’impôt, ils le faisaient d’ailleurs très bien en se servant au passage et pourvoir au recrutement de l’Armée. C’était pratiquement tout ce qu’on leur demandait. Pour le reste, quelques écoles coraniques étaient ouvertes par-ci par-là, un « taleb » y faisait réciter les versets du Coran à quelques élèves préalablement choisis. L’état civil des familles les plus riches ou les plus influentes était tenu par les « cadis », lettrés musulmans qui rendaient également la justice selon les préceptes du Coran. Un médecin pour 30 000 habitants et un vétérinaire qui ne descendait d’Oran qu’à la demande.
Voilà ce que j’ai trouvé en arrivant, on a peine à le croire aujourd’hui, mais c’était le sud et il y a de cela 50 ans.
Ces populations nomades qui vivaient comme au temps de Jésus, éloignées des principales voies de communication et de la civilisation occidentale ont été les dernières à rentrer en rébellion, comme elles avaient été les dernières à être pacifiées autour des années 1900. (Lisez le livre d’Edmonde Charles-Roux qui raconte l’aventure d’Isabelle Eberhard). Au plan militaire, Méchéria était également le centre de tout le dispositif militaire de cette région, l’État-Major d’une division s’y était installée, environ 30 000 hommes. La mission de cette division était triple : La première : assurer la sécurité des voies de communication, essentiellement la route et la voie ferrée. J’ai connu des appelés du contingent qui ont passé 2 ans dans cette région à ne faire que l’ouverture des voies chaque matin, pour y débusquer les mines ou y réparer les sabotages commis pendant la nuit. Pas drôle.... La deuxième : détruire les unités rebelles importantes et bien armées retranchées dans les montagnes en particulier dans les monts Ksour et le djebel Amour, où se sont déroulés de violents combats entre des « katibas » d’une centaine de fellouzes et les unités de légionnaires parachutistes. Et parallèlement neutraliser les petites bandes de rebelles qui, en plaine, menaient des opérations incessantes de harcèlement et de sabotages contre les postes militaires ou la population : enlèvements, assassinats, exactions de toutes sortes. La troisième : empêcher toute infiltration de nouvelles troupes en provenance du Maroc. Cela par la mise en place tout au long de la frontière algéro-marocaine d’un barrage électrifié de 40 000 volts (qu’on appelait ligne Morice à ses débuts). Ce barrage de 3 mètres de hauteur, protégé de chaque côté par un réseau de barbelés et des champs de mines, doublé voire triplé dans les passages à risque était surveillé jour et nuit par des patrouilles de blindés et contrôlé par des radars puissants installés tous les 20 kilomètres au long de son parcours. Parallèlement à ce barrage avait été instaurées et bien délimitées des zones strictement interdites à toute population, afin de permettre à l’aviation et à l’artillerie d’ouvrir le feu sans sommation sur tout ce qui bougeait ou s’y déplaçait. Combien de troupeaux d’antilopes ou de dromadaires ont été écrasés aveuglément sous des tirs d’artillerie.... !
En conséquence de quoi toutes les tribus nomades qui traditionnellement se déplaçaient dans ces zones devenues interdites en avaient été chassées manu militari au cours des mois précédant mon arrivée et regroupées dans des camps qui, il faut bien le reconnaître, étaient des véritables petits camps de concentration pour des nomades. MAO a dit un jour : « le meilleur moyen pour prendre le poisson c’est de vider l’eau du bocal ». C’est sûr qu’en vidant de leur population de grandes étendues territoriales, le déplacement des fellaghas qui n’y trouvaient plus ni aide ni subsistance devenait beaucoup plus problématique, mais cela créait par ailleurs de nombreux autres problèmes.
C’est dans l’un de ces camps, il y en avait 3 dans le secteur, installé à EL BIOD que je suis affecté pour y créer une S.A.S. Il y avait là plus de 1 200 familles, autant de khaïmas appartenant à 3 tribus différentes, au total plus de 10 000 personnes, un point d’eau important et une petite gare désaffectée dans laquelle s’était installée une section d’un régiment d’infanterie de marine (la coloniale) commandée par un Lieutenant. J’y fus fort bien accueilli, je m’y installai du mieux que j’ai pu le temps nécessaire à la construction des bâtiments qui devaient m’abriter avec mon personnel. J’y suis resté 4 mois environ.
Voilà l’environnement dans lequel je me suis trouvé brutalement plongé, il était indispensable que je vous le décrive avec tous ces détails pour que vous puissiez vous rendre compte des difficultés qui m’attendaient et de la tâche immense à laquelle je devais me consacrer.
Je me suis beaucoup investi dans cette tâche, sans doute me suis-je pris un peu trop au sérieux. J’ai vécu ces années intensément, passionnément, elles ont bouleversé ma vie. Je voulais vraiment aider ces populations déshéritées à sortir de leur moyen-âge. Elles me rappelaient les paysans d’autrefois de nos campagnes, et mon côté missionnaire prenait parfois le dessus sur mon côté guerrier. Elles m’avaient bien accepté, me respectaient, me craignaient, malheureusement je m’en suis très vite rendu compte, pas autant que les quelques fellouzes qui rôdaient dans les parages et qui leur imposaient une implacable terreur. Car le danger, même si on ne le voyait pas, était perpétuellement présent. Pendant 4 ans, tout particulièrement les 2 premières années (1959/1960) j’ai vécu dans une insécurité de tous les instants. Je ne me déplaçais que protégé par 1 ou 2 supplétifs indigènes chargés de ma sécurité (Moghzanis). Je dormais avec mon pistolet sur la table de nuit et le pistolet- mitrailleur sous mon lit à portée de main.
Un jour un guet-apens fut mis en place pour m’assassiner à l’occasion d’un de mes déplacements dans le regroupement. Pour des raisons que je ne m’explique toujours pas, je ne suis pas allé ce soir-là là où l’on m’attendait. Je garde précieusement les preuves de ce projet : témoignages et documents classés Al dans le code de la sécurité militaire, donc renseignements recoupés et confirmés.
Une autre fois je peux vraiment dire que j’ai eu la « baraka », un fellouze était là sous la tente où je me rendais. Il a tiré avec son pistolet- mitrailleur, non pas sur moi, mais sur le moghzani qui m’accompagnait et qui y rentrait devant moi. L’arme s’est enrayée.... Sans cela je ne serais sûrement pas là aujourd’hui pour vous raconter cette scène.
Par 2 fois on a placé des mines sur les chemins que j’empruntais régulièrement avec ma jeep, et là encore j’ai eu la « baraka », il était écrit que je ne devais pas mourir là-bas.
La première fois c’était un dimanche matin, je me rendais à la messe à Méchéria tous les dimanches matin. Toujours pressé j’empruntais le chemin le plus direct, le plus habituel. C’est un employé des chemins de fer qui ce matin-là reconduisait sa femme et son fils à Saïda venus passer exceptionnellement le samedi en sa compagnie qui a sauté sur la mine, à peine trente secondes avant le passage de ma jeep.
Son véhicule, une 4CV, avait été projeté à plus de 5 mètres du lieu de l’explosion, le conducteur mort accroché à son volant, son fils légèrement blessé, hagard, hébété criait et pleurait à chaudes larmes dans la partie arrière du véhicule défoncé et sa femme à quelques pas de là gisait et agonisait dans une mare de sang, les deux jambes volatilisées, deux moignons sanguinolents en charpie à hauteur des cuisses. Spectacle horrible. Cette mine, c’est sûr, m’était spécialement réservée, elle avait été placée là pendant la nuit et j’étais toujours le premier le dimanche matin à emprunter ce chemin.
La seconde fois c’est un GMC, camion transporteur de troupes, du poste militaire voisin qui par pur hasard l’a prise à ma place. J’étais passé sur cette mine avec ma jeep de nombreuses fois sans m’en rendre compte et quelques heures encore avant l’explosion. Cette mine également m’était réservée, j’étais pratiquement le seul à emprunter cette mauvaise piste qui me permettait de rejoindre directement la route goudronnée à partir de mon bureau.
J’ai toujours gardé depuis cette époque une hantise et la phobie des mines. J’ai eu un camarade gravement blessé par l’explosion de l’une d’elles. Pendant mes permissions et même longtemps après mon retour en France, je les cherchais sur les bas-côtés de la route quand je conduisais, et j’en faisais des cauchemars la nuit.
Climat d’insécurité encore. Par 3 fois il m’a fallu riposter aux fusillades nocturnes des bâtiments dans lesquels nous étions logés. Pas bien méchants ces harcèlements, mais tout de même pour le moins désagréables, quelques blessés légers, plusieurs chevaux tués.
Une seule fois j’ai eu la chance si je peux dire d’affronter en combat franc et régulier avec mes moghzanis et la section de la Coloniale qui m’accompagnait une bande de rebelles dont j’avais obtenu la localisation sur renseignements : 18 fellaghas au tapis, autant d’armes récupérées, 1 seul prisonnier. Pour ce fait d’armes j’ai obtenu la Croix de la Valeur Militaire, été cité à l’ordre de la division. Du beau travail ! Du moins c’est comme çà que je voyais les choses à cette époque. Mais ce fut exceptionnel !
La plupart du temps je n’étais confronté qu’aux actions individuelles commises par ces fellaghas terroristes qui enlevaient, assassinaient, particulièrement ceux qui s’affichaient ostensiblement à nos côtés et avec lesquels j’essayais de rétablir le dialogue.
Ce fut cela l’une des principales difficultés de ma tâche. Comment ramener la confiance, comment reconquérir la sympathie de ces hommes et des ces femmes qui ne demandaient que ça dans leur grande majorité, comment pacifier quand en permanence rôdent la menace d’un vol de troupeaux, d’un égorgement de berger, d’un enlèvement de quelque notable commis par ces bandits qui se cachaient le jour au moindre danger dans les touffes d’alfa ou mieux encore dans les matmoras creusées dans le sol impossible à repérer dans cette immensité sans un renseignement précis, et qui la nuit se déplaçaient à leur gré sur un vaste territoire qu’ils connaissaient parfaitement. Ces hommes étaient peu armés, mais fortement politisés, fanatisés, ils ne faisaient preuve d’aucun sentiment envers leurs coreligionnaires, ne respectaient pas les lois de la guerre bien au contraire et montraient dans leurs représailles ou leurs tueries beaucoup de barbarie et de sauvagerie…
…Alors que de notre côté, malgré tous les efforts menés sur le terrain par les unités militaires (patrouilles, embuscades, surveillances aériennes...) conjugués aux miens dans le domaine de la connaissance des lieux, des hommes, et par celui du renseignement, nous ne sommes jamais parvenus à neutraliser.
C’est là toute la difficulté de la lutte anti-guérilla. Comment faire ? .... Oui comment faire dans une telle situation quand le renseignement devient primordial ? Je répondrai qu’on est tenté de l’obtenir par tous les moyens. Et c’est ce que j’ai fait à plusieurs reprises. Aujourd’hui, je l’avoue et le confesse volontiers, il m’est arrivé peut- être 7 ou 8 fois, dans des circonstances particulières, des moments d’excitation intense ou au contraire de découragement ou de désespoir, il m’est arrivé de pratiquer sur des suspects des interrogatoires musclés, doux euphémisme, ou plus souvent d’autoriser que l’on pratique sur eux des actes hautement répréhensibles que je réprouve totalement aujourd’hui sans arriver vraiment à les regretter.
Je ne cherche pas d’excuse sinon celle peut-être de l’isolement et du danger, mais je me pose encore la question : ces pratiques-là étaient-elles justifiées et comment moi, le bon élève des frères de Saint-Gabriel, éduqué dans une morale stricte, formé à la discipline militaire rigide, chrétien pratiquant, humaniste convaincu, comment en suis-je arrivé à laisser faire cela, ne serait-ce qu’une seule fois ? Je ne me l’explique toujours pas, mais le fait est là. Aujourd’hui je suis sûr d’au moins deux choses : la première, c’est que l’homme même le plus civilisé mis dans un environnement propice retrouve très vite ses instincts les plus primaires, les plus bestiaux, qui ne sont peut-être d’ailleurs que des instincts de survie « tuer ou être tué », et qu’il faut être un homme hors du commun, certains l’ont été, pour y résister. Cela il ne faut jamais l’oublier.
La deuxième c’est qu’il n’y a pas de guerre propre, sinon celle que l’on imagine dans les bureaux d’Etat-Major ou le cerveau des intellectuels illuminés. La « guerre en dentelles », la guerre chevaleresque sont des légendes, pas des réalités. On voudrait humaniser la guerre, quelle utopie, quelle hypocrisie ! Il faut TOUT faire pour prévenir une guerre, car il faut savoir quand par malheur elle est déclenchée, que TOUT peut arriver, le pire y compris.
C’était comme ça hier, c’est comme ça aujourd’hui et nous en avons des exemples tous les jours sous nos yeux, et ce sera ENCORE comme ça demain !!! Du moins c’est mon avis, mais vous avez le droit de ne pas le partager.
Une autre question mérite d’être abordée, car elle est mal connue et pas bien comprise, c’est celle des « HARKIS » ou des « MOGHZANIS », c’est la même chose.
Pour réaliser les projets que je mettais chaque jour en chantier, je les rappellerai brièvement à la fin de cet exposé, je devais m’entourer de collaborateurs les plus divers, chauffeurs, interprètes, maçons, secrétaires, chefs de chantier, etc... Il me fallait aussi et surtout recruter des supplétifs pour assurer ma protection celle des personnes qui vivaient à mes côtés ou qui allaient bientôt me rejoindre, j’entends par-là ma femme et le petit Stéphane.
Je les recrutais de préférence parmi les anciens militaires, les anciens de l’ex-commune mixte, ou tout simplement parmi les volontaires ou les plus délurés de la population locale. Après les avoir équipés, instruits, j’ai réussi à constituer une troupe en armes de 30 hommes (Moghzanis) dont 20 à cheval, rémunérés par mes soins, encadrés par un sous-officier « mokkadem » et 5 caporaux issus de leurs rangs.
Ces hommes-là m’ont toujours servi loyalement jusqu’à la fin. Ils ont monté la garde pendant que je dormais et m’ont protégé dans mes déplacements, chacun d’eux ayant eu 100 fois l’occasion de me faire la peau avant de rejoindre l’ennemi. Ils ne l’ont pas fait, seuls 2 d’entre eux le 18 marsl962, la veille du cessez-le-feu, ont déserté avec armes et munitions. Une patrouille de la Légion Étrangère a retrouvé leurs corps un mois plus tard dans le djebel. Ils avaient été exécutés probablement parce que l’apport de leurs armes n’avait pas été jugé suffisant pour obtenir leur pardon.
Par contre moi, ces hommes que j’avais recrutés, que j’avais « mouillés » à mes côtés et aux côtés de la France, je les ai abandonnés en juin 1962 quand j’ai dû quitter la S.A.S quelques jours avant l’indépendance.
Je les ai abandonnés à leur triste sort sur ORDRE alors qu’ils ne demandaient qu’à partir, (circulaire ministérielle signée Louis Joxe datée de mai 1962 qui interdisait formellement aux officiers S.A.S sous peine de graves sanctions de rapatrier leurs moghzanis, les menaçant de les renvoyer en Algérie dès leur débarquement en Métropole) Pour certains d’entre eux cela fût fait. Quelle honte !

- La SAS d’EL BIOD
- Second plan : écoles. Au centre mairie en construction. Château d’eau
Je les ai abandonnés malgré les promesses que je leur avais faites personnellement, individuellement, quelques semaines plus tôt les assurant avec toute l’autorité que je représentais à leurs yeux que jamais la France ne les laisserait à la merci de leur pire ennemi !
Et oui ils y ont cru ! ... Et nous aussi on y a cru et laissé croire jusqu’au bout que jamais, jamais l’Armée française ne partirait d’ici et qu’il était pour le moins inconcevable qu’elle le fasse dans la honte et le déshonneur !
Quelques-uns de ces moghzanis, je l’ai appris plus tard, ont été atrocement mutilés, torturés avant d’être exécutés, ébouillantés ou écorchés vifs. Ils avaient choisi la France c’était leur seule faute. Tous les autres ont été emprisonnés puis condamnés à déminer le barrage électrifié, un certain nombre d’entre eux a été volatilisé par l’explosion des mines, les autres plus tard ont été enrôlés de force dans l’Armée du Polisario pour combattre les Marocains.
Sur la cinquantaine de moghzanis et de collaborateurs civils indigènes de la S.A.S, seuls une dizaine a réussi à rejoindre la France grâce à la Légion Étrangère qui, elle, n’en faisait qu’à sa tête, n’obéissait qu’à ses chefs et se moquait bien des circulaires ministérielles de ce genre. Elle en avait les moyens, pas moi.
Drôle de façon de remercier ces fidèles compagnons d’armes, ils avaient choisi le mauvais camp c’est sûr, mais ils avaient confiance en nous, en moi et JE les ai trahis !
Avant d’engager le débat j’aimerais vous énumérer le plus brièvement possible mes réalisations et vous dire en quoi consista concrètement mon boulot pendant ces 4 années.
Dans le domaine administratif par exemple :
mise en place et tenue à jour d’un État civil qui n’avait jamais existé sinon dans les tablettes des cadis, naissances, mariages, décès, attributions de noms patronymiques à ceux qui n’en avaient pas, les personnes s’appelant par leur prénom suivi du prénom de leur père et de leur grand-père : Mohammed fils de Cheick fils d’Aïssa. Pour cela il a fallu recenser l’ensemble de la population par famille, par tribu, établir une carte d’identité à chacun d’eux après avoir fait venir d’Oran un photographe professionnel qui a réalisé plus de 4 000 photos et affronté la mauvaise volonté et la réticence de la plupart des familles principalement des femmes voilées.
Recensement également du cheptel, moutons, chèvres, dromadaires, afin d’établir la liste des propriétaires imposables, mais aussi et surtout pour délivrer à bon escient des autorisations de pâturage aux bergers qui gardaient les troupeaux dans les zones sous contrôle. Gare à celui qui n’avait pas son autorisation en règle. Je passais 1 à 2 heures par jour dans mon bureau pour régler les chicayas, écouter les récriminations des uns et des autres, autoriser des déplacements exceptionnels tout en essayant de convaincre et d’obtenir confidentiellement toutes sortes de renseignements exploitables.
La question de l’eau étant vitale il m’a fallu en toute priorité dès mon arrivée prendre contact avec le Service Hydraulique de Sidi-Bel-Abbes pour installer sur les lieux mêmes du regroupement une station de pompage, ériger un château d’eau et aménager des lieux de distribution pour la population et le cheptel. Comme ce service spécialisé ne se déplaçait qu’en avion piper, j’ai dû construire sommairement et rapidement une piste d’atterrissage.
Création, organisation et surveillance du marché hebdomadaire lieu de rencontre par excellence propice à toutes sortes d’activités et contrôle de l’approvisionnement des denrées du début jusqu’à la fin.
Quand en 1960 la commune d’EL BlOD a été créée il m’a fallu organiser les élections, trouver des candidats, le plus difficile, recruter du personnel, établir les budgets de fonctionnement. Comme dans les 2 mois qui suivirent cette mise en place tous les conseillers municipaux avaient disparu, enlevés, assassinés ou partis volontairement, je fus désigner Maire par délégation et le suis resté pendant 2 ans, ce qui m’a permis de célébrer plus de 50 mariages en référence au Code Civil de la Nation.*
Parmi les opérations les plus originales ou les plus spectaculaires qu’il m’a fallu traiter, dont je me souviens : a- Celle d’une invasion de sauterelles suivie quelque temps plus tard d’un déplacement terrestre de milliards de criquets. Ai fait appel pour cela au service spécialisé. b- D’une épizootie dans le cheptel ovin qu’il a fallu enrayée en baignant les troupeaux dans de grandes cuves, dans le bled à la merci des fellouzes. c-D’une plantation d’une pineraie, environ 500 pins d’Alep, après avoir conçu et installé un système d’arrosage par irrigation assez rudimentaire. d-De la création d’une champignonnière grâce à l’aide d’un appelé du contingent champignonniste de profession à Doué la Fontaine, qui me ramenait du mycélium à chacune de ses permissions. Et le crottin de cheval ne manquait pas ! e-Mais le plus réussi fut la réalisation d’un jardin potager à titre expérimental, qui a confirmé ce que l’on savait depuis longtemps, que tout pouvait pousser dans le désert à condition d’arroser abondamment, d’amender intelligemment et surtout de protéger les cultures contre les vents de sable. Ma femme peut vous dire qu’elle a mangé des légumes frais en toute saison quand elle était là-bas. Je fus pour cette réussite proposé pour la médaille agricole…sans suite… ! f-Un autre souvenir qui reste pour moi inoubliable fut l’organisation et l’accompagnement à 2 reprises d’une caravane de dromadaires, chevaux, ânes soit au total plus de 180 bêtes de somme, dans le but de récupérer les céréales stockées dans les matmoras en plein coeur des zones interdites à plus de 40 kilomètres du regroupement, abandonnées sur place dans la précipitation du déménagement. Ce ne fut pas chose facile d’obtenir l’accord des autorités militaires, car beaucoup de risques ont été pris à cette occasion. Dans le domaine de la santé, Après avoir construit et aménagé sommairement un local baptisé dispensaire il m’a fallu programmer les soins, obtenir de l’autorité militaire la mise à disposition d’un médecin qui consultait tous les matins et d’un infirmier appelé du contingent, auquel se joignit très vite très vite une infirmière, aide-soignante, secouriste de la Croix-Rouge que je fis venir de métropole et qui accomplit pendant plus de trois ans un travail remarquable. Toutes les consultations les soins et les médicaments étaient gratuits. Chaque jour une vingtaine de malades se pressaient devant le dispensaire. Belle réussite malgré les ordres de boycott qui se manifestaient par intermittence. Dans le domaine de la lutte conte l’analphabétisme. Les 2 premières années, l’Armée laissa à ma disposition 5 voire 6 instituteurs appelés du contingent, qui le jour faisaient la classe sous la guitoune, leurs élèves assis par terre, l’ardoise sur leurs genoux, et qui la nuit assuraient la protection rapprochée de la S.A.S. Ils faisaient office de caporaux et relevaient les sentinelles, ce qui était pour nous un gage supplémentaire de sécurité. Pour assurer l’approvisionnement de ces classes, je me souviens qu’il fallait parcourir 120 kilomètres à l’aller autant au retour, me rendre à Saïda pour acheter petit matériel et fournitures diverses. Dans un second temps quand furent construits les 2 groupes scolaires en dur comprenant chacun un logement pour un couple et 3 classes aménagées, des instituteurs relevant directement de l’Éducation Nationale y furent nommés. En 1962, à mon départ 4 classes étaient ouvertes avec 4 instituteurs professionnels, plus de100 élèves étaient régulièrement scolarisés. C’était peu pour 10000 âmes et cependant beaucoup compte tenu du lieu et des circonstances. Là également quelques boycotts passagers qui ne duraient jamais longtemps.
Ne serait-ce que pour cela j’ai la satisfaction encore aujourd’hui d’avoir correctement rempli la mission qui m’avait été confiée comme chef de S.A.S et que je rappelais au début de cet exposé : contrôle de la population, AM.G, scolarisation. J’aurais pu certainement mieux faire, car il y avait tout à faire. On me remercia par un très beau diplôme de satisfaction délivré par le Ministère des Armées.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui... ??
Ce qui me prenait beaucoup de temps et me procura énormément de soucis fut de diriger la S.A.S, de faire fonctionner une véritable petite entreprise en plein désert. Des difficultés de toutes sortes se présentaient quotidiennement à moi qu’il fallait régler sur-le-champ. D’abord celles pour la construction des bâtiments et l’installation des locaux : pas d’eau courante sinon un puits, pas d’électricité l’éclairage se faisait à la bougie ou mieux à la lueur d’un camping-gaz, pas de main-d’œuvre qualifiée il fallait former les apprentis maçons, pas de petit matériel ni pelles ni brouettes, madriers, marteaux, etc... qu’il fallait aller chercher à Mecheria soit 60 kilomètres aller-retour, pas de ciment il fallait fabriquer sur place des parpaings en torchis paille et argile mélangées. En contrepartie les crédits étaient largement ouverts et la main- d’œuvre en grand nombre.
Difficultés surtout dans la gestion du personnel et l’organisation de la vie communautaire. Figurez-vous l’isolement, l’éloignement de tout centre de loisirs, le danger permanent, le soleil la chaleur torride en été, le vent de sable éprouvant qui soufflait 3 jours, 6 jours ou 9 jours consécutifs, les mouches par millions que l’on n’arrivait pas à chasser et qui finissaient par vous taper sur les nerfs, le manque de confort des locaux, le manque de femmes pour la grande majorité, de l’alcool anisette et bière BAO qu’il n’était pas question d’interdire, si l’on tient compte plus encore de la personnalité des individus recrutés sur place, la plupart du temps têtes brûlées ou aventuriers, alors imaginez les problèmes que cela pouvait soulever et les conflits inévitables qui surgissaient à la moindre occasion qu’il me fallait régler de jour comme de nuit.
Je rappelle succinctement l’ensemble des personnels que j’ai eu sous mes ordres pendant ces 4 années : 1 adjoint, aspirant ou sous-lieutenant de réserve, j’en ai eu 5, certains se sont beaucoup investis d’autres moins. Parmi eux un futur Père Blanc que j’ai vu à plusieurs reprises un peu « noir ». Également un adjudant- chef, ancien d’Indochine, alcoolique invétéré qui avait décidé de rempiler pour des raisons obscures que j’ai dû renvoyer dans ses foyers au bout d’un mois. 1 sous-officier, sergent ou sergent-chef. J’en ai eu 3 dont un qui s’est suicidé en se tirant une balle de revolver dans la tempe pour une histoire de femme corse jalouse qui voulait rendre son mari jaloux en couchant avec un autre. 1 secrétaire. J’en ai eu 2 relativement âgés, au-dessus de 50 ans dont un excessivement coléreux et l’autre un peu trop porté sur la bière. 1 interprète habituellement pied-noir. Le deuxième sur les 3 que j’ai eu avait un casier judiciaire particulièrement chargé, j’ai dû le remercier aussitôt que je l’ai su. 1 infirmière, recrutée en métropole qui resta plus de 3 ans et fit un travail remarquable. Caractère bien trempé qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. 1 radio, pied-noir pro O.A.S. 1 cuisinier, 4 ou 5 se sont succédé tous anciens légionnaires démobilisés sur place, fortes têtes pour la plupart et qui n’avaient jamais fait la cuisine sinon la leur auparavant. 2 moniteurs-éducateurs qui encadraient les jeunes du regroupement pour des activités sportives, football en particulier. 1 moniteur agricole qui après 2 mois de présence à la S.A.S fit venir toute sa famille qu’il a bien fallu loger. 30 moghzanis dont la moitié avec femmes et enfants qui logeaient à l’intérieur de l’enceinte de la S.A.S. Une vingtaine d’entre eux avec leurs chevaux, d’autres par contre n’étaient pas armés, ils faisaient office de jardiniers, ordonnances... etc... à cela il faut ajouter le personnel de la Mairie, secrétaires, chefs de chantiers, etc... et les instituteurs qui nous ont rejoints par la suite et qui tous vivaient sous ma protection et ma responsabilité.
Voyez la scène et le spectacle ! Un jour, je crois j’écrirai un livre sur tous ces personnages et raconterai leurs aventures dramatico-rocambolesques… Mais comprenez que pour moi elles n’étaient pas toujours drôles.
Les 6 derniers mois furent les plus dramatiques et plus encore la période qui suivit le cessez-le-feu du 19 mars 1962.
Un sentiment de trahison s’était alors propagé parmi les cadres de l’Armée ainsi qu’un sentiment d’abandon doublé de révolte et d’injustice parmi la population pied-noir et les indigènes qui nous étaient restés fidèles.
L’O.A.S commençait à se manifester de plus en plus, le personnel civil de la S.A.S et les instituteurs y prêtaient une oreille attentive et favorable. Je reçus personnellement une lettre du Général Jouhaud un peu avant son arrestation qui m’invitait à le rejoindre, ce que je ne fis pas.
Bientôt à EL BIOD, la S.A.S se trouva totalement isolée, les militaires de la Coloniale nous avaient quittés pour aller renforcer les troupes qui se battaient en ville, car les lieux des combats s’étaient déplacés, c’était dans les villes et non plus dans les djebels où s’affrontaient l’Armée, l’O.A.S, les barbouzes « genre de milices pro-gouvernementales » et les fellouzes.
Des ordres contradictoires commencèrent à me parvenir de partout, même des notes de l’État-Major frappées du sceau de l’O.A.S me demandaient de tout détruire, tout brûler avant de partir, alors que d’autres au contraire directement envoyées par le Gouvernement Général expliquaient que toutes les mesures préventives avaient été prises, que toutes les garanties étaient données par les accords d’Évian et qu’allait débuter demain une coopération nouvelle et durable avec l’Algérie. Bref qu’il fallait avoir confiance alors que sur le terrain l’on se rendait compte que ces accords étaient complètement bidons. Ils ne furent d’ailleurs jamais respectés.
C’était la grande pagaille !
Un jour je reçois l’ordre de désarmer mes moghzanis, tout danger soi-disant écarté la garde de nuit devait être assurée par des sentinelles armées de .... sifflets ! La Légion Etrangère refusa de nous désarmer et je remis moi- même juste avant mon départ les armes au Service du Matériel me réservant en cachette les quelques fusils de chasse et revolvers modèle 93 à barillet, que j’avais récupérés et que je n’avais pas déclarés. Cela m’a permis pendant quelque temps de donner le change.
C’est dans ce climat lourd et malsain que l’État-Major procéda à la mutation de tous les officiers en poste dans les lieux stratégiques. Je reçus mon affectation pour l’Allemagne.
À la mi-juin 1962, je décidai en toute hôte de ramener femme et enfant à la maison, l’environnement devenait trop dangereux, puis de revenir sur place pour passer mes consignes à mon successeur qui venait d’être nommé. Un Breguet deux-ponts, énorme avion de transport réservé aux parachutages en partance pour Oran accepta au tout dernier moment et bien que cela lui était interdit de nous amener dans cette ville. Dès le lendemain un avion d’Air France nous déposait à Marseille, ç’aurait pu être Bordeaux ou Strasbourg, c’était le seul avion à décoller ce jour-là vers la métropole.
A l’aéroport d’Oran l’exode des Pieds-Noirs était déjà bien amorcé. Des centaines, des milliers de femmes, d’enfants, de pauvres gens attendaient sous le soleil, dans la chaleur, depuis des jours voire des semaines un hypothétique avion qui ne venait jamais. Comme je l’ai dit au début de mon exposé c’était le Kosovo avant l’heure. Il faut l’avoir vu pour le croire, quelles détresses, quelles misères, le dénuement le plus total, rien n’avait été prévu pour faciliter leur rapatriement, même au contraire, alors que pour un certain nombre d’entre eux c’était la valise ou le cercueil !
Après avoir déposé femme et enfant à la maison, je revins aussitôt à Oran puis à Saïda, je n’ai pas pu aller plus loin. Sur place tout était désorganisé, les bureaux des Affaires Algériennes de Saïda étaient vides, ils avaient été pillés et le personnel s’était enfui. J’y ai perdu 2 de mes cantines remplies d’affaires personnelles. Quelques véhicules militaires circulaient encore, mais devaient comme tous les autres obtempérer aux contrôles routiers mis en place par nos ennemis de la veille. Quelle humiliation !
Je réussis à remonter sur Oran, le port de la ville brûlait, il a brûlé des jours et des nuits avec des flammes de 50 mètres de hauteur répandant une odeur âcre dans toute la ville. L’O.A.S vraisemblablement y avait mis le feu.
Ça mitraillait de partout ! L’O.A.S abattait systématiquement tout indigène qui s’aventurait dans son périmètre et les Algériens en faisaient tout autant pour les Européens qui pénétraient dans leurs quartiers retranchés. Les C.R.S tiraient sur l’O.A.S, l’O.A.S sur l’Armée, l’Armée sur les fellouzes, partout des coups de feu, des cris et des poursuites dans les rues.
Je réussis malgré cela à prendre le train pour Alger dans une pagaille indescriptible. J’arrivai à Alger le 2 juillet 1962, la veille de la proclamation de l’indépendance ! J’y restai bloqué 8 jours dans un petit hôtel de BAB el OUED sans pouvoir en sortir, partout des cris, des explosions, des défilés, des coups de feu en l’air, les youyous des femmes, et pendant ce temps- là dans l’ombre, combien de règlements de comptes, de tueries, de massacres et de tortures inimaginables. L’Armée française restait consignée dans ses casernes.

- Le soir tombe sur MECHARIA
4 ans plus tôt presque jour pour jour j’avais connu une pareille allégresse, c’était celle de l’espérance d’une paix prochaine qui malheureusement fut vite déçue.
Je passai 1 mois de repos dans ma famille puis rejoignis mon régiment à SPIRE en Allemagne. J’y retrouvai le premier régiment de Spahis, celui de mes débuts à Marrakech. J’y suis resté 2 ans et demi, y ai commandé pendant 6 mois par intérim un escadron de commandement et de services (ECS) puis démissionnai. Je venais d’être promu Capitaine. Après j’ai essayé d’oublier. Commença pour moi une toute autre histoire.
mercredi 28 avril 2021, par Antoine BERAUD
http://www.miages-djebels.org/spip.php?article345
https://www.miages-djebels.org/IMG/pdf/Temoignage_Antoine_BERAUD_b.pdf
.






![Soldats de l'infanterie française pendant la guerre d'Indochine [©AFP] Soldats de l'infanterie française pendant la guerre d'Indochine [©AFP]](https://media.nouvelobs.com/ext/uri/ureferentiel.nouvelobs.com/file/2319407.jpg)
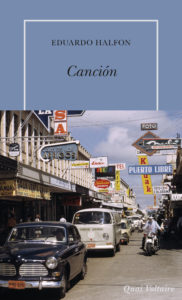
Les commentaires récents