Socialgerie met en ligne ici de larges extraits de son livre, actuellement introuvable ; "ITINÉRAIRE d’une militante algérienne ( 1945 - 1962) ".
Il s’agit d’une brochure de 130 pages, publiée aux éditions du Tell en 2011, présentée uniquement comme un témoignage : ..."ceci ne peut pas être et ne veut pas être un essai historique ni une autobiographie, ni des mémoires. C’est tout simplement un témoignage..."
De très nombreuses femmes militantes algériennes y sont évoquées : Alice Sportisse, députée communiste d’Oran, Lise Oculi, Abbassia Fodhil, Baya Allaouchiche ou Gaby Gimenez, Eliette Loup, Raymonde Peshard, Jacqueline Guerroudj, les femmes de dockers d’Oran, Myriam Ben, etc.
L’introduction est de Abdelkader Guerroudj, avec deux textes en annexe : "Le fourgon cellulaire" de Kateb Yacine et un texte de Henri Alleg : "L’histoire d’un journal, l’histoire d’un peuple" autour d’“Alger républicain”.
Dès que possible socialgerie mettra aussi en ligne (selon les possibilités techniques) le film d’un entretien avec Lucette Hadj Ali réalisé récemment par Khaled Gallinari.
Au nom de l’idéal
Qui nous faisait combattre
Et qui nous pousse encore
À nous battre aujourd’hui
Jean Ferrat
(Le bilan)
à Pierre et Jean
à Katell, Yann et Laure
à Jeanne
TABLE DES MATIÈRESPRÉFACEAbdelkader Guerroudj (page 7) PRÉAMBULE(page 13) LA FAMILLEENGAGEMENTSPOSTFACE(page 119)
|
ANNEXES
|
PRÉFACE
Des amis de Lucette Hadj Ali m’ont demandé de faire la préface du témoignage qu’elle veut apporter sur sa vie et sa participation à la lutte de notre peuple pour son émancipation.
J’avoue que je suis quelque peu gêné par cette marque de confiance parce que j’ai peur de ne pas être à la hauteur de toutes les questions que soulève son témoignage, de toutes les voies de recherche qu’il suggère.
Lucette Hadj Ali est une des rares combattantes algériennes qui a eu la chance de traverser toute notre guerre de libération sans avoir jamais été arrêtée. Et pourtant ! Je dis bien combattante et je sais de quoi je parle puisque Lucette a fait partie comme moi, et aussi comme son oncle le docteur Camille Larribère, du premier noyau des « Combattants de la libération » (CDL) crée par le Parti Communiste Algérien (PCA) au milieu de l’année 1955 et intégrés au FLN en juillet 1956. En effet, je sais qu’il existe quelques personnes – certaines sont encore en vie – qui ont eu cette chance, durant les sept années de souffrances de notre peuple, de ne pas être inquiétées alors qu’elles ont participé à des actions lourdes qui auraient pu les amener à la torture, à la prison, peut-être même à la mort ou à la disparition par exécution sommaire. A cet égard , et avec la permission de Lucette, je me permettrai de citer un seul cas, particulièrement remarquable : il s’agit de Abdelkader Ben M’barek, aujourd’hui disparu, combattant du FLN dans un des groupes que je commandais ; c’est lui qui, sur mon ordre, a exécuté fin 1956, Gérard Etienne, un des responsables de la « Main Rouge » (organisation terroriste qui a précédé l’OAS), patron d’un cinéma et d’un bar à El Biar. C’est encore Abdelkader Ben M’barek qui a tiré sur le général Massu dans le quartier du Frais Vallon. Son arme s’était enrayée, mais il avait réussi à s’enfuir.
Tout cela pour faire deux remarques : la première c’est qu’il ne suffit pas d’avoir été arrêté ou condamné pour être considéré comme un moudjahed ou même un héros. Ma deuxième remarque c’est que la lutte de notre peuple, comme le suggère à plusieurs reprises Lucette, n’a pas commencé en 1954, que l’indépendance de notre pays a été chèrement acquise et surtout qu’elle a été l’œuvre de tous ses enfants. Et ces enfants qui étaient dans leur immense majorité d’origine musulmane, ont eu souvent pour compagnons, dans les prisons, les lieux de torture ou même au maquis, d’autres Algériens, chrétiens, juifs ou non croyants. Car si, pour la majorité des Algériens musulmans, la participation au combat libérateur était une chose toute naturelle, il faut admettre que pour les Algériens d’origine européenne ou assimilée, les choix n’étaient pas aussi simples ni faciles. C’est pourquoi je dirai à leur propos que leur engagement était d’autant plus méritoire qu’ils étaient minoritaires. Certains personnages sont connus pour leur engagement et leur soutien constant, à la cause algérienne comme le cardinal Duval. D’autres sont des martyrs comme Audin, Maillot, Laban, Iveton et combien d’autres moins connus mais qui mériteraient d’être honorés.
Ce qui frappe aussi dans le témoignage de Lucette Hadj Ali, c’est à la fois le courage, la franchise, la sincérité, la simplicité avec lesquels elle parle, pae exemple, dès les premières lignes de sa prise de conscience tardive du fait colonial, ensuite des erreurs du Parti Communiste Algérien, ou même de choses plus intimes comme la soumission de sa mère ou la sévérité de son père, le docteur Jean-Marie Larribère, pionnier de l’accouchement sans douleur à Oran, nationaliste impénitent et engagé de la première heure, de même que son frère le docteur Camille Larribère, installé à Sig.
Oui, il est long, difficile, dangereux, inhumain le chemin qui mène les hommes et les femmes, les peuples vers le progrès. Nous revivons avec Lucette l’activité militante, l’activité politique, l’activité clandestine, avec ses moments d’angoisse qui se terminent heureusement dans l’allégresse de l’indépendance en juillet 1962.
Lucette Hajj Ali a raison d’insister sur l’action militante des femmes d’Algérie comme Alice Sportisse, députée communiste d’Oran, Lise Oculi, Abbassia Fodhil, Baya Allaouchiche ou Gaby Gimenez et tant d’autres, avant, pendant ou après la Révolution, en particulier dans le combat toujours actuel des femmes pour l’égalité.
Merci Lucette d’avoir parlé d’Henri Alleg, combattant pour l’indépendance de son pays, combien de fois arrêté et torturé, de Jacques Salort, infatigable administrateur d’ « Alger républicain », membre de la direction des CDL, arrêté, torturé avant, pendant et même après la guerre de libération, de Nicolas Zanetacci, maire communiste d’Oran, de René Justrabo, maire communiste de Sidi Bel Abbès, (lieu de garnison de la Légion étrangère) dont les Belabbésiens gardent encore aujourd’hui le souvenir en raison de ce qu’il a fait pour leur ville. Il ya aussi Sadek Hadjerès, dirigeant du PCA jamais arrêté et qui depuis l’exil continue son action militante.
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai retrouvé les noms de mes amis Abassia et Mustapha Fodil, assassinés dans une clinique d’Oran par un commando de l’OAS et le nom d’Abdelkader Choukhal, jeune journaliste à « Alger républicain », qui après plusieurs actions à Alger, « brûlé » comme on dit, avait rejoint l’ALN avec mon autorisation et est mort au combat en 1957. Et pourquoi ne pas rendre hommage à des hommes comme Pierre Mathieu ou à l’abbé Moreau qui sont quasiment inconnus.
Je ne terminerai pas sans dire quelques mots sur Bachir Hadj Ali dont Lucette parle peu, mais dont on sent la présence à chaque page. Je n’ai pas beaucoup travaillé avec Bachir hadj Ali, mais en tant que militant du PCA depuis 1951 ( promotion Staline), j’estime avoir le droit et le devoir de dire qu’à la veille de novembre 1954, Bachir hadj Ali était, avec Larbi Bouhali et Paul Caballero, l’un des plus estimés parmi les dirigeants du PCA. Il était un humaniste, un poète, un mélomane, ce qui ne l’empêchait d’être un révolutionnaire, au contraire, , parce que cela rendait son engagement plus riche. Contrairement à certains dirigeants politiques prétendument révolutionnaires mais qui n’étaient en fait que des marchands de politique ou de religion, Bachir Hadj Ali était un porteur d’idéal. Il a pu échapper à la prison pendant toute notre guerre de libération mais il l’a connue, de même que les pires tortures, après l’indépendance parce qu’il avait refusé d’accepter le pronunciamiento de juin 1965 dont l’Algérie finira bien un jour de digérer les séquelles.
Il incombe aux générations futures, à notre jeunesse de réaliser ce dont nous avons rêvé mais que nous n’avons pas pu, su accomplir.
Abdelkader Guerroudj
ancien condamné à mort FLN
de la guerre d’Algérie
PRÉAMBULE
Je suis née à Oran en 1920. J’y ai passé toute mon enfance et une partie de ma jeunesse. Par la suite, durant trois ans j’ai suivi les cours de l’Université d’Alger. Et pourtant, je n’ai jusqu’alors pas pris conscience du fait colonial en Algérie.
Pourquoi ?
Cet aveuglement a certes en partie été conditionné par l’environnement social qui était le mien à Oran dans ma jeunesse.
En 1940, la population oranaise était en majorité européenne : contrairement à ce qui se passait à Alger, les dockers oranais étaient européens dans la majorité. Dans le centre-ville, on ne rencontrait que très peu d’Algériens, à l’exception d’un certain nombre de commerçants dans les marchés : le marché Michelet (qui porte toujours ce nom) et celui de la rue de la Bastille, dans lesquels je ne me rendais jamais.
À l’école primaire, les petites algériennes étaient totalement absentes. Au lycée de jeunes filles, qui allait alors de la 6e à la Terminale [2], une seule algérienne suivait les coours, deux niveaux au-dessous du mien. J’ai cela en mémoire de façon très floue et je n’ai aucun souvenir précis d’elle. Dans la clinique de mon père, qui était gynécologue, et à la maison, le personnel était entièrement européen.
Je n’avais donc aucun contact avec la population algérienne. Il faut dire que les différentes catégories de la population oranaise se cloîtraient dans leurs quartiers respectifs : les Algériens dans le quartier de Lamur, dans celui de la Medina j’dida, le quartier « nègre », cet horrible nom dont le gratifiaient les « pieds noirs » [3], ou à la périphérie de la ville où les bidonvilles se multipliaient rapidement ; les Juifs dans le quartier avoisinant la place d’Armes (aujourd’hui place Emir Abdelkader) et le théâtre d’Oran (aujourd’hui Abdelkader Alloula) ; les Européens dorigine diverse à Choupot, St-Eugène, Eckmühl … ; les plus défavorisés, en majorité d’origine espagnole, dans le « Calère », en contrebas de la route qui mène à la colline de Santa-Cruz ; et la bourgeoisie européenne, d’origine surtout française, dans le centre-ville où nous vivions et où se situait la clinique de mon père. Tout ce monde diversifié ne se rencontrait que sur les lieux de travail, dans une hiérarchie bien établie, en dehors desquels les gens ne se fréquentaient plus.
Certes, mon père, en même temps qu’il nous initiait, mes sœurs et moi, aux rudiments du marxisme et du matérialisme historique, nous mettait en garde contre les méfaits du racisme, et en particulier de l’anti-sémitisme.
Il faut se souvenir qu’à l’époque, l’anti-sémitisme était largement répandu dans la population européenne. Après la défaite de la France en 1940, avec les lois anti-juives édictées par le régime de Vichy, qui avait annulé de décret Crémieux [4], la situation de la population juive s’aggravera encore. Je me souviens d’avoir lu, au cours d’un voyage à Sidi-Bel-Abbès, sur la terrasse d’un café, une pancarte mentionnant « Interdit aux Juifs » [5], ce qui provoqua la colère de mon père. S’ils ne furent pas déportés en masse, comme en France, vers les camps de la mort, les Juifs furent empêchés d’exercer certains métiers, dans l’enseignement en particulier, et des numerus clausus furent institués qui réduisirent leur nombre dans les écoles, les lycées et à l’Université d’Alger, où mon amie juive dut abandonner ses études à on grand désespoir.
Je m’installai définitivement à Alger en octobre 1942 et là, mes yeux commencèrent à s’ouvrir. Contrairement à ce qui s’était passé à Oran, les Algériens n’étaient pas invisibles. Je les rencontrais quotidiennement en plein centre-ville. Avec mes amis nous allions parfois déjeuner dans les gargotes de la Basse-Casbah. Les soirs de ramadhan, avec mon ami robert Manaranche, qui devint mon premier époux et qui était bien plus conscient que moi de l’Algérie réelle, j’allais boire du thé et manger des gâteaux en écoutant de la musique algérienne que je découvrais.
Je me trouvais ainsi projetée dans une vie tout à fait nouvelle. Et je découvrais la situation misérable des Algériens, situation que j’avais ignorée à Oran (ou que je n’avais pas voulu voir ?…) Le spectacle de ces enfants couchés la nuit à même le sol sus les arcades de la rue Bab-Azzoun me serrait le cœur. J’observais avec la même émotion les petits cireurs de chaussures qui, à longueur de journée, faisaient claquer leurs brosses sur leurs boîtes, à la recherche de clients, ou ces gosses qui, au marché, portaient pour quelques sous les lourds paniers des ménagères européennes.Aux Auberges de la Jeunesse auxquelles j’avais rapidement adhéré, mes copains avaient des contacts avec des membres du PPA. Ils m’en parlaient et je crois en avoir rencontré une fois. Je comprenais qu’ils s’insurgeaient contre cet état des choses, mais sans jamais analyser cette situation en profondeur.
Il faut dire à ma décharge que j’avais alors quelques préoccupations : nous étions en pleine guerre. Le débarquement anglo-américain sur les côtes algéroises s’était déroulé le 8 novembre 1942, ce qui provoqua quelques bombardements de l’aviation italienne sur Alger. Le décès de ma future belle-mère (la mère de Robert Manaranche) survint à ce moment-là.
J’avais en outre quelques soucis à propos de mon mariage, qui se fit contre la volonté de mon père. Je tombai ensuite gravement malade, ce qui m’obligea à repartir chez mes parents, en décembre 1944, Robert, mobilisé, ayant été envoyé au Maroc.
Le 8 mai 1945, je me trouvais donc à Oran. C’est par une amie, venue me rendre visite, que j’appris les manifestations qui se dérouléiant en ville, sans en comprendre le sens réel, étant braquée totalement sur l’évènement du jour : la fin de la guerre.
Une fois de plus je me trouvai ainsi en marge de la réalité.
LA FAMILLE
MES GRANDS-PARENTS
MES PARENTS
Ma famille est originaire des Pyrénées françaises
Pyrénées orientales pour ma mère
Pyrénées centrales pour mon père
I
MES GRANDS-PARENTS
Mes grands-parents maternels vivaient donc dans le périmètre centré sur Perpignan. J’ai peu d’informations sur eux. Je sais seulement que mon arrière-grand-père Treil possédait un pressoir avec lequel il se rendait de vignoble en vignoble, au moment des vendanges, pour effectuer, je suppose, la première mouture du raisin.
À la fin du XIXe siècle, toute cette région du Sud-Ouest de la France était le théâtre de violents affrontements entre républicains partisans de la laïcité et de séparation de l’église et de l’état, et les défenseurs de la prééminence de l’Eglise catholique. Dans les souvenirs de ma grand-mère, ces affrontements opposaient souvent instituteurs et prêtres.
Selon ma grand-mère, son père était profondément laïque, opposé à toute main mise de l’Église sur la société. « Il ne pouvait proclamer publiquement ses convictions en raison du fait qu’elles auraient pu l’empêcher de travailler » nous disait ma grand-mère. « C’est pourquoi j’ai été baptisée et j’ai fait ma Première communion. Mais ce jour-là avent de me rendre à l’église, mon père m’a obligée à boire un café au lait, alors que je devais rester à jeun. Et après la cérémonie, en repartant, il m’a demandé de me retourner et, montrant du doigt le portail de l’église », il a affirmé avec force : « Tu as franchi cette porte pour la dernière fois ». Ce qui s’est avéré exact…
Après avoir suivi les cours de l’École normale, ma grand-mère a sollicité et obtenu un poste d’institutrice en Algérie, les traitements des fonctionnaires français travaillant « dans les colonies » étant alors de 33% plus élevés que ceux payés en France.
À 19 ans donc, elle a débarqué à Oran, avec son père et sa mère qu’elle avait pris en charge. C’est à Oran qu’elle a épousé mon grand-père, Henri Verdier, lui-même instituteur. Tous deux ont exercé leur métier dans de petits villages d’Oranie, où naîtront leurs quatre enfants. Je n’ai pas connu mon grand-père car il est mort jeune. Ma grand-mère s’est donc retrouvée seule et sa vie a été particulièrement difficile. Elle était heureusement dotée d’une très forte personnalité et d’une énergie ç toute épreuve, qui lui ont permis d’élever avec bonheur ses quatre enfants, dont trois garçons et ma mère.
J’adorais ma grand-mère, j’ai toujours senti d’ailleurs que j’étais sa petite-fille préférée, sans doute parce que j’étais l’aînée. À ma naissance mon père avait choisi mon prénom, « Lucie », qui déplût fortement à ma grand-mère qui décida de m’appeler « Lucette » et « Lucette » demeura.
Promue directrice d’école à Inkermann (Oued Rhiou aujourd’hui), un riche village colonial à l’Ouest de Chlef, elle préparait ses élèves au certificat d’études. L’examen une fois passé, elle se hâtait d’aller discuter avec les pères de ses petites élèves algériennes (trois ou quatre à peine) pour tenter de les convaincre d’autoriser leurs filles à poursuivre leurs études. Sans succès bien évidemment. Je me souviens en particulier de l’une d’entre elles qui, désormais claquemurée à la maison et mariée très jeune, avait sans doute entretenu une correspondance suivie avec ma grand-mère puisque chaque fois qu’elle se rendait à Oran, elle venait lui rendre visite.
À mon grand regret, je n’ai pu revoir ma grand-mère avant sa mort, en 1961 à Paris, où mon père l’avait installée avec ma mère en raison de graves menaces que l’OAS faisait peser sur notre famille.
Mes grands-parents paternels, Pierre et Marie, étaient tous deux originaires du village de Ferrières dans les Pyrénées centrales. Ils appartenaient à des familles qui se considéraient comme ennemies. Pour pouvoir épouser ma grand-mère, mon grand-père l’avait tout simplement enlevée…
Illettré, berger et charbonnier de son état au départ, mon grand-père avait, par la suite, appris à lire et à écrire et passé le Brevet, ce qui lui avait permis de devenir instituteur et, pour les mêmes raisons que celles de ma grand-mère maternelle, d’obtenir un poste en Algérie, à Bel-Abbès, où il a débarqué aux environs de 1898, avec toute sa famille, dont mon père qui avait alors cinq ans.
Je n’ai pas connu ma grand-mère paternelle. Je sais seulement qu’elle était très douce et assez effacée. J’ai souvent imaginé que sa vie n’avait pas dû être facile, face à un homme comme mon grand-père.
À Bel-Abbès, puis à Oran, celui-ci s’est lancé dans la bataille syndicale et politique. Il fut l’un des fondateurs du Parti Communiste Algérien en Oranie. Cette activité lui valut les foudres des autorités académiques qui lui imposèrent une retraite anticipée.
Je me souviens qu’en 1936, alors que se déroulaient en France les événements qui devaient déboucher sur le gouvernement de Front Populaire, en me rendant au lycée (j’avais alors 16 ans), j’aperçus une manifestation qui empruntait la rue d’Arzew (aujourd’hui rue Ben M’Hidi). Et soudain je vis mon grand-père hissé sur les épaules de deux jeunes gens, sous les ovations de la foule. N’en croyant pas mes yeux, je me hâtai d’enfiler une rue perpendiculaire, voulant échapper à son regard scrutateur.
Quand il fut plus âgé et incapable d’assumer son autonomie, il vint demeurer chez nous. Atteint de déficience mentale, il prenait ma mère pour sa femme, Marie, disparue bien des années auparavant. Mais il reconnaissait toujours Lénine dans le buste qui trônait au-dessus de sa bibliothèque.
II
MES PARENTS
Mes parents se sont unis en 1918. Ils étaient tous deux instituteurs, enseignant dans le village de Guyard (aujourd’hui Ain Touta). Après la naissance de la seconde de ses filles, mon père décida de changer de métier et entreprit des études de médecine à Alger, aidé en cela par ma grand-mère maternelle qui fournit au jeune ménage un apport financier indispensable.
Ma mère tenta alors de se rapprocher d’Alger. Elle fut ainsi mutée d’abord à Inkermann (Oued Rhiou aujourd’hui), où ma grand-mère dirigeait l’école des filles. C’est là que j’ai effectué ma première année scolaire dans la classe de ma mère. À noter que contrairement à ce qui se passera plus tard à Oran, j’étais alors en contact dans cette école avec quelques écolières algériennes qui furent mes camarades de classe. Ma mère fut ensuite nommée à El Attaf, puis à Oued el-Alleug, un village de la Mitidja ; elle obtint enfin un poste à Alger. Mais mon père effectuait alors sa dernière année de spécialisation en gynécologie à la faculté de médecine d’Alger et toute la famille repartit alors pour Oran, en 1928.
Après avoir ouvert une petite clinique de trois chambres, rue Ben M’Hidi (anciennement rue d’Arzew) [6], mon père acquit un établissement plus important, 8 square du Souvenir sur le Front de mer, à l’angle de la rue Michelet, qui porte aujourd’hui son nom.
Mon père était doté d’une personnalité remarquable qui faisait sans doute exception dans la bourgeoisie européenne de l’époque. Et il a inculqué à ses cinq filles les valeurs qui ous ont permis d’avancer dans la vie : l’honnêteté, la rigueur, l’amour du travail et du travail bien fait, le sens de la justice sociale. Il nous répétait sans cesse la même mise en garde : « Ne comptez pas sur nous dans votre vie d’adulte. Vous ne devrez compter que sur vous-mêmes. Vous devez donc travailler et acquérir un métier ». Il ne dormait que quatre heures par nuit, jugeant qu’un surplus de sommeil était du temps perdu.
Il partageait son temps entre l’hôpital dont il dirigeait la maternité et sa clinique privée dans laquelle, outre les consultations qu’il assurait tous les après-midi, il accouchait et opérait ses clientes. Il donnait également des cours à l’École d’infirmières. Très souvent, il était contraint de se rendre la nuit à l’hôpital quand ses assistants n’arrivaient pas à solutionner des cas difficiles. Malgré des journées aussi chargées, il trouvait le temps, à la nuit ou au petit matin, de se plonger dans des revues médicales auxquelles il était abonné.
En dépit de sa surcharge de travail, il tenait à garder un constant contact avec nous : nous prenions nos repas ensemble le plus souvent. Le dimanche après-midi, il nous emmenait souvent à la campagne, dans un champ où il nous enseignait les rudiments de football… Il nous faisait venir dans sa bibliothèque pour écouter de la musique classique européenne. Mais je concevais cela comme une contrainte et je n’y prenais aucun plaisir.
Parfois le dimanche matin, il nous emmenait à l’hôpital. J’ai toujours en mémoire le spectacle de jeunes enfants jouant dans une cour isolée. C’étaient des enfants nés sous x et dont l’hôpital s’occupait pendant quelques années avant qu’ils ne soient transférés dans les structures spécialisées existantes. Il les faisait alors monter à tour de rôle dans sa voiture pour les promener dans l’hôpital. Et il achetait et installait dans cette cour des jeux divers, balançoires, toboggans, etc. j’ai compris bien plus tard combien mon père avait été sensible à la situation désastreuse de ces enfants. Il nous les montrait intentionnellement pour nous faire comprendre que nombre d’enfants étaient loin de mener la vie privilégiée qui était la nôtre.
Quand « l’accouchement sans douleur » fut appliqué, en 1950-1951, à la clinique des Bleuets à Paris par le professeur Lamaze, qui en avait appris l’existence en URSS, mon père, qui avait été le témoin, durant plus de 30 ans, des terribles souffrances qu’enduraient ses clientes en mettant leurs enfants au monde, demeura incrédule. Alors que j’accouchais de mon second fils Jean, en 1952, il ironisait : Mais non, me disait-il, tu crois souffrir mais tu ne souffres pas… » Cependant, peu après, il fit un séjour à Paris et revint enthousiaste. Il fut le premier à l’appliquer en Algérie, dans sa clinique et à l’hôpital.
Sur le plan politique, ses positions étaient ambigües à l’époque. D’une part, il désirait être accepté par la bourgeoisie européenne oranaise. À ce titre, il avait contraint ma mère à suivre des cours de cuisine, donnés à l’EGA (la Sonelgaz de l’époque) par un chef réputé, pour la confection de menus exceptionnels. Et je me souviens d’un accrochage survenu sous mes yeux entre mon père et l’un de ses frères, qui était venu chercher mon grand-père pour l’emmener à un meeting du Parti Communiste Algérien (PCA). Mon père s’y est opposé avec force. Était-ce en raison de l’état de santé de mon grand-père ou craignait-il les répercussions que la présence de son père à cette manifestation communiste pourrait avoir sur sa propre notoriété ?
Cependant il aidait matériellement les républicains espagnols communistes qui avaient fui la dictature franquiste et s’étaient réfugiés à Oran. Plus tard, après la guerre, rejoignant les orientations politiques de son père et de ses frères, il a adhéré au Parti Communiste Algérien (PCA). Après avoir été élu dans la municipalité « France Combattante » en 1945, il a milité à la base du Parti, participant chaque semaine à la diffusion de « Liberté », l’hebdomadaire du PCA. En avril 1955, il a été candidat du Parti à Oran lors des élections cantonales.
En 1957, il vint chez moi, attendant l’accord du FLN pour rejoindre l’ALN en tant que médecin. Des parachutistes ayant installé une « souricière » dans notre logement, il fut arrêté et contraint de reprendre un train à destination d’Oran avec menace de mort s’il revenait.
Tel était mon père, dont bien des aspects m’étaient inconnus à l’époque. Pour l’heure je ne le connaissais que sous ses aspects autoritaires. Autoritaire, il l’était avec ma mère et nous, mais aussi avec le personnel travaillant à la clinique ou à l’hôpital et même avec ses clientes dont il préférait se séparer si elles ne suivaient pas ses instructions à la lettre.
Avoir eu cinq filles et pas un seul garçon aura été pour lui une très grande frustration. Sans doute pétri de préjugés anti-féminins, il nous a élevées, mes sœurs et moi, de manière très conservatrice. Etant l’aînée c’est moi qui ai subi ses méthodes les plus rigoristes. À 16 ans, je ne pouvais pas aller au cinéma seule avec mes camarades. Quand je m’absentais l’après-midi je devais préciser où je me rendais et je devais rentrer de bonne heure.
J’avais une grande amie, Mireille, qui avait été jugée trop libre ; ma mère, pressée par mon père, me demanda d’espacer nos rencontres, ce que je refusais avec force. Plus tard, un de mes amis étudiant à Alger m’écrivit pendant les vacances ; mon père qui avait intercepté sa lettre, m’a alors convoquée solennellement dans sa bibliothèque où il m’a fait des reproches très vifs et m’a demandé de cesser toute relation avec les étudiants de sexe masculin.
Comme je m’y refusai, il m’annonça que je ne retournerai pas à la faculté. Au bout de quelques jours, sans doute dépêchée par mon père qui voulait absolument que je poursuive mes études, ma mère me conseilla d’accepter, ajoutant à ma grande surprise : « À Alger, tu feras ce que tu voudras ».
Mon père prenait parfois des décisions intempestives : il nous interdisait de lire des romans policiers. Quand mes amies m’en prêtaient, je me revois, assise sur un fauteuil du salon, un livre interdit à la main. Quand j’entendais l’ascenseur, qui était très bruyant, je cachais le bouquin sous un coussin et en ouvrait un autre, autorisé.
Mes sœurs et moi étions aussi soumises à des règles établies par lui, des règles que nous ne devions pas transgresser et que nous ne pouvions même pas discuter.
Je ne me sentais libre qu’en son absence. Ainsi, quand il partait en voyage, c’était pour moi la joie à la maison. Le soir, nous nous installions dans la cuisine où ma mère nous confectionnait des casse-croûtes divers que nous dégustions avec un plaisir infini.
Il n’en demeure pas moins qu’il a marqué indubitablement l’histoire d’Oran, jusqu’à sa mort en 1965. J’ai pu constater souvent combien le souvenir de mon père était resté vivace dans la population oranaise : chez les médecins bien sûr, mais aussi dans le peuple. M’étant rendue récemment dans une mairie de quartier pour la confection de papiers administratifs, j’ai été interpellée par une jeune secrétaire qui m’a demandé quelle relation j’avais entretenue avec le docteur Larribère et quand je lui ai répondu que j’étais sa fille, tout émue, elle m’a sauté au cou.
Ma mère n’a certainement pas eu la vie dont elle avait rêvé. Quand elle a épousé mon père, elle était institutrice et elle adorait son métier. Mais quand mon père installa sa clinique, il lui fit prendre une retraite anticipée pour qu’elle puisse assurer la gestion de l’entreprise. C’est elle donc qui, chaque matin, faisait le marché, contrôlait la confection des menus destinés aux accouchées et comptabilisait les dépenses.
Quand nous rentrions de l’école, elle surveillait la confection de nos devoirs et nous faisait réciter nos leçons. Plus tard au lycée, elle nous a appris à organiser soigneusement notre travail.
Ses journées étaient bien remplies. À ses moments de loisirs, elle se mettait un peu au piano et le soir, lisait souvent et aimait écouter de la musique à la radio jusque tard dans la nuit.
Elle était totalement soumise à mon père. Au moment de mon premier mariage, avec Robert Manaranche, mariage que mon père avait désapprouvé totalement, il lui a interdit de venir m’assister à Alger. Et elle a obéi passivement, ce qui m’a profondément chagrinée. Je ne l’ai jamais entendu protester, élever la voix. Mon père, par contre, s’en prenait fortement à elle, lui faisant de vifs reproches en toutes occasions. Et je m’indignais quand je surprenais ma mère essuyant ses larmes. À ce moment-là, je n’aspirais qu’à une chose : voir mes parents se séparer, divorcer…
C’est à cette époque-là, durant mon adolescence, que je pris la résolution de ne jamais me soumettre à l’autorité d’un homme, de ne concevoir une union future qu’avec un compagnon dont je serai l’égale. Je n’ai certes pas compris alors que le couple déséquilibré formé pas mes parents était le lot commun de la majorité des couples en Europe et chez les Européens d’Algérie. Et j’ignorais bien entendu le sort des femmes dans la société algérienne.
C’est à ce moment-là cependant que s’implanta en moi, de façon très vague, sans aucune précision bien sûr, l’idée qu’il me fallait participer au combat pour l’égalité des droits des femmes. Je m’intéressais alors passionnément aux actions menées par les féministes en France (les suffragettes, comme on les appelait alors) pour l’obtention du droit de vote, l’une de mes camarades de classe au lycée étant la petite-fille de l’une d’entre elles.
ENGAGEMENTS
1943
LE JOURNAL « LIBERTÉ »
J’ avais commencé mes études universitaires, en histoire-géographie à Paris en 1938-1939, mais la Seconde Guerre mondiale ayant alors débuté, je les ai poursuivies pendant trois ans à Alger où se trouvait la seule université du pays.
En octobre 1942, après avoir achevé une licence, je dus interrompre mes études, l’université et les lycées ayant été fermés en raison des bombardements de l’aviation italienne après le débarquement anglo-américain à Alger. Après avoir travaillé quelques semaines dans l’un des lycées privés qui s’étaient ouverts, je fus engagée, en tant que rédactrice, dans l’agence France-Presse dont l’importance s’était considérablement accrue du fait qu’Alger était devenue la capitale de la « France Libre ». C’est là que je rencontrai, pour la première fois, Henri Alleg qui y travaillait comme traducteur. Dans son livre autobiographique, « Mémoire Algérienne », il raconte (mais je ne m’en souviens pas) qu’il m’a invitée à une réunion de cellule élargie, ainsi que mon amie Gilberte qui deviendra sa femme, dans l’espoir sans doute que j’adhérerai au Parti. Mais je n’étais pas encore prête à m’engager.
En septembre 1943, je fus contactée par la direction de « Liberté », l’hebdomadaire du Parti Communiste Algérien, laquelle, connaissant les orientations politiques (communistes) de ma famille et en particulier celles de mon grand-père et de mon oncle, Camille Larribère, me demanda de venir travailler au journal, ce que je fis.
C’est dans ce journal que j’ai appris le B.A.-BA du métier de journaliste, sous la direction d’une journaliste d’exception, Henriette Neveu. Tout en perfectionnant ma formation, elle n’avait de cesse de me harceler pour que j’adhère au Parti.
Mais je m’y refusais, observant combien cette adhésion impliquerait de surcharge de travail. Paradoxalement, elle disparut de la scène politique dans des circonstances confuses, alors que j’avais quitté le journal.
C’est là que je rencontrai aussi David Cohen, dont l’humour toujours percutant allégeait des journées souvent lourdes. Plus tard, il reprit ses études à Paris et il devint un spécialiste renommé des langues sémitiques.
À l’époque, « Liberté » jouissait d’une très grande popularité aussi bien dans la population européenne que dans la population algérienne. Tout en appelant à l’effort de guerre et à l’épuration des partisans de Pétain dans l’administration, il dénonçait avec force telle ou telle exaction ou gabegie de l’administration coloniale, ainsi que la corruption généralisée qui provoquait de graves pénuries alimentaires. Nous recevions chaque jour quantité de lettres signalant ces abus et, à la rédaction, nous étions chargés d’en vérifier l’exactitude, ce qui n’était pas chose facile.
Ainsi un jour je dus aller contrôler le goût de l’huile d’arachide qui nous avait été signalée comme rance. Celle-ci était stockée dans un immense réservoir installé sur le port. Se moquant ouvertement de moi, l’un des responsables (français) me fit gravir l’échelle de fer jusqu’au sommet du réservoir où je pus constater que l’huile était bonne.
« Liberté » effectua, entre autres, des reportages poignants sur la terrible famine qui sévissait dans le pays, en particulier dans le Constantinois, en soulignant la situation épouvantable des paysans qui subissaient en outre une répression forcenée.
En s’élevant régulièrement contre l’exploitation, la misère généralisée que vivaient les Algériens, le journal se plaçait résolument en dénonciateur du système colonial lui-même.
J’ai déjà dit qu’à mon arrivée à Alger en 1942, j’avais commencé à prendre conscience de cette terrible réalité. Mais c’est en travaillant à « Liberté », en touchant du doigt chaque jour le sort désastreux de la population algérienne, en constatant les privilèges exorbitants dont jouissait la population européenne, en discutant régulièrement avec mes camarades du journal que cette prise de conscience devint décisive. Elle se confortera encore davantage dans les années suivantes, quand je militerai à l’Union des femmes d’Algérie et au Parti Communiste Algérien.
En décembre 1944, malade, je repartis à Oran et je ne revins à Alger qu’en juillet 1945.
1945
L’UNION DES FEMMES
D’ALGERIE
(U.F.A.)
Après la victoire des Alliés sur le fascisme allemand et italien, un puissant mouvement a soulevé les forces progressistes en France et dans la population européenne d’Algérie.
Arrivée depuis quelques jours à Alger, j’assistai avec enthousiasme, le 14 juillet 1945, à l’énorme manifestation rassemblant des dizaines de milliers d’hommes et de femmes, en majorité européens, démocrates, progressistes, communistes, syndicalistes, qui déferla le long du boulevard Laferrière (aujourd’hui boulevard Khemisti).
Mais qu’en étaient-ils des Algériens ?
Par ordonnance du 7 mars 1943, leur situation s’était légèrement améliorée : dans un deuxième collège, dont les femmes étaient exclues, les élus algériens constituèrent désormais les deux cinquièmes des élus locaux au lieu du tiers ; le Code de l’Indigénat et les mesures d’exception furent abrogés.
Par ailleurs, dans les syndicats redevenus légaux, de nombreux travailleurs algériens, y compris les ouvriers agricoles, s’organisèrent. Dès lors, il devint moins facile aux employeurs et en particulier aux colons de perpétuer leur comportement répressif vis-à-vis d’eux.
Je me souviens : dans le compartiment du train où je m’étais installée, lors de mon voyage à Oran fin décembre 1944, se trouvaient deux hommes que je reconnus rapidement pour être des colons en raison des propos qu’ils tenaient ouvertement en ma présence, estimant sans doute que je les approuvais : « Nous ne pourrons plus, disaient-ils en substance, châtier nos ouvriers comme nous le faisions auparavant ».
J’ai oublié leurs termes exacts, mais dans mon souvenir, il s’agissait bien de châtiments corporels. Et ils ajoutaient qu’ils allaient se rendre au Maroc car, là-bas, ils pourraient agir comme bon leur semblerait. Outrée, révoltée, je m’emparais de ma valise et quittai le compartiment.
Dès mon retour à Alger, je fus contactée, je ne sais plus par qui, pour assurer la confection de « femmes d’Algérie », le mensuel de l’organisation féminine, l’Union des Femmes d’Algérie (UFA) [7]
C’est ainsi que je me trouvai propulsée à l’Union des femmes d’Algérie : heureuse car se trouvaient réalisés les rêves de mon adolescence et en même temps angoissée par les responsabilités auxquelles j’allais devoir faire face, alors que j’étais jeune et que, coupée depuis sept mois, par ma maladie, de mon milieu algérois et de mes camarades journalistes à « Liberté », j’avais l’impression que je me lançais dans l’inconnu.
L’absence de Robert Manaranche, mon premier époux, ajoutait encore à mon angoisse.
Une amie m’a transmis récemment trois exemplaires des premiers numéros de « Femmes d’Algérie ». J’ai donc pu relire avec joie quelques uns des articles que nous y avions publiés : sur la vie misérable des Algériens dans les bidonvilles ; sur l’exploitation des petites filles (de 10 ans) dans les ateliers de fabrication de tapis à Tlemcen ; sur la dénonciation du fait que les Algériens ne pouvaient participer pleinement aux élections de l’époque, etc. Nous dénoncions ainsi certains des méfaits du système colonial, mais sans en approfondir les raisons profondes. Il est vrai que ces numéros dataient de 1945 et qu’alors je n’avais pas encore totalement conscience du fait colonial. Je n’ai pas réussi à récupérer certains des numéros parus dans les années suivantes et je n’ai pu constater ainsi si le « ton » du journal s’était véritablement modifié.
Cependant quand je pénétrai pour la première fois dans les locaux de l’UFA, rue jacques Cartier (occupés ces dernières années par l’École de journalisme), je fus accueillie tout à fait amicalement par ses deux dirigeantes, Alice Sportisse qui en était la Secrétaire générale et Lise Oculi, son adjointe, qui me rassurèrent et m’encouragèrent.
Alice Sportisse était une très belle femme, mais son visage était marquée par la maladie qui l’avait frappée dans sa jeunesse (la tuberculose je crois) et par la vie rude qui avait été la sienne alors qu’elle avait été, durant la Guerre d’Espagne, l’une des assistantes de Dolorès Ibarruri, la Pasionaria [8], Ayant été élue députée d’Oran, elle s’était ensuite installée à Paris où elle avait rencontré un universitaire espagnol exilé avec lequel elle avait eu une fille handicapée dont elle avait dû s’occuper exclusivement. Je l’avais revue une ou deux fois au cours de voyages à Paris. Puis nous nous étions perdues de vue. Plusieurs années après, j’avais réussi à obtenir sa nouvelle adresse, après un premier échange de correspondance, elle n’avait plus répondu à mes lettres et je n’ai, malheureusement, plus jamais su ce qui lui était arrivé.
Après le départ d’Alice Sportisse, c’est Lise Oculi, son adjointe, qui prit la direction de l’Union des femmes. Elle était plus jeune qu’Alice, mais était dotée de la même détermination et d’un esprit de responsabilité remarquable. Membre suppléant du Bureau Politique du PCA, elle avait été élue conseillère municipale d’Alger.
Malheureusement notre collaboration fut de courte durée. Durant l’hiver 1946 au cours d’un voyage qu’elle effectuait dans l’est, pour consolider les nombreuses sections de l’organisation qui s’y étaient crées, elle attrapa le typhus dont l’épidémie s’était largement répandue dans le pays et elle mourut rapidement. Plusieurs années après, de passage à Djidjel, c’est avec une vive émotion que je découvris sa tombe dans le cimetière européen, face à la mer…
Sous la direction d’Alice Sportisse, un congrès fut organisé qui élut un Secrétariat collectif dont le fonctionnement me fut confié.
Ainsi se termina dans la peine et l’anxiété, cette première partie de ma vie dans l’UFA. Dix-huit mois s’étaient à peine écoulés depuis mon arrivée rue Jacques Cartier, mais ils avaient été très riches en enseignements et mon existence s’en était trouvée totalement transformée. Je m’efforçais de devenir une véritable militante, à l’image d’Alice et de Lise qui étaient mes modèles.
Une autre de mes camarades aura également été pour moi un modèle : Gaby Gimenez-Benichou.
Mes camarades m’avaient souvent parlé d’elle, du courage qu’elle avait déployé dans l’action clandestine. Et j’attendais avec impatience de la rencontrer
Militante communiste dès son adolescence, elle avait en effet activement participé, dans la clandestinité, au combat anti-fasciste que menait alors le PCA sous le gouvernement de Vichy.
Elle avait à peine seize ans quand elle avait été chargée de transporter d’Oran à Alger une valise de documents et de tracts. Arrivée dans la nuit à Alger, elle n’avait pu déposer son fardeau chez le camarade indiqué, celui-ci, pris de peur, ayant refusé de l’accueillir. Elle avait donc repris sa valise et à pied, tard dans la nuit, avait gagné le domicile d’un autre militant… à El Harrach.
Arrêtée, elle avait été torturée et condamnée aux travaux forcés à perpétuité. À sa libération, elle avait été élue au conseil cantonal d’Oran. Mais atteinte de tuberculose, elle fut envoyée en France par le Parti pour être soignée et elle n’était revenue qu’en 1951.
Sa vie durant Gaby milita ainsi activement dans le Parti et à l’Union des femmes, avec toujours une extrême modestie.
Nous nous rencontrions souvent quand je me rendais à Oran ou quand elle venait à Alger pour les réunions du Comité central du Parti ou celles de l’Union des femmes. Elle logeait alors chez moi et jusque tard dans la nuit, nous échangions nos points de vue sur les problèmes en cours. Une solide amitié nous a étroitement liées.
Pendant la Guerre d’indépendance, elle sera à nouveau arrêtée, torturée, puis condamnée à 20 ans, puis à 15 ans de prison.
Plus tard, quand s’abattit sur nous la chape noire de l’islamisme intégriste, menacée, elle dut partir se réfugier en France auprès de ses deux garçons. Atteinte d’ostéoporose, c’est dans la plus extrême souffrance qu’elle termina ses jours il y a quelques années, loin de son pays.
ENTRE L’UNION DES FEMMES
D’ALGÉRIE ET LE PCA
II
Fin mai 1946, je partis pour Oran pour donner naissance à Pierre, mon fils aîné, et je ne revins à Alger qu’au mois d’août.
Le Parti avait, entre-temps, traversé une crise décisive.
Que s’était-il passé ?
En mai 1945, le Parti avait condamné les émeutes qui s’étaient déroulées dans le pays, en montrant ainsi son incapacité à soutenir les aspirations de notre peuple à l’indépendance.
Et pourtant, quelques années plus tôt, les communistes qui étaient alors rassemblés dans les sections algériennes du Parti Communiste Français (les partis algériens étant alors interdits) s’étaient prononcés pour l’indépendance de l’Algérie, en application des positions de la IIIe Internationale [9] qui avait affirmé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Le Parti Communiste Algérien, qui naquit en 1936 en tant que parti national, avait réaffirmé les mêmes positions.
Cependant sal ligne s’était ensuite infléchie en raison du nombre important de ses adhérents européens et aussi par les liens étroits que le Parti entretenait toujours avec le PCF.
D’autre part, il était préoccupé par la nécessité de rassembler l’ensemble de la population dans la guerre contre le nazisme.
Mais, dira plus tard Bachir Hadj Ali [10], le Parti aurait dû réunir dans un même combat le soutien à la lutte anti-fasciste, dans la guerre, et la revendication d’indépendance. C’est ainsi qu’il ne perçut pas les raisons profondes des émeutes du 8 mai.
Tragique erreur qu’il a reconnue et corrigée au cours d’un Comité central élargi [11] en juillet 1946. Cependant, elle fut lourde de conséquences, dans les années qui suivirent, pour la reconnaissance de son implantation dans le mouvement national. À noter qu’il prit ensuite l’initiative de créer les Comités d’amnistie, à la suite de la répression forcenée qui s’était abattue sur les Algériens. Ces Comités, auxquels les militantes de l’Union des femmes participèrent activement, menèrent le combat dans tout le pays pour la libération des milliers d’Algériens qui peuplaient les prisons. Ayant adhéré au Parti en août 1945 et ayant été invité au Comité central de juillet 1946, Bachir Hadj Ali fut chargé de coordonner l’action de ces comités dans la région d’Alger. C’est, en grande partie, grâce à la bataille acharnée menée par les Comités d’amnistie initiés par le PCA, aidés par l’intense campagne publique menée par le PCF, que l’Assemblée constituante finit par voter une amnistie générale.
Pour l’heure à mon retour d’Oran, parallèlement à mon travail à l’union des femmes, et dans l’exaltation de la victoire sur le nazisme et le régime de Vichy, je me jetai avec enthousiasme dans les batailles menées au cours des campagnes électorales qui se succédèrent alors pour le renouvellement des assemblées communales, cantonales, régionales et celui du Parlement français auxquelles les Européens d’Algérie devaient participer.
À noter qu’aux élections municipales de 1945, deux Algériennes (ou plutôt deux Franco-Algériennes) avaient été élues : Fatma Mérani à Saint-Cloud (Gdyel aujourd’hui), près d’Oran, sur une liste du PCA, par le collège algérien et Madame Bendjaoui Kateb, à Bône (Annaba) par le collège européen.
C’est à Hussein-Dey que je fus invitée pour la première fois à une réunion publique en tant que représentante de l’UFA. Pour venir à bout de mes réticences, Alice Sportisse avait minimisé l’importance de ce meeting. Mais quand je descendis du bus à l’heure dite, je découvris avec effroi la foule immense qui remplissait la place et c’est d’une voix quelque peu tremblante que j pris à mon tour la parole.
Je me revois aussi arpentant les rues du quartier Trolard (Mokhtar Abdelatif aujourd’hui), au-dessus du tunnel des Facultés, un quartier peuplé alors d’Européens, en compagnie d’un camarade (Clément, le mari de Lise Oculi, si je l’en souviens bien). Au bas de chaque immeuble et sans micro, nous appelions les habitants à nous écouter et, à tour de rôle, d’une voix forte, quand ils sortaient sur leurs balcons, nous les engagions à voter pour les candidats communistes
III
L’Union des femmes d’Algérie était née, lors d’un premier congrès, en 1944, sur la base des Comités de ménagères crées sur les marchés à l’initiative du PCA, dans le but de lutter contre les pénuries de toutes sortes, le marché noir, la vie chère. Or ces comités ne rassemblaient pratiquement que des ménagères européennes, les Algériennes étant alors absentes sur les marchés. En conséquence, à sa naissance, l’UFA était une organisation de composition en grande majorité européenne et son action, qui s’adressait essentiellement aux Européennes, était alors centrée sur les soins aux blessés de la guerre et à l’aide à apporter à leurs familles, ainsi que sur les problèmes de vie chère et de pénurie.
Les nouvelles municipalités « France Combattante », qui étaient de gauche, comme celles d’Alger et d’Oran [12] nous autorisaient à établir des tables sur les marchés, où nous nous installions une fois par semaine pour nous adresser aux femmes, leur faire signer des pétitions, les appeler à participer à telle ou telle manifestation, à adhérer à notre organisation. Et encore une fois, nous ne touchions que des Européennes.
Par ailleurs, l’UFA s’assimilait à une « organisation de bienfaisance ». Nos militantes récoltaient en quantité des vêtements usagés ainsi que des produits alimentaires que nous distribuions. Certes, une grande partie d’entre eux arrivaient dans des familles algériennes et j’ai imaginé par la suite combien ces « distributions » ont pu avoir, à l’époque, d’impacts négatifs sur l’opinion que les Algériennes et les Algériens pouvaient se faire sur notre organisation.
L’UFA étant une organisation crée et dirigée par des communistes, il est évident que sa ligne ne pouvait être en contradiction avec celle du Parti. Elle devait donc la corriger et l’orienter directement sur la dénonciation des médias du système colonial. Et elle devait, en même temps, s’adresser en priorité aux Algériennes.
Je ne me souviens pas des circonstances précises au cours desquelles s’est opérée cette reconversion, mais j’imagine qu’Alice Sportisse, qui avait participé au Comité central élargi de juillet 1946, en a été l’instigatrice au cours d’un congrès de l’UFA. C’est elle certainement qui m’initia à notre nouvelle ligne politique que notre secrétariat fur chargé d’appliquer.
Par ailleurs, dans le Parti, auquel j’avais adhéré en août 1945, j’ai participé aux différentes réunions où furent discutées et argumentées les graves erreurs commises au sujet des émeutes du 8 mai et la correction effectuée sur la ligne politique du Parti : dans ma cellule, ma section, le Bureau régional d’Alger et au Comité central où je fus élue en 1947, j’adhérai alors totalement à cette nouvelle orientation. Et au cours des mois qui suivirent, je pris pleinement conscience du décalage existant entre ce qu’était alors notre organisation et ce qu’elle devrait être, ainsi que sur les combats que nous devrions désormais mener.
Nous nous sommes donc astreintes à reconvertir fondamentalement notre ligne et nos objectifs. Ce qui n’a pas été sans problème avec uin certain nombre de nos adhérentes européennes. N’acceptant pas notre nouvelle ligne, beaucoup d’entre elles nous ont quittées. Nous en avons exclu d’autres, en particulier celles de Perrégaux (Mohammédia) qui s’étaient obstinées à célébrer une « Fête de Jeanna d’Arc » en mai 1947.
La composition de l’UFA s’en est ainsi trouvée transformée. Il faut souligner cependant que la composition de notre Conseil central ne subit aucune transformation du même genre : les démocrates européennes qui en faisaient partie y demeurèrent soudées aux communistes. Plus tard, je sollicitai madame Mandouze (l’épouse du professeur Mandouze, dont les positions ouvertement anti-coloniales eurent un impact positif sur un certain nombre de ses étudiants européens et le contraignirent, par la suite, à quitter l’Algérie), qui accepta de faire partie de notre Conseil central.
L’UFA eut alors deux Présidentes : madame Garoby, l’épouse du recteur de l’Académie d’Alger, qui avait assuré cette fonction depuis la création de notre organisation, et madame Djermane, l’épouse d’un commerçant d’Alger.
Parallèlement, des Algériennes intégrèrent notre conseil central : Baya Allaouchiche à Alger, et Abassia Fodhil à Oran.
Baya Allaouchiche rejoignit l’UFA peu après mon arrivée. Bien qu’elle ne m’en ait jamais parlé, je savais qu’elle n’était pas heureuse dans son ménage. Apparemment son mari n’approuvait ni ses convictions communistes, ni son militantisme permanent. Sans en tenir compte, elle s’est toujours dépensée sans compter pour organiser nos réunions de femmes dans les quartiers populaires et pour y participer pleinement.
Elle rejoignit d’abord le Conseil central de l’UFA où elle joua par la suite un rôle primordial avec Lydia Toru, qui avait milité avec ardeur à l’UFA, depuis les débuts de l’organisation. Puis elle fut élue au comité central du Parti.
Deux ans après le déclenchement de la Guerre d’indépendance, elle fut contraintte par la police de s’exiler en France où elle s’activa avec passion, comme toujours, pour aider les réseaux du FLN.
À l’indépendance, Baya demeura en France où elle put avec bonheur, s’étant remariée (avec Jacques Jurquet) et ayant fait venir ses enfants, fonder une nouvelle famille.
En 1994, me trouvant en France, alors que se développaient en Algérie les menaces destructrices de l’islamisme intégriste, je contactai Baya pour organiser avec elle une association dont le but était d’aider et de soutenir les associations féminines algériennes et pour les droits de la femme dans la famille et dans la société. Ainsi naquit le RAFD (le Rassemblement algérien des femmes démocrates) de Marseille, jumelle du RAFD d’Alger.
Pour faire connaître l’expérience enrichissante qui avait été la sienne et pour témoigner de la condition des Algériennes, elle écrivit deux ouvrages : « L’Oued en crue » (1979 – Éditions Sakina Ballouz ) et en collaboration avec Jacques Jurquet, « Femmes algériennes – De la Kahina au Code de la famille » (Édition le Temps des Cerises ).
Épuisée et malade, elle mourut en 2007 sans que j’ai pu, hélas, la revoir.
Abassia Fodhil a été elle aussi une militante exemplaire.
Pour contribuer aux dépenses du ménage (son époux, Secrétaire du Parti dans la région d’Oran, était très modestement rétribué comme tous les permanents) elle travaillait, pour un salaire misérable, dans des structures de conditionnement de fruits et légumes. Cela ne l’empêchait pas de militer activement en tant que Secrétaire de la section oranaise de l’Union des femmes et membre du Conseil central de notre organisation.
La Fédération démocratique internationale des femmes qui rassemblait les associations féminines progressistes du monde entier et à laquelle nous avions adhéré ainsi que l’AFMA (l’Association des femmes musulmanes algériennes), avait décidé d’envoyer une délégation en Corée, pour soutenir les femmes coréennes alors qu la guerre sévissait entre la Corée du Nord, soutenue par les Chinois et les Soviétiques, et la Corée du Sud, soutenue par les Américains.
Abassia fut alors désignée pour représenter notre organisation dans cette délégation. À son retour elle parcourut le pays pour raconter aux femmes, rassemblées par nos adhérentes, ce qu’elle avait vu. Mais nous n’avions pas mesuré alors combien ce voyage comportait de risques ; en effet, la délégation de femmes s’était trouvée souvent prise sous le feu des combats. Abassia en avait été traumatisée. Elle ne s’en plaignit jamais. Mais nous avons amèrement regretté de l’avoir choisie pour cette mission.
Quand l’OAS amplifia ses actions criminelles à Oran, Abassia et son époux, menacés, partirent se réfugier en France. Mais ils revinrent rapidement : décision fatale ! Opéré, Mustapha Fodhil se trouvait en clinique avec Abassia venue l’assister, quand un commando de l’OAS monta directement dans sa chambre et les abattit tous les deux.
À Oran, l’ex-rue Carnot, porte leurs deux noms, du boulevard de l’ALN à la rue Ben M’Hidi, près de la clinique d’Ophtalmologie, sur le Front de mer.
Il s’agissait maintenant de réorienter notre action et de définir de nouveaux objectifs. Ces derniers devaient être centrés sur la dénonciation des méfaits du système colonial sévissant en particulier sur les femmes et les enfants.
Une première bataille s’est imposée alors à nous. Un projet de Statut avait été élaboré pour l’Algérie et devait être présenté au Parlement français en septembre 1947. Ce projet prévoyait la création d’une Assemblée algérienne de 120 membres, dont soixante pour le Premier Collège, réservé presqu’exclusivement aux Européens, et soixante pour le Deuxième Collège réservé aux Algériens. Inégalité flagrante puisque la représentation du million d’Européens égalait celle des huit millions d’Algériens. Cette inégalité était encore plus inacceptable car elle s’accompagnait d’une discrimination brutale entre les femmes européennes et les femmes algériennes. En effet, si le Statut reconnaissait le droit de vote aux Algériennes, il en renvoyait la juridiction à la future Assemblée algérienne, qui n’en tiendra aucun compte. Ce n’est qu’en 1958 que le droit de vote sera enfin reconnu aux Algériennes.
Aussitôt le projet de Statut connu, nous avons réclamé l’inscription immédiate du droit de vote pour les Algériennes et nous avons organisé des manifestations dans ce sens. À Alger, les femmes répondirent à notre appel et se rassemblèrent massivement dans l’Opéra (aujourd’hui le Théâtre national, square Port-Saïd), où après un concert donné par une troupe féminine, elles adoptèrent une motion dénonçant la discrimination établie entre les femmes et réclamant le droit de vote pour les Algériennes.
Je me rendis à Sidi-Bel-Abbès où à l’initiative de la responsable de l’UFA, madame Justrabo, l’épouse du maire communiste de la ville, un millier de femmes traversèrent toute la ville pour déposer une motion similaire à la Sous-préfecture.
Cette campagne n’obtint immédiatement, bien entendu, aucun résultat concernant le droit de vote des Algériennes, qui demeurèrent exclues des élections. Mais le regard qu’elles portaient sur notre organisation se modifia à coup sûr.
Nombreuses furent celles qui nous rejoignirent et grâce à elles, grâce aussi à nos camarades Baya Allauchiche, Attika Gadiri, Abassia Fodhil et bien d’autres, nous pûmes élargir et consolider nos contacts avec les Algériennes. En maintes occasions, nous nous rendions dans les quartiers populaires d’Alger, la Casbah, Belcourt, la Cité Mahieddine, cet infâme bidonville en plein centre de la capitale, où végétaient des dizaines de milliers d’hommes et de femmes.
Là des amies rassemblaient des voisines, des parentes autour d’un thé l’après-midi et nous appelaient pour expliquer quels étaient les objectifs de l’Union des femmes et les actions que nous voulions mener avec elles pour tenter d’améliorer leur vie si difficile.
Pendant le ramadhan, je nous revois parcourant les rues de la Casbah pour nous rendre souvent dans de telles réunions après le ftour, d’où nous revenions, à deux heures du matin, enrichies pas ces discussions.
IV
Élaboré en 1947, le Statut de l’Algérie était censé permettre certes aux Algériens (et non aux Algériennes) de participer à la vie politique puisqu’ils pouvaient voter. Encore aurait-il fallu que ces élections se soient déroulées librement, or il n’en était rien. Sur les ordres du nouveau Gouverneur général de l’Algérie, Edmond Naegelen, elles étaient systématiquement truquées. Et les candidats nationalistes et communistes étaient écartés au bénéfice des candidats « béni-oui-oui ».
Ces « élections à la Naegelen », comme on les appelait, suscitaient une indignation généralisée. En été, quand le Parti organisait des randonnées sur les plages, nous accrochions sur les wagons du train ou, sur les vitres du bus, qui nous transportaient, des banderoles proclamant « Naegelen à la porte » et, aux fenêtres nous hurlions ce mot d’ordre de toutes nos forces.
Mon fils Pierre, qui avait quatre ou cinq ans, avait voulu reproduire, maladroitement bien sûr, la banderole que son père avait confectionnée à la maison et avec Norbert, son petit voisin, il l’avait brandie sur le balcon commun en criant « Naegelen à la porte », ce qui n’avait pas plu au père de ce garçon qui était un fonctionnaire du Gouvernement général.
Sur le plan économique, la situation des travailleurs était désastreuse. Les chefs d’entreprise, les colons, les armateurs relevaient la tête et refusaient toute augmentation des salaires.
Soutenus par les syndicats CGT, qui s’étaient considérablement renforcés, les travailleurs se lancèrent dans de puissants mouvements revendicatifs, en 1948, 1949, 1950. À l’UFA, nous soutenions les grévistes, nous participions à leurs manifestations et aidions leurs femmes. Chaque année, nous marchions, aux côtés des syndicalistes, lors des défilés du Premier Mai, encadrant des enfants et réclamant sur nos pancartes de meilleures conditions de vie et de travail pour les travailleuses.
Je me souviens d’une puissante manifestation qui déferla le long de l’avenue Amirouche. Au cours d’une fuite éperdue, talonnée par les CRS, je me trouvai séparée des militantes de l’Union des femmes et engagée dans les rangs des dockers. Je perdis alors une de mes chaussures, mais ne pus m’arrêter pour la récupérer. Et c’est un docker, qui, l’ayant ramassée, me rattrapa et me la tendit.
À Oran, en 1949, les dockers déclenchèrent une grève qui a marqué l’histoire sociale du pays. La guerre du Vietnam faisait rage alors et, tout en réclamant de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, ils refusaient de charger sur les navires les armes destinées aux troupes françaises engagés contre les Vietnamiens. À l’Union des femmes, en application de nos principes, nous décidâmes de soutenir les grévistes en entraînant leurs femmes. À Oran, la section régionale de l’UFA, qui comptait Abassia Fodhil, Gaby Gimenez, Joséphine Carmona et d’autres militantes et auxquelles je m’étais jointe, établit un plan que nous suivîmes à la lettre, après avoir contacté un certain nombre de femmes de grévistes.
À 5 heures du matin, ensemble, nous descendions sur le port où nous retrouvions les piquets de grève avec lesquels nous tentions de faire barrage aux « jaunes », ces Algériens très pauvres et sans travail, qui étaient recruté par les armateurs pour casser la grève. En même temps, nous devions faire face aux forces de sécurité, policiers et CRS, qui nous chargeaient.
Les femmes de grévistes étaient remarquables de combattivité et de courage. Pour faciliter leur course, elles furent nombreuses à retirer leurs haïks qu’elles enroulèrent autour de leur taille
En nous donnant la main, nous formions ainsi de longues chaînes pour fermer l’accès au port.
Un jour, nous ne pûmes cependant empêcher les policiers d’arrêter quelques manifestantes. Nous montâmes alors vers le quartier de la Marine et, devant le commissariat où elles étaient détenues, nous réclamâmes avec force leur libération et, pour l’obtenir, nous nous allongeâmes sur le sol, obstruant la rue. Cette manifestation fut payante car nos camarades et amies furent assez rapidement libérées.
L’après-midi, nous nous rendions à la Maison du Peuple, où dans la cour, les dockers faisaient le point sur leur combat avec leurs représentants syndicaux. Et nous, nous montions au premier étage où les femmes de grévistes se rassemblaient, plus nombreuses de jour en jour, et avec elles nous décidions d’un plan d’action pour le lendemain.
Bachir Hadj Ali vint à Oran pour suivre la grève de plus près et c’est mon père Jean-Marie Larribère, qui le transporta dans sa voiture. Soupçonné d’avoir été l’artisan de ce conflit, mon père fut arrêté et détenu pendant quelques jours.
La grève n’en finissant pas, le mouvement s’amplifia alors. Les travailleurs oranais, Algériens et Européens confondus, déclenchèrent une grève générale. Une puissante manifestation fut organisée à l’occasion du passage à Oran du frère du général de Gaulle. Pour éviter des heurts préjudiciables, le Parti chargea les militantes de retirer aux manifestants les « armes » qu’ils envisageaient de lancer sur les forces de l’ordre. Nous parcourûmes alors leurs rangs en récupérant œufs, tomates et surtout, chez les métallos, des lourds boulons qui emplissaient leurs poches.
Le lendemain, une nouvelle et puissante manifestation, partit de la Maison du Peuple, les femmes s’étant postées au premier rang. Soudain, nous barrant la route, des soldats braquèrent leurs armes sur nous. La peur au ventre, nous continuâmes quand même à avancer. Les soldats tirèrent et des manifestants, derrière nous, furent atteints.
C’est cette dernière manifestation qui, cependant, fit plier les autorités et le patronat. Des discussions s’engagèrent avec les syndicats et dockers et ouvriers obtinrent enfin en partie gain de cause.
Ces résultats, même s’ils n’étaient pas aussi importants qu’ils le paraissaient alors, ont été ressentis comme une grande victoire, obtenue grâce aux luttes très dures qui avaient été menées par les travailleurs oranais, Algériens et Européens.
V
Parmi les actions que notre association entreprenait, il en était une qui nous tenait particulièrement à cœur : il s’agissait de l’inscription des petits Algériens à l’école française.
Comme en France, l’école française était alors obligatoire pour les petits Européens, mais non pour les Algériens.
Chaque année, au début d’octobre, le scénario était le même : chaque enfant européen était admis à l’école. Mais les petits Algériens ne pouvaient y accéder qu’au prorata des places disponibles. La grande majorité des enfants algériens, surtout dans les campagnes, étaient donc exclus. Il ne leur restait alors que l’école coranique que les enfants scolarisés à l’école française fréquentaient aussi mais en dehors des heures de classe et pendant les vacances. À la rentrée des classes, on pouvait voir, de bonne heure, devant chaque école, des files d’enfants, accompagnés de leurs parents, qui attendaient en vain d’être reçus. Mais je n’ai pas le souvenir d’y avoir vu nombre de filles.
Dans la continuité de nos actions contre les discriminations flagrantes dont la société algérienne était victime, nous décidâmes d’élever notre voix à ce propos. Dans les quartiers populaires d’Alger et d’Oran surtout, nos adhérentes contactaient les femmes dont les enfants n’avaient pas été admis ou risquaient de ne pas l’être. Et chaque année, à la rentrée des classes, nous rassemblions ces femmes et ensemble, nous nous massions devant quelques écoles en protestant haut et fort contre cette discrimination supplémentaire.
Je ne sais plus trop si ces actions ont permis l’inscription de nombreux enfants. Mais elles nous ont rapprochées, elles aussi, des femmes des quartiers populaires.
Comme l’ont fait aussi celles que nous avons menées, en collaboration avec leur section syndicale, pour les femmes travailleuses, et en particulier les femmes de ménage, surexploitées dans les familles européennes.
Là, nous avons travaillé ensemble avec mon amie et camarade Blanche Moine, une militante infatigable, l’une des responsables de la CGT (algérienne) et de l’UGSA, la Centrale syndicale qui a succédé à la CGT, et au côté de laquelle j’ai souvent participé à des manifestations de rues. Durant la guerre d’indépendance, elle a été arrêtée et sauvagement torturée et sa santé en a été gravement détériorée.
C’est avec une vive émotion que je l’ai retrouvée à Paris, à l’indépendance, mais elle mourut rapidement.
L’UFA s’est impliquée aussi dans d’autres actions, et d’abord le recueil de signatures au bas de l’Appel de Stockhölm, cet Appel à la paix, rédigé en pleine « guerre froide » par de nombreux savants et intellectuels, réunis à Stockhölm, en raison des menaces de guerre qi pesaient sur le monde.
Nous nous sommes donc attelées à cette tâche, effectuant de nombreux porte à porte, pour recueillir ces signatures. Je n’ai plus leur nombre en mémoire, mais dans mon souvenir, il était important.
Chaque année nous organisions de grands rassemblements pour célébrer, le 8 mars, la Journée internationale de la femme.
En 1953 et 1954, c’est avec l’AFMA (Association des femmes musulmanes algériennes), nationaliste, que nous avons organisé ces rassemblements. Leurs deux dirigeantes étaient Mamia Chentouf et Nefissa Hamoud (Nefissa Lalliam, disparue hélas aujourd’hui), avec lesquelles nous avons toujours entretenu d’excellents rapports. C’est avec une grande joie que j’ai revu Mamia Chentouf à l’indépendance, après une si longue absence.
VI
Il serait peut-être temps, pour moi, de jeter un œil critique sur toute cette période qui va de 1945 à 1952 et durant laquelle je militais à l’UFA.
Il est vrai que nous étions toutes fières de ce que nous faisions alors pour entraîner les femmes – essentiellement les Algériennes – dans de multiples actions. Mais pour les entraîner vers quel but ?
Certes, j’étais persuadée, nous étions persuadés au Parti Communiste Algérien que le temps filait rapidement vers le déclenchement de la guerre de libération. Je savais que cela se produirait dans les années prochaines et le déroulement de la guerre au Vietnam, que nous suivions attentivement, était là pour nous le rappeler jour après jour. Je me souviens de l’enthousiasme qui nous a toutes et tous soulevés plus tard, en mai 1954, lors de la victoire de Dien-Bien-Phu, qui annonçait l’indépendance du Vietnam. Nous ne savions pas alors que six mois plus tard, nous entrerions à notre tour dans la guerre qui nous mènera à l’indépendance.
Certes, lors des réunions de femmes que j’ai décrites plus haut, nous évoquions tous ces événements tout en dénonçant les méfaits du système colonial. Mais nous ne franchissions jamais la ligne rouge que nous nous étions fixée, sans nous concerter et sans en être vraiment conscientes, et au-delà de laquelle nous n’évoquions jamais la perspective de l’entrée de notre peuple dans la lutte pour son indépendance.
Il est vrai que nous craignions sans doute la répression qui n’aurait pas manqué de s’abattre sur notre organisation si nous avions osé franchir cette ligne rouge.
Il était un autre problème que nous ne soulevions pas non plus : celui du statut des Algériennes. Certes, nous nous étions battues pour réclamer pour elles le droit de vote. Mais là aussi, nous n’allions pas plus loin, nous ne concevions pas la nécessité de dénoncer leur situation de mineures dans la famille et dans la société et de réclamer pour elles des droits égaux à ceux des hommes.
En ce qui concerne le statut des femmes, nous nous sommes contentées, parfois, de reproduire les positions de l’Union des femmes françaises, qui déclarait que les droits de la mère de famille, de la travailleuse et de la citoyenne devaient être « consacrés », comme le précise Fatma Zohra Saï dans son ouvrage : « Mouvement national et question féminine ». Certes nous rassemblions dans ces mots d’ordre Algériennes et Européennes, mais sans souligner la situation particulière des Algériennes.
Quelles en étaient les raisons ?
- Tout d’abord il était clair, à la naissance de l’UFA, composée en quasi-totalité d’Européennes, que la situation particulière de la femme algérienne ne pouvait être perçue. Plus tard, quand l’UFA eut rectifié sa ligne éditoriale et quand, avec l’afflux des Algériennes, nous prîmes conscience de leur sort, notre position demeura inchangée.
- Dans son ouvrage cité plus haut, Fatma Zohra Saï signale que l’AFMA (l’Association des femmes musulmanes algériennes), nationaliste, avait évité aussi de soulever ce problème.
- Certes, la situation des Algériennes était complexe alors, dans une société soumise à la domination coloniale. Elle était doublement opprimée à la fois par le système colonial et par un statut personnel qui la soumettait totalement à l’homme : père, époux, frère.
- Mais il nous était difficile de poser les problèmes des droits des femmes, d’une part parce que la condition de la femme au sein de la famille algérienne était un sujet pratiquement tabou et d’autre part et surtout parce qu’il nous semblait alors impossible de mettre au premier plan de nos revendications le sort des algériennes, alors que l’essentiel de nos préoccupations et de celles de tout le mouvement national était axé sur l’avenir immédiat où allait se jouer le sort du pays. Abattre le système colonial, en finir avec la domination coloniale était au premier plan de nos préoccupations, l’émancipation de la femme étant alors renvoyée aux calendes grecques.
- Il est, hélas, à déplorer que près de cinquante ans après son indépendance, l’Algérie n’ait pas encore mis fin à la discrimination intolérable que subissent les femmes, alors qu’elles ont participé en masse à la libération du pays, assumant pleinement leurs responsabilités, bravant la mort à égalité avec les hommes ; alors que des milliers d’Algériennes ont été kidnappées, violées, égorgées par les intégristes du FIS et du GIA dans les razzias de nos villages, dans les faux barrages ou tout simplement les rues de nos violles et jusqu’au sein de nos écoles, au cours d’une terrible décennie que le pouvoir actuel voudrait faire passer à la trappe, mais qui ne cessera jamais de nous hanter.
- C’est à ces femmes que nos associations féminines doivent dédier leur combat contre le Code de la Famille, ce « code de l’infamie » qui fait des femmes des mineures à vie, même après avoir été quelque peu « amélioré » par des amendements secondaires qui sont d’ailleurs rarement respectés dans l’administration.
- Il est enfin un autre point que je tiens à souligner : il s’agit des rapports que l’UFA entretenait avec le PCA. Très souvent, il était dit (ou écrit) que notre organisation se trouvait sous le contrôle du PCA et que son orientation et ses actions étaient dictées par lui.
Certes, étant membre du Comité central du Parti, ainsi que Baya Allaouchiche, nous adhérions pleinement à sa ligne éditoriale. Mais nous n’en avons jamais reçu de directives.
Lors des réunions de cet organe dirigeant du Parti, nous informions nos camarades de l’orientation que nous avions définie pour notre organisation et des actions que nous entreprenions dans ce cadre. Et nous n’avons jamais sollicité le moindre conseil ou la moindre suggestion dans la gestion de l’UFA.
C’est notre Conseil central, dont la majorité des membres n’était pas communiste, qui avait décidé d’abord, sur notre suggestion, d’engager l’organisation dans le combat contre le système colonial. C’est lui aussi qui, au cours de ses réunions régulières, décidait des actions à entreprendre en conformité avec sa nouvelle ligne éditoriale.
À L’ÉQUIPE DE JOUR
D’ « ALGER RÉPUBLICAIN »
Au début de 1952, je quittai l’Union des femmes pour aller travailler à « Alger républicain ».
Les locaux du journal étaient situés boulevard Laferrièrze (aujourd’hui le boulevard Khemisti), à l’emplacement de ceux de la « Dépêche quotidienne », l’un des quotidiens provichyste d’Alger, qui avaient été interdits. Son imprimerie se trouvait à l’arrière du bâtiment. Elle était dirigée par la SNEP (Société nationale des entreprises de presse) qui était chargée de gérer les imprimeries des journaux interdits. Le bâtiment est aujourd’hui occupé par la Fédération algéroise du RND ?
Aux côtés d’Henri Alleg, directeur du journal, et de Jacques Salort, son administrateur, la Rédaction était dirigée par Boualem Khalfa et Isaac Nahori (qui vient récemment, hélas, de s’éteindre) auxquels se joignit plus tard Hamid Benzine. Chaque jour, à 14 heures, nous nous réunissions tous, équipe de jour, équipe de nuit, rubrique des correspondants, rubrique sportive etc… Au cours de ces réunions, sous l’œil vigilant d’Henri Alleg, nous relevions les erreurs et les insuffisances du numéro du jour et nous établissions ensemble le contenu du numéro du lendemain.
L’équipe de nuit était dirigée par Henri Zanettaci, qui mourra plus tard, encore jeune, d’une maladie pulmonaire contractée en raison de son travail pour l’impression du journal. L’équipe assurait la mise en page du journal et tous ses aspects techniques indispensables.
La direction de l’équipe de jour m’avait été confiée. Cette équipe était chargée d’informer nos lecteurs sur tout ce qui se passait d’intéressant à Alger et dans l’Algérois. Cela allait des « chiens écrasés » aux réunions du Conseil municipal et de l’Assemblée algérienne, aux procès politiques intentés aux dirigeants du Mouvement national, nationalistes et communistes, procès qui se multipliaient au fur et à mesure que s’amplifiaient les aspirations de notre peuple à l’indépendance.
S’ajoutaient à tout cela les enquêtes économiques réalisées par Nicolas Zanettacci. L’une de ces enquêtes fit grand bruit, elle concernait es cités Diar es Saada et Diar el Mahçoul qui étaient construites avec de la « pierre qui pleure ». Cette pierre était importée de France, au bénéfice du maire d’Alger, Jacques Chevalier, et son surnom s’expliquait par le fait, disait Zanettacci, qu’elle « suait » l’humidité.
L’équipe du journal était toute particulière, il faut le souligner. Dans la rédaction ou l’administration, le personnel était d’origine diverse : Algériens ou Européens, musulmans, chrétiens, juifs ou athées, communistes ou non, ils travaillaient ensemble, poursuivant le même but, dans des conditions difficiles, acceptant malgré tout des salaires réduits et souvent retardés : assurer coûte que coûte la parution du journal, miracle de chaque jour ; contrôler exactement l’exactitude de nos informations, refléter dans les moindres articles la ligne éditoriale immuable, du journal, en énonçant les méfaits du système colonial, les injustices flagrantes, la surexploitation et la répression forcenée qui s’abattaient sur notre peuple.
« Alger républicain » était alors le seul quotidien anticolonial d’Algérie. Son rayonnement était important. Il se vendait dans tout le pays et ses correspondants étaient très nombreux.
Par ailleurs il jouait un rôle primordial pour le rassemblement de toutes les forces opposées au système colonial ; des communistes aux nationalistes et aux progressistes européens.
En particulier, j’ai le souvenir de ces militants du M.T.L.D. (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques), successeur du PPA, et de ceux de l’U.D.M.A. (Union démocratique du Manifeste algérien) qui venaient nous rendre visite en toute amitié.
Cela était, bien entendu, intolérable pour l’administration coloniale. Et c’est pourquoi la SNEP, misant sur la fragilité financière du journal (qui s’expliquait en partie par le fait qu’un seul numéro était bien souvent lu ou se faisait lire par plusieurs lecteurs), s’ingéniait à le mettre en difficulté, exigeant en particulier le paiement cash de son impression et du loyer de ses locaux.
Cette situation si difficile fut, pendant toutes ces années et surtout après le 1er novembre 1954, le cauchemar quotidien d’Henri Alleg et de Jacques Salort. Mais les efforts de la SNEP et de l’administration coloniale demeurèrent vains grâce au courage, et à la détermination intransigeante de la Direction, de la Rédaction et de toute l’équipe du journal.
Dans les mois qui suivirent le déclenchement de la guerre, la situation d’ « Alger républicain » devint très critique avec l’installation d’une Commission de censure, qui supprimait certains articles, interdisait ensuite les espaces blancs qui les avaient remplacés et suspendait le journal. « Alger républicain » dit la vérité, mai ne peut pas dire toute la vérité ». Telle était la déclaration judicieuse, publiée chaque jour sur la Une du journal et qui ne pouvait être censurée.
Au début juillet 1955 Henri Alleg fut arrêté et condamné à trois mois de prison pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ».
Parmi les événements tragiques qui avaient suscité l’indignation et la mobilisation d’« Alger républicain », il en fut un qui nous a particulièrement bouleversés, et me bouleverse toujours aujourd’hui, c’était la menace d’exécution qui pesait sur les époux Rosenberg aux Etats-Unis.
Accusés d’espionnage au profit de l’URSS, Julius et Ethel Rosenberg, des sympathisants communistes, avaient été condamnés à mort, par électrocution, en 1951. C’tait en pleine période du Maccarthysme, cette terrible chasse aux sorcières qui, sous la houlette du sénateur Mac Carthy s’était attaqué à de nombreux intellectuels, artistes, hommes politiques, journalistes etc., en les taxant – souvent à tort d’ailleurs – d’être communistes. À noter qu’en 1954, le sénat désavoue Mac Carthy.
Julius était accusé d’avoir transmis à l’URSS des informations accompagnées de dessins, sur la fabrication de la bombe atomique. C’tait le frère d’Ethel qui, sous la pression des Services secrets (ou de la CIA), avait lancé cette « dénonciation » mensongère. Plus tard, des experts en la matière ont déclaré que ces « informations » et ces « dessins » n’auraient jamais pu aboutir à la fabrication de la bombe. Aujourd’hui on a renoncé à l’accusation qui a conduit les époux Rosenberg à la mort et on l’a transformée en « espionnage économique », ce qui est toujours un pur mensonge.
Julius Rosenberg a toujours proclamé son innocence, ainsi qu’Ethel, qui avait été accusée d’avoir tapé à la machine les « informations » incriminées. En prison, on lui a proposé à maintes reprises d’annuler sa condamnation à mort en échange de ses aveux, ce qu’elle a toujours refusé.
Le sort tragique des époux Rosenberg a suscité une très vive émotion dans le monde entier. D’innombrables pétitions ont été signées et d’éminentes personnalités, tels la reine d’Angleterre et le Pape, sont intervenues auprès du président des Etats-Unis, le maréchal Eisenhower, qui est demeuré inflexible. Zen Algérie, la campagne de protestation, impulsée par le PCA, a été également très importante.
La force de cette protestation mondiale et, assurément l’action inlassable des avocats des époux Rosenberg ont permis l’introduction de multiples recours judiciaires, lesquels ont repoussé les exécutions jusqu’en 1953. À ce moment là, nous avons affiché, sur la façade du journal, des photos géantes de Julius et Ethel. Et nus avons été chargés, à l’équipe de jour, de recueillir dans le hall, quelques une des déclarations des nombreux hommes et femmes qui s’y pressaient.
Dans la nuit du 19 juin 1953, je nous revois tous rassemblés devant le téléscripteur (l’appareil qui, à l’époque, nous transmettait des informations), espérant malgré tout une ultime suspension de l’exécution d’Ethel, Julius ayant déjà été exécuté, et apprenant ensuite, dans l’angoisse et la douleur, l’annonce de la fatale nouvelle.
Pendant sa détention, Ethel Rosenberg a longuement correspondu avec ses deux fils, leur adressant en particulier des poèmes. Après sa mort, ces lettres et ces poèmes ont été rassemblés dans un livre. Et Jean Ferrat s’en est inspiré dans un de ses chants les plus beaux intitulé « Si nous mourons ».
Ethel écrivait :
Vous apprendrez un jour mes fils
Vous apprendrez pourquoi nous reposons sous terre
Le livre à moitié lu le chant interrompu
Et la besogne inachevée
Ne pleurez plus mes fils
Mes fils ne pleurez plus
Le monde entier saura
Le pourquoi du mensonge et de la calomnie
Le monde entier saura nos pleurs et notre peine
Joyeux et vert mes fils
Mes fils joyeux et vert
Sera le monde au-dessus de nos tombes
Les tueries cesseront la terre fleurira
Dans la paix fraternelle
Travaillez construisez mes fils
Un monument à l’amour à la joie
À la valeur humaine
Et à la foi que nous avons gardée
Pour vous mes fils
Mes fils pour vous.
Je me souviens aussi, en avril 1952, le Parti organisa une manifestation sur la petite place en face de la prison Serkadji (Barberousse alors), dans la Haute Casbah, pour saluer et soutenir les détenus nationalistes de l’OS (l’Organisation spéciale) au moment où dans leurs fourgons, ils réintégraient la prison, au retour du Palais de justice. À « Alger républicain », nous fûmes nombreux à aller y participer. La police accourut aussitôt, arrêtant de nombreux militants et se jetant sur les enfants qui avaient envahi la place. Je me lançai alors en hurlant pour protéger les gosses et arrêtée, je fus « jetée » (sic) dans le commissariat.
Le lendemain, rue d’Isly, (aujourd’hui rue Ben M’hidi) une femme voilée en haïk blanc, m’arrêta et m’embrassa, m’expliquant qu’elle m’avait vue la veille sur la place, du haut de son balcon, et qu’elle m’avait reconnue car je portais en effet la même « veste rouge ». Kateb Yacine qui avait participé à cette manifestation, écrivit ensuite un poème, « Le fourgon cellulaire » , (voir annexe I).
Le 14 juillet 1955, deux mois donc avant son interdiction, « Alger républicain » eut la géniale idée de publier intégralement le texte de « La Marseillaise », l’hymne national français, dont certaines des strophes collaient parfaitement à la lutte du peuple algérien pour son indépendance. En ripostant ainsi à la répression forcenée du gouvernement général et de l’administration coloniale, ce numéro du journal nous plongea tous dans la joie et l’enthousiasme et nous récompensa des efforts fournis et des graves problèmes qui étaient notre lot quotidien.
Je voudrais m’attarder sur l’un de mes camarades Abdelkader Choukhal, le benjamin de l’équipe de jour qui, rêvant de devenir un véritable journaliste, travaillait d’arrache-pied, apprenant le métier « sur le tas ». Chaque jour il visitait les commissariats d’Alger, pour recueillir les faits divers intéressants. Il avait su même établir des contacts avec un jeune rédacteur du « Journal d’Alger », un quotidien algérois, dont les locaux se trouvaient près des nôtres, qui lui passait de temps en temps des informations qui auraient pu nous échapper.
Il rédigeait ensuite des « papiers » et me les apportait pour que je corrige ses fautes et lui apprenne une meilleure manière de présenter ses informations. Il absorbait ces corrections avec la volonté évidente de s’améliorer. Très vite donc, il fit des progrès remarquables.
Mais Abdelkader Choukhal n’a pas pu poursuivre son travail de journaliste. Il a été abattu, selon Mohamed Téguia, fin 1956 dans les maquis de Palestro qu’il avait rejoints pour poursuivre, durant la guerre, le combat qu’il avait mené à « Alger républicain » contre l’Etat colonial.
Bien plus que tout autre, le sort tragique de Choukhal m’a fortement tourmentée. Après l’interdiction du journal, en septembre 1955, il vint en effet me trouver pour e demander ce qu’il devait faire : pouvait-il partir en France comme le lui proposait un cousin installé à Lyon ?
Que pouvais-je, que devais-je lui répondre ?
J’étais certes fortement émue par la confiance qu’l me manifestait ainsi, mais ma réponse pouvait–elle être en contradiction avec mes convictions profondes ? J’ai commencé par lui dire qu’il devait prendre sa décision après avoir mûrement réfléchi. Je ne me souviens pas des termes exacts que j’employai ensuite, mais ils peuvent se résumer ainsi : « C’est ici en Algérie que se joue l’avenir du pays. La guerre sera dure, elle nécessite la mobilisation de tous les patriotes ».
Ai-je eu raison de lui parler ainsi ?
Je ne sais plus pourquoi c’est moi qui ai reçu, par téléphone, dans mon bureau, l’annonce de la terrible nouvelle.
Notre camarade Justrtabo, maire de Sidi-Bel-Abbès, m’apprit ainsi qu’il avait été destitué de sa fonction, que le Parti était dissous, ainsi que plusieurs associations, dont l’Union des femmes, et qu’ « Alger républicain » était certainement menacé.
Henri Alleg se trouvant alors absent, je courus en informer Jacques Salort qui travaillait encore dans son bureau.
Il était très tard. L’angoisse au cœur, nous avons attendu la sentence. Elle ne tarda pas à se manifester ; un commissaire de police, flanqué d’inspecteurs et de policiers, se mit à crier et à tambouriner sur la grille clôturant les escaliers qui descendaient à l’imprimerie, et que nous tenions toujours bouclée.
Furieux, Jacques Salort protesta avec force contre une telle intrusion. Mais finalement la grille dut être ouverte et l’escouade se répandit dans les bureaux. Puis sans ménagement, nous fûmes tous mis à la porte.
Abattue, je regagnai, non loin de là, mon logis. Il était deux heures du matin quand je pénétrai chez moi, pour y trouver, sous l’œil impavide et narquois de mon époux, Robert Manaranche, des policiers qui perquisitionnaient notre logement.
Ainsi prit fin La grande aventure d’ « Alger républicain ».
CLANDESTINE
PENDANT LA GUERRE
DE LIBÉRATION NATIONALE
1er novembre 1954 : premier jour d’une guerre qui, allait, après presque 6 ans, de terribles souffrances et d’horreurs, mettre fin à 132 ans d’un régime colonial d’une férocité sans pareil.
Le Parti Communiste Algérien (le PCA) a été dissous le 20 septembre 1955 et ses dirigeants sont entrés aussitôt en clandestinité. Bachir Hadj Ali y avait été contraint auparavant car il avait été condamné pour « atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat », selon la formule consacrée utilisée par les tribunaux colonialistes et risquait donc d’être emprisonné.
Le Parti s’était bien évidemment préparé à cette éventualité en dissimulant le matériel destiné à l’impression de notre journal « Liberté », de documents et de tracts.
Bien avant les Accords FLN-PCA, qui n’interviendront qu’en 1956, des militants des Aurès, parmi lesquels Guerrouf, un paysan, et Lamrani, un avocat, bâtonnier de Batna, tous deux membres du Comité central, auxquels s’était joint Georges Raffini, secrétaire administratif du Parti, qui avait combattu aux côtés des républicains durant la Guerre d’Espagne, étaient montés au maquis sur leur propre initiative, mais avec l’accord du Parti. Ils rejoignaient ainsi les nombreux paysans communistes des Aurès qui combattaient déjà dans l’ALN.
N’ayant pas réussi, en dépit de multiples tentatives, à obtenir du FLN l’incorporation des communistes dans les katibate de l’ALN, le Parti se résigna, en juin 1955, à organiser ses propres groupes armés, les « Combattants de la Libération » CDL) dont la direction était composée de Bachir Hadj Ali, Sadek Hadjerès, et Jacques Salort.
Ces réunions se déroulaient chez un camarade, un cheminot européen, dont le logement se situait à Hussein-Dey, derrière l’hôpital Parnet.
I
L’histoire retiendra les noms de ces camarades héroïques qui, en CDL convaincus, se lancèrent dans des actions armées : Fernand Iveton, condamné à mort, puis exécuté, Jacqueline et Djilali Guerroudj, qui furent tous deux condamnés à mort, puis à un emprisonnement à vie, Yahia Briki, condamné à perpétuité, Raymonde Peschard abattue dans le maquis, la fille de Jcqueline Guerroudj, Djamila Amrane, Pierre Guenassia, tombé au maquis. Est-il vrai que la rue qui portait son nom à Ténès a été débaptisée ? S’il en était ainsi, que dire de ces responsables municipaux qui ont préféré modifier le nom de cette rue plutôt que d’admettre que Pierre pouvait être à la fois un moudjahid mort pour la libération de sa patrie et un Juif communiste ?
L’histoire retiendra surtout le nom d’Henri Maillot, cet ancien militant de l’administration d’ « Alger républicain ».
Aussitôt qu’il avait été rappelé, pour trois mois, dans l’armée française en tant qu’aspirant de réserve, il en avait informé le Parti et s’était déclaré prêt à agir en conséquence. L’occasion s’en était présentée bientôt : il avait en effet été chargé d’acheminer à Alger un camion chargé d’armes.
Aussitôt avertis, Bachir hadj Ali et Sadek Hadjerès avaient organisé minutieusement la mise en place du piège dans lequel devait tomber le camion. Comme prévu, il avait été alors subtilisé, dans la forêt de Baïnem, par les combattants de la libération, entre autres Jean Farrugia, jean Clément, Joseph Grau.
À l’exception des armes conservées pour le « maquis rouge » et les actions des CDL, la totalité des autres avaient été transmise au FLN, le camion où elles avaient été chargées traversant Alger et Blida en plein jour au nez et à la barbe des soldats et des gendarmes, grâce au courage et au sang-froid de nos camarades, dont Odet Voirin, militant communiste de Blida.
Et la rencontre FLN-PCA tant souhaitée par le Parti avait pu enfin avoir lieu en mai 1956. Les pourparlers s’étaient prolongés durant les mois de mai et juin et c’est le 1er juillet qu’avaient été signés les célèbres Accords-FLN-PCA, avec les signatures de Bachir Hadj Ali et Sadek Hadjerès pour le PCA, d’Abane Ramdane et Benyoucef Benkheda [13]pour le FLN.
En sortant de la première de ces réunions, Bachir nous avait raconté qu’au début cela s’était mal passé, Abane Ramdane ayant brandi la carte du Parti, selon Bachir (la carte d’identité, selon Mohamed Teguia) d’Abdelkader Choukhal, nous accusant de vouloir noyauter l’ALN. Et Bachir avait protesté avec véhémence, puis le calme s’était rétabli.
Les Combattants de la libération avaient été alors acceptés individuellement dans les maquis de l’ALN.
La suite est connue : Henri Maillot a été exécuté, ainsi que les paysans communistes qui l’accompagnaient, par l’armée française dans le « Maquis rouge », dans l’Orléansvillois.
Contrairement à certaines critiques, la région avait été bien choisie : l’ALN ne s’y était pas encore implantée d’une part et, d’autre part, les paysans communistes y étaient nombreux en raison des actions d’entraide et de soutien menées par le parti et diverses associations, dont l’Union des femmes, après le séisme qui s’était abattu sur la région de Chlef (Orléansville à l’époque) en septembre 1954.
Chaque année, le 6 juin, les camarades d’Henri Maillot, auxquels se joignent nombre de patriotes, commémorent dans le cimetière de Madania (Clos Salembier), la mémoire de ce héros authentique.
II
Au cours de l’été 1956, je fus chargée d’assurer une liaison avec notre réseau d’Oran, ce que je fis par l’intermédiaire de deux de mes sœurs, Paulette et Aline Larribère, qui y militaient activement.
Peu après, le réseau d’Oran fut démantelé et mes deux sœurs furent arrêtées, ainsi que nombre de nos camarades.
Aussitôt alertée par mon père, je me réfugiai chez une amie française, en attendant de savoir, par leurs avocats, si mon nom et le but de ma visite à Oran avaient été signalés, mais mes sœurs demeurèrent muettes.
Sur le point de revenir à l’air libre, j’appris alors par Robert Manaranche que la police était venue m’arrêter à notre domicile pour m’expulser en France.
Elle avait procédé de cette façon à l’encontre d’un certain nombre de militantes communistes connues, les empêchant ainsi de participer aux activités clandestines du Parti. C’est à ce moment-là que Baya Allaouchiche fut exilée à Marseille.
Après avoir ainsi échappé miraculeusement à cette expulsion, j’entrai alors définitivement en clandestinité.
Je suis incapable aujourd’hui de retracer dans le détail le déroulement des jours, et même des quelques semaines qui suivirent. Il semble s’être effacé définitivement de ma mémoire.
Pourquoi ?
Certes je savais que tôt ou tard, je serai contrainte de changer de vie. Je m’y étais préparée mentalement. Mais le jour dit, quand je quittai la maison, ce 4 septembre 1956, bouleversée et angoissée, j’avais le sentiment de plonger dans l’inconnu.
Que se passerait-il pour mes deux enfants, Pierre (10 ans) et Jean (4 ans) ? Quand je m’étais rendue à Oran au début juillet, j’avais demandé à mes parents de prendre les enfants en charge si Robert et moi étions arrêtés. En octobre, j’avais déjà plongé dans la clandestinité. Après les vacances d’été, Jean était donc resté à Oran et Pierre avait rejoint son père à Alger. Et le soir même j’avais repris le train pour Alger, tourmentée.
Les reverrai-je ? Quand les reverrai-je ?
Pendant un certain temps, j’ai pu correspondre avec eux par l’intermédiaire d’une amie à Oran. J’avais même reçu une photo d’eux, attristés devant un arbre de Noël et j’en avais été bouleversée. Mais après quelques temps, cette correspondance prit fin et je n’eus plus de nouvelles d’eux.
Mais mon père continua à écrire à Jean, sous ma signature, et ce dernier crut qu’il me répondait. Mais un jour, cherchant un livre dans la bibliothèque, il tomba sur le lot de ses lettres que mon père avait conservées pour me les faire lire à mon retour. Et à midi, il annonça froidement à ma sœur Paulette (étudiante en médecine mais qui se trouvait à Oran après la grève des étudiants en mai 1956) qu’il savait que j’étais morte. Ma sœur protesta avec force et lui expliqua ce qui m’était arrivé.
À Alger, m’étant rendue chez une camarade, peu après mon entrée en clandestinité, je me mis au balcon en attendant qu’elle soit libre. Je m’aperçus alors qu’au-delà de bâtiments assez bas, je pouvais voir « ma » rue, l’ancienne rue Négrier, parallèle à la rue Ben M’hidi, et la façade de mon appartement. Et soudain, je vis mon fils Pierre sur l’un des balcons, celui de la chambre ou celui de la cuisine, qui vérifiait si ses camarades étaient là, devant l’école mitoyenne, à l’heure de la rentrée en classe de l’après-midi.
En 1957, Robert Manaranche avait été arrêté. Relâché trois ans plus tard, il avait été expulsé en France. Pierre l’avait rejoint alors, Jean étant resté à Oran. Quand les menaces de l’OAS s’étaient faites plus directes, ce dernier avait rejoint son père à Paris.
Il est inutile de souligner combien cette séparation fut douloureuse durant ces huit années. Pour eux et pour moi.
Que dire d’autre ? C’est cette angoisse incessante dans cette nouvelle vie, qui balaya peut-être de ma mémoire certains des événements qui suivirent. Je devais faire le vide dans ma tête, à l’heure où toute mon attention devait se concentrer sur les moindres de mes faits et gestes.
De cette période, ma mémoire n’a conservé que quelques flashes décousus.
Je nous revois ainsi, Bachir, Sadek, Jacques Salort et moi, errant dans la nuit en voiture à la recherche d’un gîte sûr, pour nous retrouver finalement chez une camarade de Bab el Oued, Lucette Puisservert, une institutrice (à la retraite ?), qui nous accueillit chaleureusement.
Je me revois aussi (étais-je seule ?) tombant sur un déploiement de forces policières qui rassemblaient et entraînaient brutalement tout un groupe d’Algériens, vers quel lieu de supplice ?
Je me revois encore traversant le cimetière européen de Saint-Eugène pour déjouer d’éventuels poursuivants et me heurtant, à la sortie, à un groupe de policiers manifestement aux aguets.
Je reconnus aussitôt le commissaire qui les conduisait : il était celui qui sévissait dans mon quartier. Le cœur battant, je m’empressai de m’éloigner pour aller déambuler dans un autre quartier, avant de regagner ma « planque ».
En février 1956, j’étais alors libre encore, je tombai par hasard un matin en revenant chez moi, sur une foule d’Européens qui s’était rassemblée place Laferrière face à la Grande Poste et qui manifestait une hostilité forcenée à l’encontre du Premier ministre français, Guy Mollet, jetant sur son escorte des quantités de projectiles divers. Je m’étais éloignée aussitôt.
Guy Mollet avait été élu avec une majorité de gauche. Et il avait fait voter les « pleins pouvoirs » par l’Assemblée, en prévision peut-être de rechercher une solution pacifique en Algérie. Les députés communistes français avaient voté favorablement ainsi que les députés communistes français d’Algérie, dont Alice Sportisse. Il m’avait été difficile alors à l’époque de juger du bien-fondé ou du mal-fondé des positions du PCF. Mais il était évident que les députés communistes d’Algérie avaient eu tort de toutes façons, de suivre l’exemple de leurs camarades français.
Après la manifestation d’Alger, Guy Mollet était reparti, ayant cédé ainsi aux sollicitations d’une population européenne en accord avec les ultras colonialistes partisans d’une « Algérie française ».
III
Notre situation finit cependant par se stabiliser grâce à un chrétien progressiste, Pierre Mathieu, chez lequel Bachir avait souvent trouvé refuge, et qui m’accueillit chaleureusement à mon tour.
En tant que chrétien partisan d’une Algérie indépendante, Pierre Mathieu était en relation avec l’abbé Moreau et les prêtres de la Mission de France qui géraient l’église d’Hussein-Dey et qui avaient les mêmes positions.
Ce sont eux qui, dans le courant de1956 avaient accueilli Bachir, sur l’intervention du cardinal Duval.
Là, Bachir s’était lié d’amitié avec l’abbé Moreau qui lui avait demandé de s’occuper de la bibliothèque du presbytère, ce qu’il avait fait avec bonheur, en y incorporant, avec l’accord de l’abbé, quelques ouvrages marxistes.
Mais cet arrangement n’avait pu se prolonger longtemps. En effet, l’abbé Moreau ayant refusé d’augmenter le salaire d’un des bedeaux européens qui s’occupaient de l’église, ce dernier, furieux, avait menacé l’abbé de dénoncer « l’Arabe » qui logeait dans une chambre sur la terrasse.
Aussitôt, la décision avait été prise : après avoir remis ses archives aus Sœurs blanches, qui logeaient en face du presbytère, Bachir avait été transporté, sur une moto conduite par un prêtre, chez Pierre Mathieu, où avait déjà séjourné Henri Maillot, après son fait d’armes.
Le lendemain de cette fuite précipitée, au petit matin, la police avait fait irruption au presbytère et était montée directement à la terrasse, en vain bien évidemment.
Bachir évoquait souvent devant moi cet épisode de sa vie clandestine, regrettant amèrement de ne pas avoir pu, à l’indépendance, rencontrer l’abbé Moreau (qui avait été contraint de repartir en France dans des conditions que j’ai oubliées) et qu’il admirait énormément. Et toute sa reconnaissance allait au cardinal Duval qui avait sauvegardé sa sécurité.
Pierre Mathieu habitait dans un petit pavillon, assez vieux, dans le quartier de la vigie, après les Deux Moulins, en contrebas de l’avenue qui menait à la Pointe Pescade (Raïs Hamidou aujourd’hui), en bordure de mer. Ce pavillon a aujourd’hui disparu, ainsi que ceux au-dessous, qui descendaient jusqu’à la plage.
C’est là que Pierre nous a hébergés jusqu’en 1960.
Bachir y était, bien entendu, inexistant aux yeux des voisins Quand on sonnait à la pote, il allait s’enfermer dans une armoire vide, rendue « habitable » en raison des trous que nous y avions creusés.
Quant à moi, j’étais évidemment présente en tant qu’ « amie » de Pierre. Il m’avait présentée à ses voisins les plus proches, qui étaient les propriétaires de son logement et avec lesquels il entretenait des rapports cordiaux mais distants.
Un soir, ils nous avaient invités à dîner pour nous faire admirer leur télévision, parmi les premières parvenues sur le marché algérien. Je me souviens encore de la difficulté que j’avais eue à manger au cours de ce repas insolite.
Bien évidemment nous devions faire preuve d’une vigilance sans faille. Bachir ne sortait d la maison que pour se rendre à Alger pour des rendez-vous peu fréquents. Quant à moi, je me rendais chez les commerçants pour les achats nécessaires. Un jour, alors que je me trouvais à la boucherie, une troupe de parachutistes passa sur le trottoir d’en face. Jetant aussitôt un œil sur le boucher, un Algérien, je constatai qu’il dardait sur eux un regard chargé de haine. Il était impossible de lui faire savoir combien mes sentiments étaient semblables aux siens et j’en étais bouleversée. La boucherie fut fermée quelque temps après. Qu’était-il advenu de son propriétaire ?
Je me rendais chez une coiffeuse du quartier pour me faire teindre les cheveux. Un jour, alors qu’elle venait de me placer sous un casque, je vis entrer une de mes anciennes camarades de l’Union des femmes. Aussitôt je me levai et déclarai à la coiffeuse, médusée, que, trop fatiguée, je ne pouvais rester et je partis sans avoir regardé cette ancienne camarade dont j’ignorais les positions politiques alors. Nous décidâmes que, durant un mois, je ne mettrais plus les pieds à l’extérieur.
Après une autre de mes « mésaventures », la même décision fut prise. C’était le ramadhan et, revenant d’Alger en fin d’après-midi, je pris un taxi (ce que je ne faisais jamais) pour rentrer avant le ftour. Le chauffeur de taxi était Algérien et à un moment donné, il s’arrêta et me demanda de descendre car, pensait-il, il était suivi par une voiture de la police des mœurs. Ayant constaté que la voiture de police avait poursuivi sa route, je repartis donc à pied, assez loin de notre planque. Et je pris ensuite le petit chemin de terre qui y conduisait directement. Arrivée à proximité de la maison, je pris l’escalier qui menait à l’avenue au-dessus et constatai que la voiture de police était stationnée juste en face. Là encore, aucune suite fâcheuse ne se produisit.
Certes, ces « incidents » nous angoissaient, essentiellement moi d’ailleurs et j’en perdais le sommeil. Mais qu’étaient-ils par rapport à ceux qu’affrontaient jour après jour les combattants de l’ALN dans les maquis, ou les fedayin dans les villes ? Et qu’en était-il de ces héroïnes qui, à la barbe des parachutistes de Massu, transportaient des bombes et allaient les déposer dans les bars et cafés d’Alger ? Toute ma pensée et mon admiration allaient et vont toujours à elles.
IV
Les jours passaient et la guerre se faisait de plus en plus meurtrière. Sous le commandement du général Massu, au début de 1957, les paras à bérets rouges ou verts (ces dernier les plus cruels me disais-je) se livraient à une répression forcenée multipliant les arrestations et les morts, au cours de cette « Bataille d’Alger » dont les actions « triomphantes », largement répandues par les journaux, nous atteignaient de plein fouet.
J’étais, pour ma part entièrement convaincue que notre vie clandestine – si bien protégée fût-elle par notre vigilance – ne pourrait se poursuivre bien longtemps encore. Et comme mes camarades, je m’y étais préparée sans cesse.
Bachir était intransigeant sur les mesures à prendre pour sauvegarder notre sécurité. Il les avait mises au point en particulier pour nos rencontres. Ainsi quand Sadek venait à La Vigie pour une réunion de travail, j’étais chargée d’étendre à l’extérieur une serviette de toilette rouge qu’il pouvait voir de loin. Quand elle n’y était pas, il devait repartir aussitôt.
Parfois, Bachir laissait tomber cette intransigeance et devenait imprudent. Par un beau dimanche d’été, il suggéra ainsi que nous allions nous baigner sur la plage en contrebas. Pierre Mathieu se joignit à lui pour lever mes réticences et nous descendîmes. Il y avait un monde fou sur la plage et cette baignade fut pour moi un véritable cauchemar, alors que Pierre et Bachir s’en donnaient à cœur joie.
Certes, contrairement à mes prévisions, notre vie clandestine se poursuivra jusqu’à l’indépendance. Mais à différentes occasions, nous avons échappé de justesse à des arrestations.
Un matin, en me levant, j’allai à la fenêtre et constatai (horreur !) qu’une multitude de paras aux bérets verts emplissaient la cour au-dessous. J’allai aussitôt réveiller Bachir qui s’attela immédiatement à déchirer quelques textes dans les toilettes pendant que moi j’empilai quelques vêtements dans un cabas.
On frappa à la porte. Nous nous immobilisâmes dans l’attente d’un probable assaut. Mais rien ne se produisit.
Après un long moment je constatai à la fenêtre qu la cour du dessous était vide. Les bérets verts étaient partis. Pierre Mathieu nous expliquera par la suite que les paras avaient été chargés de recenser tous les résidents dans cet amas de bungalows où nous logions.
Après avoir attendu quelques instants, nous constatâmes qu’aucun bruit suspect ne nous parvenait de l’extérieur, nous sommes sortis et avons monté l’escalier pour atteindre le boulevard au-dessus. Comme il le faisait chaque fois qu’il se rendait en ville, Bachir avait coiffé le feutre noir qui lui donnait l’allure d’un Sud-Américain. En apparence décontractés, nous nous sommes engagés sur la descente, en croisant sur le trottoir une escouade de bérets verts, de retour sans doute d’un nouveau recensement de résidents.
A l’entrée de Raïs Hamidou, nous nous sommes engagés, sur la droite, dans un couloir qui longeait la baie et sur lequel s’ouvraient des studios. C’est là que vivaient, dans la clandestinité, mon oncle Camlille Larribère et Sadek Hadjerès. Nous avions décidé de nous réfugier chez eux en attendant des cartes d’identité que le Parti communiste de la RDA (l’Allemagne de l’Est) s’était chargé de nous confectionner.
Mon oncle, désireux d’apporter sa contribution à la guerre d’indépendance, avait, quelques mois plus tôt, abandonné son cabinet de médecin généraliste à Sig et plongé dans la clandestinité.
Militant communiste acharné, d’abord au sein du PCF, puis du PCA, il fut pour la direction clandestine du Parti une aide précieuse. Plus tard, nous le mîmes quelque peu à l’écart en raison de certaines de ses initiatives qu’il refusait de reconnaître comme dangereuses. Quand Alger devint la capitale de la « France Libre », il avait été sollicité par les autorités d’alors (sous la direction du général Giraud), pour accomplir une mission secrète en France occupée, dont j’ignore les objectifs. Pour se faire mon oncle avait reçu une carte d’identité, fausse bien entendu, mais dont les données étaient réelles.
C’est cette carte qui nous sauva. Un dimanche matin en effet, alors que nous nous préparions à nous mettre à table, je fus alertée par le bruit répété de coups frappés aux portes des studios voisins. Angoissée, mais prudente, je renonçai à sortir pour comprendre ce qui se passait et je rejoignis Bachir et Sadek dans la cuisine.
Peu après on frappa à la porte. Trois gendarmes entrèrent pour recenser les habitants du studio. Ils ne se déplacèrent pas dans la pièce qui s’ouvrait directement sur la cuisine, car Camille leur présenta immédiatement sa carte d’identité et, l’examinant, l’un des gendarmes se mit à rire en disant qu’il était issu du village mentionné sur la carte. Aussitôt, l’atmosphère se détendit. Camille fit asseoir les gendarmes et leur offrit l’apéritif tout en entretenant avec eux une conversation animée.
Et nous que faisions-nous dans la cuisine ? Nous étions immobilisés, respirant à peine. Sadek continuait à essuyer un verre, mais Bachir lui fit signe d’’arrêter. Et moi, j’avais fermé les yeux et je m’étais bouché les oreilles, en attendant ce qui devait suivre.
Mais encore une fois, rien ne se produisit. Camille raccompagna les gendarmes à la porte et se mit aussitôt à sauter de joie. Quant à nous, nous respirâmes enfin un bon coup et soulagés, nous nous assîmes à notre tour, devant un apéritif bien mérité.
Quelques temps après, ayant reçu nos nouvelles cartes d’identité, nous regagnâmes notre planque à la Vigie.
V
Hormis les moments difficiles, tel celui que je viens d’évoquer, et hors du stress qui ne nous quittait jamais, surtout moi, chacun de nous avait des tâches bien définies.
Bachir Hadj Ali, aidé par Sadek Hadjerès, assurait la direction du Parti. Au cours de leurs réunions, auxquelles j’assistais, ils prenaient les décisions nécessaires et ils décidaient de textes importants destinés au FLN surtout et la rédaction et le contrôle de divers autres textes : tracts que nous envoyions sous enveloppes timbrées aux innombrables adresses que nous avions recueillies, articles dans notre journal, « El Hourya » qui paraissait régulièrement, ainsi que « Réalités algériennes et marxisme » qui était édité à l’extérieur. Et ils prenaient contact avec certains de nos camarades qui avaient été libérés.
Quant à moi, après avoir tapé ces textes, j’étais chargée, comme agent de liaison du Parti, de coder la correspondance que nous entretenions avec notre Délégation extérieure, que dirigeait le secrétaire du Parti, Larbi Bouhali, et qui contactait les Partis communistes et les Démocraties populaires pour solliciter leur soutien plein et entier à la cause algérienne.
D’autre part, cette correspondance était destinée au Parti communiste français qui nous apportait une aide précieuse sur le plan financier, qui avait organisé l’évasion d’Henri Alleg et de Boualem Khalfa et qui aidait matériellement nos camarades une fois libérés en France ou mis en résidence surveillée. Le camarade français qui décodait nos lettres et nous répondait… émotion que nous nous sommes rencontrés en septembre 1962, à la Fête de l’Humanité.
J’étais chargée aussi de tenir chaque jour les comptes de notre budget dans le but d’en informer le Parti plus tard, quand nous serions redevenus libres.
Hors les courses que j’étais la seule à pouvoir effectuer dans le quartier, je me rendais souvent à Raïs Hamidou pour transmettre à Sadek des textes auxquels il devait contribuer ou les informations dont il avait besoin.
Pour ce faire, en descendant de la Vigie, je passais devant le Casino de la Corniche et les paras qui l’occupaient depuis qu’une bombe y avait explosé au cours d’une soirée. Sur l’heure, le Casino était devenu un centre de tortures et de mort et la mer rejetait souvent les cadavres des moudjahidine qui y avaient été précipités, certains encore vivants.
En dépit du stress qui me tenaillait alors, j’aimais beaucoup me rendre là en raison des souvenirs qui s’y rattachaient. Etudiante, j’y avais passé une journée merveilleuse avec mes camarades, dans une villa qui existe encore aujourd’hui et devant laquelle je passe avec émotion pour me rendre à Baïnem, chez mon amie Fatma Téguia.
Plus tard, j’y étais venue parfois avec Robert Manaranche, me baigner dans son petit port, aujourd’hui fortement dégradé.
Une fois les stencils tapés, il fallait qu’ils soient ronéotés. Dans un premier temps, je prenais le bus aux Deux Moulins, sous les yeux des « territoriaux » (ces Européens mobilisés à tour de rôle pour contrôler les habitants et les passants du quartier), les stencils dissimulés sous des légumes dans un panier, et j’allais les porter au centre d’Alger, chez un couple d’architectes français qui les tirait.
Leur aide nous a toujours été précieuse ; à tour de rôle, en effet, Bachir, Sadek, Elyette et moi, nous avons passé une quinzaine de jours, durant l’été 1960 ou 1961, dans leur maison sur la plage d’Aïn Taya. Je n’oublierai jamais ces quelques jours de paix, qui nous ont permis, en pleine guerre, quelque répit.
Par la suite, nous avons pu nous-mêmes tirer nos stencils sur une ronéo qu’ils nous avaient donnée.
À ce moment-là, notre cercle s’était élargi : des camarades qui étaient redevenus libres, ont accepté des tâches précises. Trois d’entre eux nous ont rejoints dans la clandestinité : Christian Buono, le beau-frère de Maurice Audin, Lucien Hanoun et Elyette Loup. Ils vivaient dans un studio rue Abbé de l’Epée, à l’arrière de l’Université d’Alger. Quand je leur apportai les stencils qu’ils devaient tirer, ils pouvaient contrôles si j’étais suivie, car ils me voyaient arriver sous leurs fenêtres par des escaliers à l’arrière de l’immeuble.
Un mot sur Elyette Loup :
Avec un sang froid hors du commun, elle avait à deux reprises échappé à son arrestation dans la clandestinité, alors qu’elle travaillait à la rédaction et à la diffusion du journal destiné aux soldats français du Contingent, « La Voix du soldat ». Une première fois, tombée dans une « souricière » établie par les paras chez une camarade qu’elle était chargée de contacter, elle avait à les convaincre qu’elle était « hors course ». Ensuite, rentrant un soir dans sa planque, elle avait senti devant sa porte une odeur de cigarette. Or aucun des camarades avec lesquels elle travaillait ne fumait. Elle avait déguerpi. Mais elle avait finalement été arrêtée par hasard par un des paras qu’elle avait bernés et qui passait dans un camion devant l’arrêt de bus où elle attendait. Elle avait été torturée sauvagement dans la sinistre villa Susini, sans jamais dire un seul mot et sans même révéler son identité. Elle m’a raconté récemment qu’au moment où l’un de ses tortionnaires l’avait transportée à l’infirmerie après les séances de tortures, elle lui avait dit : « Vous êtes un beau garçon, mais vous êtes méchant ». « Mais figure-toi » , a-t-elle ajouté en riant, « il a rougi ! ».
Condamnée à trois ans de prison, elle avait été transférée en France comme nombre de militantes et militants jugés. Puis elle avait été relâchée et assignée à résidence. Elle avait aussitôt demandé à revenir en Algérie pour y poursuivre, dans la clandestinité, son combat pour l’indépendance. Lucien Hanoun en avait fait autant. Et tous deux avaient retraversé la Méditerranée, avec l’aide des communistes français.
Après tant d’années, je demeure toujours émerveillée devant une telle détermination. Après avoir frôlé la mort et enduré tant de souffrances, aurais-je eu, moi aussi, le courage de me replonger dan l’enfer d’Alger ?
Quand j’avais regagné Alger en juillet 1945, j’avais fait connaissance de sa mère, Madame Loup, qui avait recueilli chez elle certains des députés communistes français qui avaient été déportés et internés dans le Sud algérien par le pouvoir de Vichy. Propriétaire de 50 hectares dans la région de Birtouta, dans le Mitidja, elle était haïe par les colons des environs car elle payait honnêtement les ouvriers agricoles qui travaillaient sur ses terres et leur avait construit de véritables habitations en dur qui contrastaient avec les infâmes gourbis environnants. Atteinte d’un cancer, elle était morte rapidement et elle avait été enterrée dans le cimetière musulman situé à proximité.
VI
À partir de 1958, la situation devint de plus en plus angoissante. Une grande partie de la population européenne, subjuguée par les ultras, manifestait de plus en plus violemment sa totale hostilité à un règlement pacifique du drame algérien.
Les « ratonnades », ces atrocités commises par des racistes forcenés, se multipliaient, semant la mort parmi les Algériens.
Le 13 mai, une foule immense se rassembla sur le Forum, devant les bâtiments du gouvernement général, qui furent envahis et pillés. Un Comité de salut public fut crée sous la direction du général Massu, avec l’appui du général Salan et de plusieurs partisans du général de Gaulle qui réclamaient son retour au pouvoir. Ce qui fut fait dans les semaines qui suivirent.
En 1960, nous avons donc quitté notre refuge chez Pierre Mathieu, à la Vigie, et nous nous sommes installés rue Lafayette, à l’angle du boulevard Mohamed V, dans un appartement mitoyen de celui du propriétaire, qui était le père du Procureur général d’Alger.
Au-dessus de nous, dans un appartement loué par des étudiants, nous entendions une ronéo qui tournait toute la nuit pour tirer vraisemblablement des tracts destinés à l’OAS. Depuis le début de l’année, la situation s’était de nouveau en effet dégradée. La déclaration du général de Gaulle qui, en septembre 1959, avait reconnu aux Algériens « le droit à l’autodétermination » et ses positions ultérieures pour une « Algérie algérienne » avaient ulcéré les partisans de « l’Algérie française » et une partie des officiers de l’armée. Sous la conduite du général Salan, certains d’entre eux s’étaient rebellés et avaient installé des barricades en plein centre d’Alger. Mais ils avaient finalement été réduits.
Installés rue Lafayette, nous correspondions avec Sadek Hadjerès, par des lettres postées en empruntant un vocabulaire économique.
Mais un jour, une de ses lettres ne nous est pas parvenue ; nous avons aussitôt quitté la rue Lafayette pour nous réfugier chez lui, au début de la rue de Lyon (rue Belouizdad aujourd’hui). Et le lendemain, le cœur battant, je suis retournée rue Lafayette pour déménager le reste de nos affaires et annuler notre location. Le propriétaire était aimable. Rien ne s’était donc produit.
Les deux dirigeants du parti risquant d’être arrêtés ensemble, nous avons alors, Bachir et moi, déménagé encore pour nous retrouver dans un immeuble du boulevard Bougara (qui abrite aujourd’hui la Caisse nationale de retraite). J’avais loué cet appartement, au 4ème étage, à sa propriétaire connue pour son appartenance à la bourgeoisie algérienne. C’est là que, bouleversés, nous avons entendu, soir après soir, les manifestations qui rassemblaient les habitants de Belcourt criant à pleins poumons : « Djazaïr djezaïria » « Algérie algérienne ».
La pluie n’arrêtait pas de tomber. Et comme la pluie, les manifestations ne cessaient pas de se former et de s’amplifier, dans tous les quartiers périphériques d’Alger et au cœur historique de la cité, jour après jour.
C’est u cours de ces journées fantastiques, c’est au cœur même de la ville insurgée que certains des « Chants pour le onze décembre » de Bachir Hadj Ali ont vu le jour.
Ainsi « Pluie » :
« Il pleuvait sur la rue noire
Il pleuvait suer les voiles blancs
Il pleuvait sur les casernes sombres
Il pleuvait sur la mer grise
………………………
Autant de fois que la pluie
A cessé et décessé »
Et sans cesse, comme u chant d’allégresse, s’élevaient les youyous poussés par les femmes, portant haut le message de liberté et de victoire prochaine. La nuit, au cœur de la cité éveillée, ils retentissaient encore, parfois affaiblis par la distance ou étouffés par la pluie, exaspérants et menaçants pour l’ennemi auquel ils venaient rappeler que le peuple algérien était en matche et que rien ni personne ne pourrait désormais lui ravir son avenir de liberté.
C’est ainsi que bascula l’histoire, en ces jours de décembre 1960.
Comment décrire la joie immense, l’enthousiasme qui nous ont saisis avec l’Algérie toute entière, au moment où le gouvernement français entamait enfin des pourparlers avec le FLN et que se profilaient la fin d’une guerre abominable et notre indépendance !
Après le 19 mars et l’amnistie qui s’’en était suivie, j’étais enfin libérée du stress qui me tenaillait depuis tant d’années.
Certes, en reconnaissant l’indépendance de l’Algérie, l’armée française avait mis fin aux combats et à la répression sanglante qu’elle avait déchaînés contre notre peuple. Mais l’OAS s’était développée considérablement et multipliait les assassinats, les « ratonnades », comme elle les appelait alors.
Mon fils Jean m’a raconté plus tard, que se rendant à l’école à Oran, il devait chaque jour, enjamber ou contourner des ruisseaux de sang. À Alger, on ne rencontrait plus guère d’Algériens dans le centre-ville. La plupart d’entre eux avaient abandonné leur travail et s’étaient réfugiés dans leurs quartiers.
Un jour, me trouvant à la fenêtre, j’ai été témoin d’une scène épouvantable : un Algérien avait garé sa voiture en bas de l’immeuble, dans une station d’essence abandonnée de ses serveurs et commençait à remplir son réservoir. Mais il fut abattu par deux militants de l’OAS qui l’avaient certainement suivi de près.
Les autorités françaises s’étant finalement résolues à combattre l’OAS, les CRS encerclaient les immeubles l’un après l’autre, rassemblaient les Européens qui y vivaient pour les contrôler.
Un soir, Sadek nous annonça que son immeuble était perquisitionné. Après avoir été contrôlé, il fut libéré quelques jours plus tard grâce à sa fausse carte d’identité, et nous rejoignit.
Il nous raconta combien les quelques nuits qu’il avait passées là avaient été pénibles. Les Européens ne cessant de se glorifier des crimes qu’ils avaient commis les jours précédents.
Les événements se précipitaient. Quelques jours avant le 5 juillet, du haut de notre 4e étage, c’est avec une vive émotion que nous avons vu les premiers maquisards de la Wilaya IV qui descendaient calmement le boulevard sur le trottoir d’en face et entraient dans Alger : maigres et épuisés dans leurs uniformes délavés et usés, témoins de leurs derniers combats.
En me penchant davantage sur le balcon, j’aperçus, spectacle réjouissant, le policier français qui réglait la circulation au carrefour en bas du boulevard, descendre de son podium et s’enfuir à toutes jambes.
Le 5 juillet, nous nous sommes réunis avec Pierre Mathieu, pour célébrer, au cours d’u bon repas, le premier jour de notre indépendance. Le lendemain, je ne pus rester dans l’appartement. Il fallait que je sorte, que je rejoigne cette foule immense qui hurlait son (notre) allégresse. Journées inoubliables que ces premières journées dans Alger libre !
Je me revois encore, effectuant notre dernier déménagement en compagnie d’u camarade européen, Ferrigno, qui avait été arrêté, torturé et venait d’être libéré quelques semaines plus tôt. Quand nous arrivâmes au Hamma avant de monter sur Hussein-Dey, notre deux-chevaux ne put plus avancer, noyée dans une foule immense qui se rendait vers le centre-ville en hurlant « djezaïr djezaïria ». Nous joignîmes nos voix à celles des autres en tapant sur la voiture. C’est là un instant que je n’oublierai jamais : dans toute cette foule, il ne s’est trouvé personne pour nous soupçonner de simuler cet enthousiasme. Il faut croire que notre joie débordante leur paraissait sincère. Les gens se pressaient contre la voiture, tapant avec nous sur la tôle et nous souriant.
Bien des années plus tard, me remémorant cet enthousiasme délirant, empli de folles espérances, j’ai saisi l’ampleur des désillusions ressenties, dont on peut espérer peut-être qu’un jour elles seront effacées.
RETOUR À ORAN
Le 14 juillet, je pris le train pour Oran, où je voulais rejoindre mon père, Jean-Marie Larribère.
Dans les semaines précédentes, écoutant Europe N°1, dans l’attente d’informations décisives, j’avais entendu mon père qui était interviewé, et j’avais appris ainsi ce qui lui était arrivé.
Après le 19 mars, l’OAS s’était particulièrement déchaînée à Oran. Mon père avait alors été ouvertement menacé. Un tract OAS, entre autres, avait stipulé qu’à la maternité de l’hôpital, il prélevait le sang des Européennes pour le donner aux Algériennes. Il en avait été particulièrement bouleversé, lui qui avait consacré une bonne partie de son temps à accoucher et à soigner souvent gratuitement les femmes européennes du quartier misérable de la « Calère ». Il avait pris alors l’habitude de faire ses consultations à son cabinet, muni d’une kalachnikov. Et il avait décidé de fermer la clinique et de rejoindre ma mère, qui se trouvait en France depuis un certain temps.
Mais au cours du mois d’avril, alors que la dernière de ses accouchées s’apprêtait à sortir, et qu’une autre de ses clientes venait d’entrer, l’OAS avait lancé une violente attaque contre la clinique. Auparavant on avait frappé à la porte d’entrée. D’une fenêtre du premier étage, l’infirmière avait pu constater qu’un commando de l’OAS voulait entrer certainement dans le but de tuer mon père. Puis les bombes éclatèrent incendiant la clinique.
Pendant que l’infirmière s’était enfermée dans un placard avec le nouveau-né, mon père était monté dans notre appartement au deuxième étage. Les policiers et les pompiers étaient arrivés rapidement pour évacuer la malade et son bébé, tout en réclamant bruyamment la présence de mon père.
Dans l’immeuble mitoyen, le général Jouhaud, l’un des dirigeants de l’OAS, avait été arrêté et depuis lors l’immeuble avait été occupé par l’armée. De la terrasse, les officiers avaient, impassibles, assistés à l’attaque de la clinique, se faisant ainsi les complices de l’OAS, alors que les soldats du contingent qui y étaient stationnés avaient réclamé en vain de porter secours à ses occupants.
Entre temps, mon père était redescendu, avait traversé le jardin de la clinique puis celui de l’immeuble mitoyen. En fin de matinée, un véhicule militaire était enfin venu le chercher pour le conduire à l’aéroport de la Sénia où il avait pris un avion pour Paris.
Là, sa mésaventure avait fait grand bruit et tout en multipliant les interviews et les articles de journaux, il avait ramassé nombre d’instruments chirurgicaux et de médicaments. Et très vite, il avait repris un avion pour Oran en passant par Rocher Noir où siégeait le Gouvernement provisoire de l’Algérie indépendante.
À Oran, il avait installé un hôpital dans la Médina jdida, ce quartier surpeuplé essentiellement d’Algériens, où il opérait et soignait les victimes de l’OAS, ainsi que la population du quartier.
Il m’attendait quand je descendis du train et il me conduisit directement à la clinique. Je montai dans les étages et c’est avec la plus vive émotion que je constatai combien elle avait été détériorée. Au deuxième étage, le plancher avait été creusé d’un large trou. Dans la bibliothèque, tous les livres avaient brûlé et je ramassai au sol, en guise de souvenir, quelques pages calcinées. Les meubles les plus beaux avaient disparu, ainsi que tableaux et bibelots.
Le cœur serré, je repartis pour Alger le soir même.
Jean-Marie Larribère avait espéré obtenir la direction et la gestion de l’hôpital d’Oran. Et je suis persuadée, connaissant ses méthodes rigoureuses, qu’il y aurait fait merveille. Mais cela lui fut refusé. Dépité, il repartit en France, où il obtint la direction d’un dispensaire à Saint-Denis.
Les autorités oranaises n’oublièrent pas cependant ce qu’avait fait mon père et elles donnèrent son nom à la rue qui longe la clinique et à la placette où elle se termine.
Quant à la clinique, elle fut entièrement reconstruite, lui ajoutant un étage. Aujourd’hui, elle abrite le service hospitalier des affections endocriniennes. Je l’ai visitée et j’y ai reçu de tout le personnel un accueil des plus chaleureux.
A l’époque, j’avais été contactée par Abdelkader Alloula qui m’avait informée que je recevrai une invitation pour l’inauguration de la nouvelle clinique. Mais je ne reçus jamais cette lettre et cette inauguration se fit sans moi.
Quand plus tard je me rendis à Oran, je pus constater que le fronton du bâtiment ne mentionnait aucun nom. Mais tout le monde l’appelait (et l’appelle toujours) la « Clinique Larribère ».
POSTFACE
Ceci ne peut pas être et ne veut pas être un essai historique, ni une autobiographie, ni des mémoires. C’est tout simplement un témoignage. Bien des événements essentiels se sont produits dans notre pays durant la période que cet ouvrage traverse de 1945 à 1962. Certes un certain nombre d’entre eux ont eu un impact important sur ma vie, telle que la Guerre de libération. Mais je les évoque tels que je les ai ressentis sans les détailler et sans les approfondir, avec ma vision de l’époque mais a posteriori.
J’ai commencé à écrire bien tardivement, ma mémoire s’est donc montrée parfois défaillante et n’a pas retenu certaines dates et précisions. J’ai eu donc recours à des ouvrages de référence, tels « La Guerre d’Algérie », ouvrage collectif réalisé sous la direction de Henri Alleg, l’autobiographie de ce dernier, « Mémoire Algérienne », « l’Algérie en guerre » de Mohamed Teguia, « L’Accord PCA-FLN, du 1er juillet 1956 », de Hafid Khattib, « Des chemins et des hommes » de Mohamed Rebah, « Femmes algériennes - de la Kahina au Code de la famille » de Baya Bouhoune-Jusquet et Jacques Jurquet, « Mouvement national et question féminine – Des origines à la veille de la Guerre de libération nationale » de Fatma Zohra Saï.
J’ai interrogé aussi quelques camarades pour resituer tel ou tel événement et surtout tel ou tel lieu, dont le nom passé ou présent m’échappait.
Il est évident qu’écrit dans de telles conditions, ce texte comporte quelques erreurs (que j’espère minimes) qui ne peuvent trahir le sens général de l’ouvrage.
MES REMERCIEMENTS les plus chaleureux vont d’abord à mes amies qui m’ont harcelée sans relâche pour que je commence à écrire ou pour que je reprenne une écriture abandonnée une année durant.
Mes remerciements les plus vifs vont aussi à celles et à ceux qui m’ont aidée sur les plans matériel, « conception générale », « écriture » et technique » (possibilité d’utiliser des ordinateurs) : Naget Khadda, Zoubida Haddab, Malika Zouba, Fatma Téguia, Pierre et Françoise Mnaranche, mon fils et ma belle-fille, Assia Benabdallah, ma nièce, Claudie Médiène, Malika Zouba et Saïd Nemsi, Naouel et Hakim Soltani.
Mes remerciements les plus chaleureux vont également à tous mes camarades dont l’affection et le soutien m’ont aidée à surmonter, au cours des derniers mois, ma déficience physique et à reprendre mon écriture. Je veux citer en particulier Arab Izarouken, Kheira Dekali, Saleha Lahrab, Nadia Bouslouha, Nourredine Fethani, Soulef Guessoum et tous ceux qui se sont joints à eux dans l’anonymat le plus complet.
ANNEXES
ANNEXE - 1-
« LE FOURGON CELLULAIRE »
Bienheureux soit ce printemps d’orage
Qui ferma ton poing sur le pavé Houriya
Tu jouais pensive à l’ombre de la prison
Quand la brute tira son arme
Et ne sut dans quelle poitrine
Poursuivre son appel obstiné
Libérez les patriotes
Qui sinon toi
Patrie au cercueil décloué
Qui souffle aux lèvres de Lucie en veste rouge
Le cri de Houriya emmurée
Debout au passage des héros !
Dans le fourgon obscur
Les assassins ont cru dissimuler nos chaînes
Ils ont cru t’enterrer toute vive Houriya
Mais ce deuil n’est pas le nôtre
Les vrais captifs de ce fourgon funèbre
Ce sont les oppresseurs
Par notre union mise en bière
Bienheureux soit ce printemps d’orage
Kateb Yacine
nnexe 2
L’HISTOIRE D’UN JOURNAL,
L’HISTOIRE D’UN PEUPLE
Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis l’époque où « Alger républicain » pouvait proclamer avec fierté qu’il était le seul quotidien luttant pour briser les liens de la colonisation et faire enfin de l’Algérie un pays libre.
Ceux qui ont vécu assez longtemps pour avoir connu ces années héroïques en parlent aujourd’hui encore comme d’un engagement quasi mythique auquel ils se font justement gloire d’y avoir participé.
Comment Lucette Hadj Ali et d’autres survivants de la « fameuse équipe d’ « Alger républicain » - comme la surnommait avec mépris les journalistes des feuilles colonialistes - pourraient-ils jamais oublier leurs camarades et collègues de diverses origines, tombés durant la guerre parce que fidèles jusqu’au bout à leur profonde certitude qu’un jour leur pays serait enfin libre, débarrassé du racisme, de la misère, de l’ignorance, de toutes les inégalités, de toutes les injustices qui tissaient la vie quotidienne des prétendus « trois départements français ».
En vérité l’histoire d’ « Alger républicain » dépassait déjà de beaucoup le cadre même du journal et de ceux qui, par leur occupation, étaient ou y avaient été directement liés. Correspondants, militants politiques et syndicats lecteurs depuis longtemps convaincus de ,l’importance de ce quotidien dans la lutte engagée pour en finir avec le colonialisme, se sentaient à tout instant solidaires de la vie d’ « Alger républicain », de ses succès comme des combats qu’il devait mener constamment, en dépit de la censure, pour informer ses lecteurs qui, sans lui, seraient resté réduits à ne connaître que les vérités officielles, celles qui convenaient au Gouvernement général de la grosse colonisation. C’est bien pourquoi, les lecteurs réagissaient avec une telle énergie lorsque le journal était attaqué par l’administration coloniale, notamment par des saisies multipliées, par des poursuites devant les tribunaux, sous le prétexte de la publication d’articles « portant atteinte à la souveraineté française » et par la multiplication des condamnations à de lourdes amendes. On voyait souvent alors une longue queue se former devant le guichet du journal. Il s’agissait de lecteurs venant apporter leur contribution à la souscription permanente.
Dans la foule se pressaient les travailleurs de diverses corporations en bleu et casquette « délégués » par leurs compagnons de travail pour verser au journal la somme collectée dans leur entreprise, des fellahs en burnous et chéchias, arrivés de leur douar, et aussi parfois des femmes, voilées ou non, venues apporter quelques pièces d’or, un vieux collier ou un bracelet arrachés au trésor familial, pour qu’elles aussi puissent contribuer à sauver leur « Alger républicain », menacé de saisie. Aux étrangers qui s’étonnaient de leur présence et de leur participation à cette souscription, il s’en trouvait toujours une parmi elles pour expliquer que, si elles n’avaient pas eu la possibilité d’apprendre à lire, un de leurs garçons avaient eu cette chance. Sa tâche était de faire chaque jour, pour toute la famille, la lecture et la traduction des principaux articles d’ « Alger républicain ». Du même coup, chacun avait appris ce que représentait ce journal dans le combat quotidien contre le colonialisme.
Des dizaines d’années plus tard, alors que l’Algérie était enfin libre et que ceux qui avaient encore vécu les moments exaltants des derniers combats pour l’indépendance avaient pour la plupart depuis longtemps disparu, je me trouvais en Algérie et je pus à cette occasion redécouvrir combien le souvenir d’ « Alger républicain » de l’époque coloniale était resté étonnamment vivant dans la mémoire populaire.
Aux dernières semaines de l’existence du journal, durant l’automne et l’été 1655, notre rédaction avait pris l’habitude de publier sous forme de « placard » et pour remplacer les articles interdits par les censeurs, cet avertissement en caractères gras : « Alger républicain » dit la vérité. Il ne dit que la vérité mais il ne peut pas dire toute la vérité ».
L’initiative, pourtant très banale, avait rencontré un succès extraordinaire inattendu, chaque publication du « placard » étant accueillie comme une petite victoire sur la censure coloniale qui, évidemment, s’en prenait en premier lieu à « Alger républicain » et « respectait » sans y toucher, les publications de la presse coloniale.
Près de cinquante ans plus tard, je me trouvais sur la place de Cherchell, accompagné d’un ancien d’ « Alger républicain » survivant des maquis. Il me présentait à un de ses vieux amis rencontré sur la place de la ville. À peine celui-ci eut-il entendu les mots d’« Alger républicain », qu’il me salua aussitôt d’un « Alger républicain » dit la vérité. Il ne dit que la vérité mais il ne peut pas dire toute la vérité ».
Il est rare qu’un journal prenne une telle place dans l’histoire d’un peuple et de ses combats. Beaucoup plus rare encore qu’il garde si longtemps cette place dans sa mémoire et dans son cœur. Ce fut là l’extraordinaire privilège d’ « Alger républicain » et de tous ceux qui lui apportèrent leur contribution. Un engagement héroïque qu’ils payèrent très cher, en années de prison, en supplices, et parfois même en y laissant leur vie. Raconter l’histoire d’ « Alger républicain », c’est donc aussi contribuer à faire connaître l’histoire du peuple algérien dressé pour reconquérir sa liberté et sa dignité.
Merci à Lucette Hadj Ali d’avoir si chaleureusement voulu le faire comprendre.
Henri Alleg
"ITINÉRAIRE d’une militante algérienne" ( 1945 - 1962)
LUCETTE LARRIBÈRE HADJ ALI
Éditions du TELL - 2011
3 rue des Frères Torki - 09000 Blida - Algérie
http://www.editions-du-tell.com/
TABLE DES MATIÈRESPRÉFACEAbdelkader Guerroudj (page 7) PRÉAMBULE(page 13) LA FAMILLEENGAGEMENTSPOSTFACE(page 119)
|
ANNEXES
|
[2] À noter qu’il fut gratuit à partir de 1931, quand j’y entrais en 6e, en même temps qu’un certain nombre de filles issues des milieux populaires oranais – européens bien entendu.
[3] C’est un terme dont j’ai horreur et que je n’utilise que pour désigner les Européens racistes genre « Algérie française ».
[4] Décret qui, en 1870, donna aux Juifs d’Algérie, jusque là considérés comme « indigènes », la nationalité française.
[5] On sait qu’à cette époque certaines plages étaient également « interdites aux arabes ». Mais je n’ai jamais vu de telles pancartes sur les plages algéroises et oranaises où je me baignais, mais où les algériens étaient absents.
[6] Il y a quelques temps j’ai eu la chance de visiter l’appartement que nous habitions alors au premier étage. J’ai reconnu les carrelages inchangés, mais non la cour centrale, autrefois carrelée en verre et opuverte sur le ciel, mais aujourd’hui sombre sous un étage rajouté et bien dégradée.
[7] L’Union des Femmes d’Algérie et non pas l’Union des femmes algériennes. Son nom était donc tout à fait inapproprié, mais je n’en étais pas consciente alors.
[8] Dolorès Ibarruri, la Pasionaria, membre du Bureau du Parti communiste espagnol, députée aux Cortès, fut durant la Guerre d’Espagne une combattante redoutable, galvanisant les foules par ses discours passionnés. Ses mots d’ordre « No pasaran » - (« ils ne passeront pas ») sont restés célèbres. Après la chute de la République espagnole, elle se réfugia à Moscou jusqu’à la fin de la dictature franquiste et revint à Madrid où elle mourut en 1989.
[9] La IIIe Internationale, qui réunissait les partis communistes du monde, fut fondée par Lénine en 1919 et dissoute par Staline pendant la IIe Guerre mondiale, en 1943.
[10] Après mon divorce de Robert Manaranche, j’ai épousé Bachir Hadj Ali en 1963. Il est décédé il y a vingt ans, en 1991. Voir l’ouvrage « Lettres à Lucette , 1965-1966 » de B. Hadj Ali, Ed. R.S.M. Alger, 2002.
[11] C’est au cours de ce Comité central élargi qu’Amar Ouzegane, qui refusa de reconnaître le bien-fondé de cette autocritique et donc de sa propre responsabilité en la matière, fut destitué de son poste de Secrétaire général.
[12] À Oran, la municipalité nouvellement élue était dirigée par Nicolas Zannettaci, un communiste. À Alger, c’est le général Tubert, proche du PCA, qui avait été élu maire.
[13] Ce dernier refusa par la suite d’attester que Bachir Hadj Ali avait participé à la Guerre d’indépendance. Bachir est ainsi mort sans avoir pu obtenir cette reconnaissance.
.

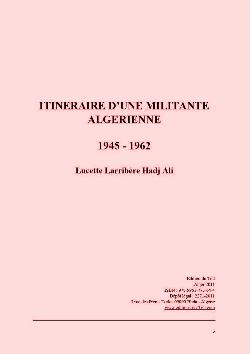

Les commentaires récents