A un moment où la guerre d’Algérie
refait surface dans l’actualité, reparaît en poche (à l'Aube) Entendez-vous
dans les montagnes… de Maïssa Bey. Un récit bref et tendu dans lequel la
romancière de Sidi-Bel-Abbès, par le détour de la fiction, parvenait enfin à
arracher au silence un événement majeur de son existence : la mort de son père,
torturé et assassiné par les militaires français en 1957.
 Dans le champ plus strict de la littérature,
on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent
Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne
porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a
laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des
nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,
l’Express,
le
Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une
critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture
sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de
Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales
guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible
guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes
avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus
admirables romans : Le
cul de Judas.
Dans le champ plus strict de la littérature,
on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent
Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne
porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a
laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des
nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,
l’Express,
le
Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une
critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture
sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de
Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales
guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible
guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes
avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus
admirables romans : Le
cul de Judas.
Ce texte occupe une place à part dans l’œuvre de l’écrivain algérienne. Maïssa Bey retisse le fil de sa propre histoire et évoque le destin de son père, torturé et exécuté à Boghari en février 1957 alors qu’elle avait quatre ans. Cet événement personnel (le supplice et l’assassinat du père) est relaté dans un cadre fictionnel (le voyage en train, la rencontre du possible bourreau). Le récit est lui-même précédé et accompagné de quelques « documents authentiques » (une photographie, un certificat de nationalité, un procès verbal d’installation, une carte postale, …), qui réinscrivent à nouveau l’histoire imaginée dans le sillage de l’histoire vécue…
Elle expliquait en 2002, dans une communication prononcée lors d’un colloque organisé à Jussieu sur « La guerre d’Algérie dans la mémoire et l’imaginaire » ce que lui avait coûté l’écriture de ce texte et le sens qu’elle accordait à cet effort.
***
La guerre d’Algérie est revenue
plusieurs fois sur la scène médiatique et littéraire ces derniers mois. Quelques
événements y ont contribué. On retiendra d’abord la résurgence de l’affaire
Maurice
Audin à l’occasion de la lettre adressée par sa fille Michèle, à
Nicolas Sarkozy le 1er janvier 2009. Dans cette lettre
la mathématicienne refuse officiellement la Légion d’Honneur que le président
annonçait un an plus tôt vouloir lui décerner pour ses travaux de recherche.
Elle justifie ce refus par le fait qu’aucune suite n’ait jamais été donnée à la
requête de sa mère, Josette Audin, qui réclamait de ce même
président, dans une
lettre ouverte, que la vérité soit enfin faite sur la disparition de son
mari. Maurice Audin, arrêté par les paras français en juin 1957
pour ses positions de soutien à la cause indépendantiste algérienne n’a jamais
été revu vivant. Une version officielle établit l’évasion alors que différents
témoignages attestent d’une fin plus funeste entre les mains des militaires
français. Occasion de relire l’ouvrage consacré à cette affaire par Pierre
Vidal-Naquet, membre actif du Comité Audin, qui n’eut de cesse de
traquer le déni de justice derrière l’écran de la raison d’Etat.
Autre événement récent : la cour européenne des
droits de l’homme dénonçait, le 15 janvier dernier, la décision par laquelle la
justice française avait condamné Paul Aussaresses et les
éditeurs de son ouvrage Services spéciaux Algérie
1955-1957, publié en 2002, pour « délit d’apologie de crimes de guerre
». Décision saluée par les uns et critiquée par les autres, qui fut certes
l’occasion de remettre en débat la question de la liberté d’expression, mais
aussi de revenir sur les méthodes de l’armée française durant la guerre
d’Algérie, sur le conflit du Droit et de la Raison d’Etat et sur la permanence
de la non reconnaissance par nos dirigeants (d’hier et d’aujourd’hui) du recours
institué à la torture durant cette période. Entre autres piqûres de rappel sur
ce dernier point, on pourra lire ici un
article récent d’ Henri Alleg.
Du côté des émulations médiatico-littéraires,
la commémoration du cinquantième anniversaire de la mort d’ Albert
Camus a également été l’occasion de revenir, à travers une série
d’hommages mais aussi de réserves et de critiques (voir notre
post sur un article d’ Omar Merzoug paru dans la Quinzaine
littéraire), sur l’un des épisodes les plus sensibles et les moins digestes de
l’histoire de notre pays.
 Dans le champ plus strict de la littérature,
on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent
Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne
porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a
laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des
nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,
l’Express,
le
Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une
critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture
sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de
Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales
guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible
guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes
avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus
admirables romans : Le
cul de Judas.
Dans le champ plus strict de la littérature,
on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent
Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne
porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a
laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des
nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,
l’Express,
le
Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une
critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture
sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de
Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales
guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible
guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes
avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus
admirables romans : Le
cul de Judas. C’est
au milieu de ces regards croisés sur l’Algérie et le souvenir douloureux ou
obturé de la guerre que reparaît donc, en édition de poche, un court récit de
Maïssa Bey : Entendez-vous dans les montagnes… Ce
texte, initialement publié en 2002, met en scène trois personnages liés
directement ou indirectement à la guerre d’Algérie : la narratrice, une
algérienne installée en France afin d’échapper à la montée du terrorisme
islamiste des années 90 ; un médecin à la retraite, ancien appelé d’Algérie et
qui garde une certaine nostalgie de ce pays ; une jeune fille issue d’une
famille de Pieds-Noirs rapatriés qui ne récolte que silence autour d’elle
lorsqu’elle demande aux siens des détails sur cette période. Le récit s’étend
sur la durée d’un voyage en train jusqu’à Marseille dans le cadre d’un
compartiment instituant un huis-clos où vont ressurgir les démons du passé. La
femme, d’humeur solitaire, parcourt un livre qui la transporte dans le maquis
algérien tout en observant de temps à autre le passager assis en face d’elle.
Celui-ci engage bientôt la conversation, sans se douter de l’imprudence qu’il
commet. Au fil des échanges, l’homme découvre qu’elle est originaire de la
région et du village où il a effectué son service militaire. Mais cette
coïncidence achoppe bientôt sur une pierre tranchante : le père de la narratrice
a été torturé et exécuté en 1957 dans le village même et à la même période où
l’homme du compartiment occupait ses fonctions militaires. Impossible d’ignorer
alors, en toute banalité et en toute horreur, le rôle qu’il y a nécessairement
joué.
Le récit de Maïssa Bey se tend lentement comme
un arc jusqu’à ce point de basculement et de non retour qui confronte le présent
au visage du passé. La vie pourtant continue, le train entre en gare et les
voyageurs se séparent. Les dix dernières lignes de ce récit, qui pour celles-là
seules mériterait d’être lu, inventent une chute d’une grande sobriété et d’une
force rare où l’aveu du voyageur prend la forme la plus digne et la plus
inattendue qui soit.
Pourtant, s’il n’est pas dicté par la rancœur
ni par un désir de vengeance, ce livre n’est pas non plus celui du pardon. Il
s’attache plutôt à détecter ce qu’il y a d’humain dans tout bourreau et donc
d’inhumain dans l’homme :
« Elle se dit que rien ne ressemble à ses
rêves d’enfant, que les bourreaux ont des visages d’homme, elle en est sûre
maintenant, ils ont des mains d’homme, parfois même des réactions d’homme et
rien ne permet de les distinguer des autres. Et cette idée la terrifie un peu
plus. »
Ce texte occupe une place à part dans l’œuvre de l’écrivain algérienne. Maïssa Bey retisse le fil de sa propre histoire et évoque le destin de son père, torturé et exécuté à Boghari en février 1957 alors qu’elle avait quatre ans. Cet événement personnel (le supplice et l’assassinat du père) est relaté dans un cadre fictionnel (le voyage en train, la rencontre du possible bourreau). Le récit est lui-même précédé et accompagné de quelques « documents authentiques » (une photographie, un certificat de nationalité, un procès verbal d’installation, une carte postale, …), qui réinscrivent à nouveau l’histoire imaginée dans le sillage de l’histoire vécue…
Entendez-vous dans les montagnes…
relève donc de l’autofiction, catégorie narrative qui a fait couler beaucoup
d’encre depuis l’invention du terme par Serge Doubrovsky… (pour
quelques synthèses sur la question voir ici
et ici). Au-delà
des débats et des agacements
que le recours à l'écriture autofictionnelle a pu également susciter ces
dernières années, le récit de Maïssa Bey porte la trace d’un
choix profond, indifférent à l’air du temps. Le choix d’une voie pour dire ce
qui n’aurait pu être dit autrement.
Elle expliquait en 2002, dans une communication prononcée lors d’un colloque organisé à Jussieu sur « La guerre d’Algérie dans la mémoire et l’imaginaire » ce que lui avait coûté l’écriture de ce texte et le sens qu’elle accordait à cet effort.
« Il m’a fallu deux ans pour écrire un
texte de 70 pages environ. Toute une vie de femme avant d’affronter mes
blessures d’enfant. Le temps de la résilience. Combien de temps faudra-t-il
encore pour que l’on puisse accepter de poser notre regard sur toutes les
cicatrices de toutes les blessures, infligées ou subies pour que jamais elles ne
puissent s’ouvrir à nouveau ? »*
Le ton de cette dernière question invite à un travail de mémoire qui dépasse le seul cadre de la mémoire individuelle. On peut y entendre un appel à ce courage politique qui fait encore terriblement défaut à ceux qui nous gouvernent.
.
http://la-marche-aux-pages.blogspot.com/2010/02/maissa-bey-question-de-memoire.html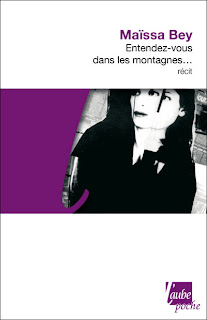

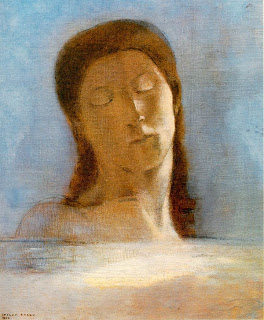
Les commentaires récents