Entretien inédit pour Ballast | Série « Les bidonvilles de Nanterre »
Nanterre, années 2020. Le bus 378 longe le pont de Rouen, file entre une bordée d’immeubles pris dans une toile d’autoroutes, de voies ferrées, de ponts et de passerelles. Ces aménagements modernes, tout en hauteur, ont écrasé l’ancienne ville. Bien qu’elle soit tombée lors des événements de Mai 68, la vieille enceinte militaire qui refermait le territoire sur lui-même semble de nouveau d’actualité. Ici, se trouvaient des années 1950 jusqu’aux années 1970 les bidonvilles de Nanterre. Ils ont vu grandir toute une génération parmi laquelle un certain Mohamed Kenzi. Son récit La Menthe sauvage, récemment réédité, revient sur la vie quotidienne des bidonvilles, l’arrivée du jazz et de la politique à Nanterre, les réseaux de soutien au FLN et les collectifs militants qui, peu à peu, font un pont avec les étudiants et les ouvriers qui animeront les mobilisations à la fin des années 1960. À l’occasion d’une rencontre à la librairie El Ghorba mon amour, Mohammed Kenzi est revenu dans sa ville pour raconter les chroniques de sa jeunesse. L’historien Victor Collet lui donne la réplique. Nous retranscrivons leur échange. Troisième volet de notre série sur la mémoire de Nanterre et de ses bidonvilles.
[deuxième volet : « Bidonvilles : l’enlisement [portfolio] »]
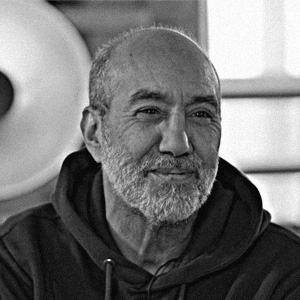
Quelle était la vie du bidonville de Nanterre durant l’époque coloniale puis pendant la lutte pour l’indépendance algérienne ?
À 7 ans, je pars d’Algérie avec ma mère et mes sœurs, retrouver mon père, parti dès 1957 de Maghnia, près de la frontière marocaine. Arrivés à Nanterre au bidonville, on a vite compris que la guerre n’était pas finie. La répression non plus. Je me souviens de la période avec le FLN. Nous étions tout petits mais j’y ai pris part. Pour moi, sans aucun doute, il fallait le faire. Comme j’étais assez débrouillard, on m’a vite demandé de participer. Les enfants étaient utilisés à l’époque pour transporter soit de l’argent, soit des armes. Je devais suivre un monsieur et s’il détalait, je devais détaler aussi ! Le 17 octobre 1961, je me suis retrouvé avec une petite famille, Madame et Monsieur Saadaoui. On a réussi à arriver jusqu’au pont de Neuilly et puis, d’un coup : le premier tir. C’était terrible, la panique totale. Le FLN tirait des cordes jusqu’aux arbres pour empêcher les gens de reculer. Après ça, avec la petite famille, on a dû marcher pour revenir jusqu’à Nanterre. On a trouvé une cache et on a dormi là. On n’est rentrés que bien après, quand ça s’est calmé. Tout était sans dessus dessous. Je ne savais pas où étaient mes parents. Je ne les ai vus que deux jours plus tard.
« Si tu ne voulais pas mourir, te retrouver jeté dans la Seine, tu l’évitais. La majorité d’entre nous ne savait pas nager : si tu tenais à la vie, tu n’y passais pas. »
8 ans, oui, je n’avais que 8 ans. Je m’en rappellerai toujours. Ça m’est resté ces trucs. C’est comme le pont de Bezons, à l’époque c’était l’horreur. Si tu ne voulais pas mourir, te retrouver jeté dans la Seine, tu l’évitais. La majorité d’entre nous ne savait pas nager : si tu tenais à la vie, tu n’y passais pas. On nous disait à chaque fois : « Y a untel qui a disparu, un autre qu’on ne retrouve pas. » Des fois, des corps remontaient plus bas, d’autres ne remontaient jamais. Nous, ce pont, on ne le traversait que la journée. La nuit, il valait mieux se cacher près de la berge, attendre là et le traverser à l’aube… Durant toute la période coloniale, avant l’indépendance de l’Algérie, nos parents nous disaient : « Il faut pas écouter les Français, il faut pas ceci, il faut pas cela, pas faire confiance, pas parler. » Même à l’école on s’affichait très peu, on restait mutiques. On ne disait rien, on répétait ce qu’on apprenait, point à la ligne. Et, à l’indépendance, c’était : « Il faut aller à l’école, il faut apprendre ! » On pensait : « Ils sont fous ces adultes ! » On ne comprenait pas leur monde. C’était très perturbant. Et raconter comment c’était à la maison, ça, c’est impossible.
Une des forces de La Menthe sauvage est que vous avez osé décrire des difficultés au sein des bidonvilles qui sont souvent éludées, par pudeur ou par honte…
Les gens masquent ces questions pour ne pas créer une mauvaise image de la communauté. Mais l’alcool, oui, était très présent. Mon père, quand il buvait, il nous tapait dessus sans raison. C’était dur. Pour moi, la boisson a débarqué avec leur désespoir. Ils pensaient réussir à pouvoir construire leurs baraques, réussir à avoir, je sais pas, un avenir pour leurs enfants. Et finalement, ils se retrouvaient dans ce bidonville, dans une pièce où ils vivaient à douze dedans. Chez nous, quand il pleuvait, ça s’infiltrait de tous les côtés, c’était terrible. Et quand quelqu’un rajoutait un bout de mur ou quelque chose sur sa baraque, il y avait cette brigade spéciale, la fameuse « brigade Z1 ». Ils arrivaient, ils cassaient tout et repartaient. Ils ont continué à venir après l’indépendance mais les jeunes comme moi, qui en avaient marre de tout ça, ils avaient grandi. Ils se sont fait caillasser plusieurs fois et ils sont plus revenus. Mais c’était vraiment une période difficile. Et, pour mon père, l’alcool, je crois que ça lui permettait de ne plus être là, de ne plus vivre cette vie-là, de disparaître. À l’époque, je ne comprenais pas toute cette réalité. Ce n’est que plus tard que je me suis dit qu’il devait y avoir des raisons que je ne voyais pas.

[Élie Kagan, « Bidonvilles de Nanterre », 21 octobre 1961 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]
L’atmosphère que vous décrivez est très sombre, très dure. Pour autant, vous ne tombez jamais dans une forme de fatalisme. On sent cette envie, malgré tout, d’ouvrir les horizons au pied de biche.
Cet esprit de révolte est ce qui m’a aussi permis de réussir à sortir du bidonville. J’avais cet élan, cette envie d’aller vers les autres. Quand j’étais encore à l’école Anatole-France, j’étais à peu près le seul à avoir un copain français. Sinon, le reste du temps, ça passait par des bagarres à la sortie. Durant cette période les rapports entre les Français et ceux qui habitaient au bidonville étaient rudes, ça ne se mélangeait pas. Dans la classe non plus d’ailleurs : les petites têtes blondes devant, les Portugais et les Espagnols au milieu et, au fond, les petits comme nous avec la boue sur les chaussures. Les familles françaises habitaient dans la zone pavillonnaire, de l’autre côté de l’avenue de la République. Parmi ces familles, on avait quand même quelques amis. Je me souviens des Letertre, qui avaient une petite maison qui longeait le bidonville… mais c’est tout. Pour le reste, on était exclus. Les Français ne voulaient pas se mélanger. Dès qu’ils nous voyaient, ils nous disaient : « Je parle pas avec un Arabe, il a un couteau dans la poche » ou encore « C’est des voleurs… » Des clichés comme ça, on en entendait à longueur de journée. Mais moi, quand même, j’avais ce copain. Sa famille m’avait ouvert la porte alors que son père était militaire !
Comme beaucoup, vous quittez rapidement l’école…
« Ça ne se mélangeait pas. Dans la classe non plus : les petites têtes blondes devant, les Portugais et les Espagnols au milieu et, au fond, les petits comme nous avec la boue sur les chaussures. »
Vers 1968–69, j’ai arrêté l’école. Mon père n’arrêtait pas de faire des allers-retours entre le travail et le chômage. J’ai trouvé un travail pour aider un peu ma famille à la papeterie de la Seine. Ça a duré six mois. Je regagnais l’estime de la communauté avec ce travail mais c’était assommant, je n’en ai vite plus voulu. C’était un peu tendu, il commençait à y avoir plus de problèmes de chômage. Mon père était dans le bâtiment mais il ne trouvait plus de poste. J’ai essayé de le faire engager à la papeterie mais il n’y est pas resté.
Quelles étaient les conditions de travail et les relations avec ce monde-là — notamment avec les communistes —, du point de vue des immigrés ?
Les rapports entre Français et immigrés n’existaient que dans le travail : ils n’acceptaient de se fréquenter que quand ils allaient bosser. Mais il y avait déjà des tensions. « L’immigré qui vient voler le travail du Français », tout ça. Les communistes, c’est dur à dire, mais ils nous voyaient d’un mauvais œil. Nos parents n’étaient pas aussi politisés, ils n’avaient aucune notion de la grève. Pour eux, il fallait travailler. Du coup, ils étaient très mal vus par les ouvriers français qui les considéraient comme des briseurs de grève… C’est ce qu’ils disaient d’ailleurs : « Les immigrés ne participent pas. » Comme si on n’était pas de leur classe ! Pour eux, on n’appartenait pas à leur monde. Nos parents, nous, on était des gens qui venaient faire leur boulot à leur place. Point à la ligne. Moi, là où j’ai travaillé, à Flins, c’était la CGT qui régnait en maître, c’étaient eux qui dirigeaient, qui donnaient les ordres. Il n’y avait pas de représentants de la communauté ouvrière maghrébine ou immigrée, ça n’existait pas. Nos parents non plus n’avaient pas de relations avec le parti communiste, ou que rarement. D’ailleurs, on n’avait aucune idée de ce qu’était le PC, le PS. On ne les voyait qu’à travers les affiches pour les élections, avec la tête de Barbet, tout ça. Je savais que le Parti communiste existait parce qu’il y avait Georges Marchais, bien sûr. Il nous faisait rire des fois quand on le voyait à la télé, avec sa manière de parler. Mais rien d’autre. Aucun de nous n’avait vraiment une vision claire, une idée de ce qu’était le PC. Finalement, le PC, à cette époque, c’était la mairie. Et la mairie, franchement, elle nous mettait des bâtons dans les roues dès qu’on essayait quelque chose, comme avoir accès à l’eau. Sur l’ensemble des bidonvilles à Nanterre, il n’y avait que la fontaine du bidonville de la Folie à cette époque. Du pont de Rouen où j’habitais, on marchait près de quarante minutes pour simplement ramener l’eau chez nous

[Élie Kagan, « Usine Renault de Flins, première fête de Lutte ouvrière : concert de Claude Nougaro », 31 mai 1971 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]
C’est à cette période que naissent les premiers mouvements étudiants de Nanterre. Est-ce que ces milieux ont pu interagir, se croiser ?
Il faut savoir qu’avant, l’université, c’était une zone interdite pour nous. On était petits, en pleine guerre d’Algérie, avec la police, l’OAS… Imaginez traverser cette enceinte du vieux camp d’aviation militaire sur des kilomètres, sans aucune issue. La nuit, on avait très peur. Nos parents nous interdisaient d’y aller. Nos parents, la mairie, les anciens, mais aussi les grands frères, qui ont pris la suite des anciens. Tous essayaient de nous cadrer. À ce moment-là, pour moi, clairement, le bidonville, c’était la prison. Une cellule à ciel ouvert où on se retrouvait tous ensemble enfermés. J’avais le sentiment que je n’avais aucune échappatoire, ma vie était un enclos. À part les quelques bandes de loubards, les Blousons noirs qui étaient un peu les anarchistes de cette période, il n’y avait aucune raison de se croiser avec les Français. Par conséquent, le reste du temps, on vivait en communauté, refermée, en cercle, de manière tribale. C’était tout tracé, je devais suivre le chemin : épouser une femme arabe, faire des enfants et travailler. À l’époque, dans le bidonville, il n’y avait qu’un seul homme qui vivait avec une Bretonne, Aïcha. Elle avait changé de prénom en arrivant là. C’était la seule, on n’imaginait pas pouvoir vivre avec une Française, qu’on pouvait sortir ensemble. C’était un peu comme avec les Noirs aux États-Unis, la ségrégation : une Blanche ne marchera jamais avec un Noir. C’étaient des mondes qui se faisaient face, avec le quartier pavillonnaire des Français d’un côté, les bidonvilles de l’autre. Le bidonville de la Folie, celui des Pâquerettes — à l’époque on l’appelait Tartarins — et jusqu’au bidonville de la rue des Prés, près des papeteries, et celui du pont de Rouen, sur les bords de Seine : tout ça faisait vraiment un cercle autour de l’université. Il y avait comme une frontière physique entre ces deux mondes — trois mondes devrais-je dire, avec l’université.
« C’était un peu comme avec les Noirs aux États-Unis, la ségrégation : une Blanche ne marchera jamais avec un Noir. »
Mais un jour, Mustapha, un des habitants du bidonville, est revenu de Paris tout remué : « Il y a les Français qui se battent entre eux. Il faut plus sortir du bidonville ! C’est la terreur dehors ! » Quand tu connais la tragédie algérienne, pour eux, ce moment, c’était un peu comme revivre la guerre. Mais avant, c’étaient des Algériens contre des Français ; là, c’étaient des Français entre eux… Nos parents ne comprenaient plus rien : « On ne sait pas ce qui se passe, il vaut mieux rester à l’abri. » Et c’est à ce moment-là que, d’un coup, les murs qui séparaient le bidonville de l’université sont tombés. C’était un peu comme avec le mur de Berlin : il y a eu une ouverture. On est arrivés avec quelques jeunes et on a fait un tas de rencontres. On s’est rendu compte que les étudiants n’avaient pas du tout les mêmes préjugés envers nous que les autres Français de Nanterre. Là, à la fac, d’un coup, c’était très différent. Ils t’accueillaient, ils te parlaient. Ce qui était impossible auparavant est devenu possible. Mai 68, ça a été marquant pour moi, c’était un peu comme un mirage, c’était la liberté. Ça m’a vraiment permis de m’ouvrir… L’université, c’était comme s’échapper.
Qu’est ce qui vous a le plus marqué ?
Les concerts de jazz, les Black Panthers, Jim Morrison… Toute cette culture n’existait pas dans le bidonville. Nous, on avait Rapat, les danses allaoui… C’était la culture arabe, les musiques arabes. Et nos parents n’étaient pas instruits, mon père ne savait pas lire. Du coup notre culture était souvent réduite à ce que les parents savaient déjà, ou à ce que les anciens leur disaient. Il y avait ceux qu’on appelait les marabouts. Ils connaissaient bien le Coran, ils détenaient la parole et avaient une capacité de jouer avec les mots, le langage. Leur parole était sacrée, on ne pouvait pas la remettre en cause. On n’avait pas les capacités, on ne maîtrisait pas la langue arabe, donc pour nos parents, c’était « Il a dit », « Il a dit »… Et quand ils disaient « Il a dit », il fallait justement ne plus rien dire et se taire ! En face, d’un coup, l’université ouvre, avec la musique, le jazz, tout ça… Les étudiants, eux, avaient accès aux livres. Ils venaient, ils nous mettaient parfois devant nos contradictions : « Ça se passe comme ça, faut pas croire… » Tout une autre culture est venue s’ajouter à la nôtre. Avant, j’avais une vision de la culture française qui était celle de l’école, celle de « Nos ancêtres les Gaulois », que j’avais toujours refusée. Il y avait vraiment une fracture entre les deux cultures. Et quand j’ai découvert ces étudiants, ce n’était plus du tout cette vision. Ça s’ouvrait, ça se rencontrait.

[Élie Kagan, « Manifestation à l'université de Nanterre et manifestation de l'UNEF et du SNESup dans la cour de la Sorbonne », 2 et 3 mai 1968 | Collection de la bibliothèque La contemporaine
]
Comment ?
Ces rencontres, elles se sont nouées quand il se passait quelque chose, autour du bordel. Avant 68 déjà, il y avait des échauffourées, des bagarres à l’université. Et moi je faisais partie de ceux qui osaient déjà un peu entrer à l’université. Je participais aux bagarres. C’est comme ça que ça s’est construit, sans avoir ni projet ni rien du tout. Jacques Barda, l’ancien compagnon d’Annette Lévy, qui venait de l’École des Beaux-Arts, est arrivé un jour au bidonville un peu après 1968. On avait ce problème d’approvisionnement en eau et il voulait percer la canalisation pour la faire dériver jusqu’au bidonville ! C’est comme ça qu’on s’est croisés et c’est de là que c’est parti. Jacques, c’était plutôt une sorte de recruteur de Vive la révolution [VLR], il cherchait des personnes qui avaient du bagou. À l’époque, il y avait deux groupuscules qui étaient un peu rivaux. Il y avait VLR qui était plus du côté festif et la Gauche Prolétarienne [GP] qui était plutôt très carrée. Moi j’ai vite choisi VLR pour ce côté spontané, c’est ce que j’aimais. Je me disais : vivre vite et mourir jeune. Je ne voulais pas sortir du bidonville pour retrouver ce côté très militaire et fermé.
« Je me disais : vivre vite et mourir jeune. Je ne voulais pas sortir du bidonville pour retrouver ce côté très militaire et fermé. »
Il y avait aussi un groupe à l’intérieur de l’université avec des Martiniquais, dont Roland Junod — un étudiant du Jura suisse, mon copain —, qui avait appris à jouer des percussions et faisait de la philo. Les copains avaient introduit la musique antillaise ; Roland, lui, c’était plutôt jazzy ; en fréquentant VLR et le Front de libération de la jeunesse [FLJ], la pop est entrée dans le jeu. Ça se passait plutôt en extérieur, ici, sur place, à Nanterre. On appelait ça des trucs sauvages, la France sauvage. On se retrouvait avec des bouteilles, un bout de shit et on faisait la fête. Des fois, à l’université, des gars mettaient de la musique à la fenêtre d’une chambre, alors chacun ramenait quelque chose et c’était parti ! Ça nous faisait la soirée. On finissait le soir avec de grands feux vers la résidence à l’université et quand on avait un peu trop bu, on se retrouvait sur l’île. Ça sortait les instruments, les tambours, on recréait un peu nos univers imaginaires, la savane, le bled. C’est de là qu’est venue la musique… C’était les débuts de Bob Dylan, ça chantait du Brassens. Ça bougeait entre l’université et des bâtiments des bidonvilles. Aux Marguerites, il y avait des appartements où on se retrouvait avec les gens de VLR. On se retrouvait à cinq ou six quand on descendait pour les manifs. Il y avait Khetib, Alain… Ah, Alain ! À l’époque on l’appelait pas comme ça, on l’appelait Khekhet’ ! Je n’ai su qu’après qu’il était mort en prison… De cette époque, j’ai gardé beaucoup de liens : avec Richard Deshayes, du FLJ, avec Henri Leclerc, l’avocat, Yann Chouque, Roland Junot, des amis qui habitaient Nanterre. Certaines relations sont restées, d’autres se sont brisées tout de suite. Mais tout ça, ce moment d’ouverture, ça s’est vite refermé.
Vous décrivez assez durement des formes d’instrumentalisation et un certain paternalisme des « gauchistes », notamment au sein du premier Comité Palestine…
Oui. À Nanterre, tu avais peu de choix à cette période : la communauté, l’université, quelques bâtiments où ça bougeait un peu comme aux Marguerites et le Comité Palestine de Gilbert Mury, qui se trouvait un peu plus loin, au quartier du Chemin-de‑l’Île. Il recrutait les jeunes Maghrébins des alentours. Là, on était plusieurs de la même bande à s’y retrouver, un peu fiers de retrouver dans la cause palestinienne celle de la reconnaissance pour l’indépendance des anciens. Mais ça a été vite faussé, moins la cause que le soutien. Dès qu’on a tenté de parler des conditions de vie dans les cités de transit et dans les bidonvilles, ça coinçait. Et puis Gilbert Mury, c’était déjà un ancêtre, le vieux modèle du PCF dont il avait été exclu, mais sans pouvoir ni force. Il régnait sur sa troupe avec son garde du corps, Messaoud, un agent du FLN et de l’Amicale des Algériens. On est vite allés voir ailleurs. VLR m’a attiré par son aspect festif, les rencontres, je l’ai dit ; là, devant ce cadre aussi rigide qu’au bidonville, on s’est tirés.

[Élie Kagan, « Comités Palestine à la Mutualité, avec Gilbert Mury : An 5 de la révolution armée palestinienne
, 14 janvier 1970 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]
C’est à cette époque, durant les années 1970, qu’une politique de chantage à l’expulsion se met en place pour les immigrés…
Avec le nouveau président de l’université, René Rémond, les portes ont commencé à se refermer. Il décidait de qui entrait et de qui sortait. Dans le bidonville c’était pareil : on commençait à faire le tri entre les familles. Celles qui n’étaient pas « bonnes », qui étaient là au départ du mouvement. Elles ont rapidement été expulsées. Que des immigrés plutôt de la jeune génération commencent à se politiser, c’était mal vu, ça dérangeait. L’expulsion renvoyait la patate chaude de l’après 1968 aux Algériens et ils devaient se débrouiller avec. C’était la période où Marcellin et Pleven expulsaient facilement. Ce que je n’ai pas décrit dans mon livre, c’est l’Amicale des Algériens. Elle a eu un rôle dans cette fermeture. Tous ces jeunes Algériens qui venaient à l’université devenaient problématiques pour elle, pour ses rapports avec le consulat. L’idée qui se développait était très claire : « Attends ! Si tous ces jeunes, à un moment, débarquent chez nous, ça va être le bordel ! » Ils s’inquiétaient. Donc, à un moment, il y a une concordance, une coordination même, autour de l’idée selon laquelle « Il faut rétablir un peu d’ordre là-dedans »… Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, les policiers venaient, ciblaient des gens, nous foutaient des claques sans raison, mettaient en œuvre ce chantage à l’expulsion. La police et nous, on n’était pas copains du tout. À cette période, je suis vraiment parti en révolte contre le système, je voulais tout casser. Le gauchisme m’a un peu permis d’exprimer toute cette rage accumulée. Je faisais ce que je voulais. C’était : « On verra ce qu’ils feront. » Je commençais à moins traîner au bidonville.
Puis cette coercition est passée à une répression policière violente…
« Ce jour-là, on avait décidé avec des membres de la GP d’utiliser les premières rangées comme boucliers et de bazarder un paquet de cocktails Molotov. »
À ce moment-là, il y a eu Richard. On lui a tiré dessus. C’était un tir tendu de grenade lacrymogène lors d’une manifestation à Paris. Là tu as un copain qui est au sol, tu peux pas laisser passer ça. Je me rappelle qu’on avait eu une réunion à la Maison peinte [pavillon prêté par la Cimade, près des Pâquerettes, où se réunissaient des militants immigrés, ndlr] avec les militants de VLR : tous prônaient la révolution mais, d’un coup, ils ne voulaient plus aller manifester, ils ne voulaient plus continuer. Ils disaient : « On peut rien faire… » Richard, à qui on avait crevé un œil, c’était tant pis pour lui ! Ça m’a choqué. Richard, je l’aimais, c’était un ami, un frère. Quand j’étais dans la merde, c’est lui qui m’a aidé. J’ai trouvé injuste ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, il y a eu comme une fracture avec VLR. Je me suis dit que ça n’est pas avec ces gens-là que le changement se ferait. Je ne suis plus vraiment revenu à la Maison peinte après ça. Je me suis retiré, j’avais l’impression de ne plus faire partie de cette communauté à laquelle je tenais. Cette histoire m’avait vraiment abattu.
Il y a pourtant eu le Palais des sports où une grosse manifestation anti-policiers était prévue. On a eu une baston pas possible avec la police. Nous, on est arrivés avec ce groupe très informel que VLR utilisait en manif. Un groupe qui venait d’Argenteuil, des Marguerites et qui était très violent. Ce jour-là, on avait décidé avec des membres de la GP d’utiliser les premières rangées comme boucliers et de bazarder un paquet de cocktails Molotov. La police ne s’y attendait pas du tout. Il y a eu une répression très violente. Dès qu’ils ont compris qu’il y avait une volonté de faire mal, ils ont sorti leur brigade d’intervention avec les motos [le peloton des voltigeurs motoportés ou motorisés (PVM), ancêtres des Brigades de répression de l’action violente motorisée (BRAV‑M) créées en 2019, ndlr], une brigade qui a été créée juste après que Richard ait été blessé. Là, on a senti que le vent était en train de tourner.

[Élie Kagan, « Le 17 octobre 1961 : métro Solférino », 17 octobre 1961 / « Manifestations contre les violences du 17 octobre 1961 et contre la guerre d'Algérie : le PSU à la place Clichy et à la place Maubert », 1er avril 1961 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]
Ça commençait à être très, très violent. Le nouveau contingent policier qui arrivait avait clairement le champ libre. Je me souviens qu’on se faisait contrôler sans même savoir pourquoi, des dizaines de fois, toutes les trois minutes, qu’on nous tutoyait : « Qu’est-ce que tu fais là le bougnoule ? » Un degré de plus avait été franchi. Quand j’ai été arrêté, à la préfecture, on me mettait des coups de Bottin, ça ne laissait pas de traces… Tu sentais qu’on avait laissé libre cours à leurs pratiques, qu’ils savaient qu’ils ne seraient pas inquiétés et qu’ils pouvaient y aller. Et puis, ils devaient penser qu’on ne porterait pas plainte. La police n’avait plus du tout la même manière d’aborder les manifs qu’avant. Les groupuscules non plus. La GP était déjà dans l’idée de passer dans la clandestinité pour éviter cette répression plus sauvage. Moi je me suis fait avoir à l’université. Un gars m’avait filé un bout de shit. En sortant du restaurant universitaire, il y avait des flics tout autour de nous. Ils ont embarqué Nordine et Madjid. J’ai compris que c’était un coup monté.
Après cette ouverture, ça s’est refermé violemment.
« Tu te dis que dans ton propre pays, t’es devenu immigré par la force des choses. »
Quand je suis sorti de prison, j’avais rejoint Richard Deshayes. Parce que, quand VLR est arrivé en bout de course, lui avait créé le Front de libération des jeunes, avec son journal Tout. À cette époque, moi, je naviguais entre le FLJ et la cité d’urgence des Marguerites, je naviguais entre les lignes, d’un côté et de l’autre. J’ai gardé longtemps un lien avec mes parents qui habitaient à la cité des Prés, vers les Marguerites, vers Bezons. Et puis je suis parti. Je me sentais complètement déclassé — la prison fait le vide. Tu n’as plus que quelques amis, j’avais plus que Richard Deshayes, Françoise et Danièle que je connaissais de la fac. Je me suis rendu compte que ça avait été une période de liberté où l’on pouvait tout faire et que c’était retombé — la grande descente. Ça n’était même pas une désillusion, tu tombais de si haut ! Tu te retrouvais pratiquement tout seul, et tu devais te démerder avec ça. C’était très dur. Pour beaucoup. Et moi, je me suis retrouvé seul dans le circuit, je devais agir et ne plus compter sur personne.
Et c’est là que le « nous » est revenu, le « nous » de la communauté, celui qui te remet dans le circuit, celui de tous les jeunes immigrés qui sont restés à Nanterre et qui y sont encore. Ce « nous », c’était un peu le retour à la culture algérienne, maghrébine, de l’immigration… Cette période, c’est celle où je revenais souvent à la cité, mais ça n’a pas duré très longtemps. Avec les amis du bidonville, on n’avait pratiquement plus le même langage, la même vision de « nous », de nos vies. C’était très dur comme sentiment, je perdais beaucoup d’amis d’enfance. Et lors de ma deuxième arrestation, ma famille a été expulsée. Je l’ai appris depuis la prison. Mon petit frère, Hocine, a été le plus marqué. Il était en apprentissage ici, il a perdu tous ses amis. Il a dû réapprendre tout là-bas, à commencer par l’arabe. Dans mon livre je parle du « pays », je dis « en Algérie », je décris comment serait pour moi « ce retour ». Mais ce retour est une illusion, c’est un rêve : c’est le mythe du retour. En fait je n’y suis retourné que bien plus tard. J’avais fui en Suisse. De retour au bled, on nous appelait « les immigrés ». Tu te dis que dans ton propre pays, t’es devenu immigré par la force des choses. Le seul truc intéressant pour eux, ce sont les devises qui arrivent avec nous. On contribue, comme à l’époque de la guerre et de la Fédération de France du FLN.

[Élie Kagan, « Bidonvilles de Nanterre », 21 octobre 1961 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]
C’est vrai que toute cette période, ça a été très dur pour moi. C’est aussi pour ça que j’ai voulu la coucher par écrit ensuite. Ça a été salvateur, finalement, quand je regarde les choses maintenant. D’un coup j’ai pris conscience de cette époque entre le bidonville, l’université, la prison. Durant cette période, j’étais visé par un décret d’expulsion. J’ai passé une année en clandestinité. Ce sont les réseaux des amis de la fac qui m’ont planqués. Je suis d’abord allé à Paris avec Richard Deshayes, ensuite à Toulouse chez un professeur de l’Arsenal, et puis en Bretagne, à Lannilis, dans l’Aber Wrac’h, chez Yves Gourves, qui était un des douze membres qui avaient fait sauter la préfecture de Rennes, pour le Front de libération de la Bretagne. Et après, Henri Leclerc et Yann Chouque m’ont proposé l’Espagne pour m’exiler, et puis le Brésil. Mais qu’est-ce que j’allais faire au Brésil en pleine dictature militaire, et en Espagne avec Franco ? Au dernier moment, Leclerc il dit : « Ah ! Il y a une possibilité pour la Suisse. » Ça devait être en 1970–71, ou en 72. Et c’est comme ça que je me suis reconstruit à Genève. J’ai eu une autre vie. Je me suis refait des amis, qui m’ont aussi aidé dans cette route. C’est là que j’ai rencontré ma femme, avec qui j’ai écrit le livre.
Pouvez-vous justement nous parler de la genèse de ce livre, La Menthe sauvage ?
« J’ai ressenti le besoin d’apporter cette pierre à l’édifice. Ce qui a été écrit était vu exclusivement de l’extérieur. »
Finalement, si Jacques n’était pas venu au bidonville pour percer une canalisation, si leur révolte à eux en tant que jeunes n’était pas arrivée à nous, si le mur n’était pas tombé, si je n’avais pas participé à tous ces trucs, y compris les plus violents, il n’y aurait peut-être pas eu tout ça. La Menthe sauvage, au début, c’était surtout pour sortir tout ça, cette période difficile à Nanterre. Pour l’expurger. Ensuite ça a été aussi pour mes filles, qui ont grandi ici, pour qu’elles comprennent d’où je venais, ce que j’avais vécu. Décrire ma trajectoire. Parce qu’à force de me l’entendre dire, je ressentais que mon parcours était un peu particulier, alors j’ai voulu laisser une trace, témoigner, ne pas oublier. C’était aussi une manière de resituer l’histoire des bidonvilles, de les décrire enfin de l’intérieur. Même Mehdi Charef avec Le Thé au harem d’Archimède, il ne parlait pas des bidonvilles. Ou bien je voyais passer des trucs où on racontait n’importe quoi ! Je me disais : « C’est pas possible, il faut faire quelque chose. »
D’où cette phrase d’introduction de Magressi : « On en a marre de voir l’Histoire écrite par d’autres, on est mûr pour l’écrire nous-mêmes. »
Oui, c’est parti de là. À force de voir des choses qui n’étaient pas vraies, ou largement faussées, j’ai ressenti le besoin d’apporter cette pierre à l’édifice. Ce qui a été écrit était vu exclusivement de l’extérieur. Il y a bien celles et ceux qui avaient milité, comme Monique Hervo et son livre Bidonvilles : l’enlisement, publié chez Maspero. Mais c’était surtout des entretiens. Et puis, à cette période, il y avait plein de petites autobiographies de jeunes qui étaient publiées mais les éditeurs, ça les arrangeait bien, parce que ce style, ça leur permettait de réécrire beaucoup. Souvent, c’étaient des jeunes qui n’arrivaient pas à bien écrire. Le livre a failli être publié au Seuil. C’était un ancien mao, Olivier Rolin, qui me l’avait demandé au départ. Mais ils l’ont refusé finalement, on m’a dit que le livre était trop sombre, ils auraient aimé des aspects positifs, plus joyeux, pour l’avenir. Ils voulaient réécrire, justement, et moi je ne voulais pas lisser. Pourtant, à cette époque, j’avais quand même une certaine pudeur, je n’ai pas tout dit… Il y a certaines choses vécues, pour moi intolérables, que je n’ai pas décrites. Et puis finalement le livre a été refusé de nouveau : « On a dépassé notre quota de récits sur l’immigration », m’ont-ils dit !
Photographie de bannière : Élie Kagan, « Bidonvilles de Nanterre », 21 octobre 1961 | Collection de la bibliothèque La contemporaine
Photographie de vignette : émission Céline, ses livres
- Brigade créée en 1961, faisant partie du dispositif répressif pour éviter le développement de bidonvilles et les protestations lors des démantèlements [ndlr].↑
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Rachida Brahim : « Mettre en lumière les crimes racistes, c’est nettoyer nos maisons », février 2021
☰ Lire notre entretien avec Fatima Ouassak : « Banlieues et gilets jaunes partagent des questions de vie ou de mort », juillet 2019
☰ Lire notre entretien avec Mehdi Charef : « Du peuple immigré », avril 2019
☰ Lire notre entretien avec Saïd Bouamama : « Des Noirs, des Arabes et des musulmans sont partie prenante de la classe ouvrière », mai 2018
☰ Lire notre témoignage « Issa, balayeur », Anne Feffer, mai 2022
☰ Lire notre entretien avec Danièle Obono : « Il faut toujours être dans le mouvement de masse », juillet 2017
Les commentaires récents