Un silence éloquent enterre les sens, les symboles et les contenus du 60ème anniversaire, millésime signifiant s'il en est, du 19 mai 1956 et l'appel à la grève des étudiants. En face se multiplient les réussites néocoloniales dans la reconquête par la culture, dans la fabrication d'"idoles" et de créatures-relais, dans l'influence française multipliée au sein des élites,et dans l'encadrement révisionniste de l'écriture de notre propre histoire.
En hommage à nos étudiants martyrs, en résistance à cette reconquête coloniale, en dénonciation de la complicité massive et explicite des pouvoirs publics algériens dans la réalisation d'un divorce aggravé entre la jeunesse studieuse et les attentes de notre peuple, je vous propose la lecture de ma postface au livre « Taleb Abderrahmane guillotiné le 24 avril 1958″, figure symbole et synthèse de cet engagement des intellectuels algériens révolutionnaires avec leur peuple, pour l'indépendance et pour l'Algérie promise par la proclamation du 1er novembre 1954.

Par Mohamed Bouhamidi.
Le nom, la personnalité et le parcours de Taleb Abderrahmane portaient une charge si puissante que les étudiants algériens les prirent spontanément, en 1962, pour symbole de l’engagement et du sacrifice. Les étudiants post indépendance lui reconnaissaient ainsi qu’il a joué un rôle d’idéal social et politique pendant la guerre d’indépendance, un rôle de modèle de combattant. Les étudiants des premières années de l’Algérie indépendante trouveront en lui la figure historique la plus indiquée pour perpétuer l’image que le peuple algérien se faisait de ses enfants intellectuels, étudiants et collégiens pendant la nuit coloniale : des champions qui devaient mettre leur science « arrachée » aux colons au service de leur peuple et de ses luttes.
Pourtant Taleb Abderrahmane ne domine pas la scène morale et politique comme figure isolée. Il fait partie de tous ces champions, ces élites, que la société algérienne a produites dans ses luttes pour sa survie entre cadres politiques, syndicaux, culturels, artistiques, sportifs, religieux etc. Mohamed Rebah a parlé de ces différentes élites en d’autres occasions et a montré leur apport à la maturation des idées nationales puis à la guerre elle-même. Il a montré comment en différents ruisseaux leurs activités ont préparé physiquement, moralement et politiquement les futurs combattants à assumer les écrasantes nécessités du combat. Ces élites se sont forgées à différents degrés dans la lutte contre les différentes formes de l’exploitation coloniales. Il est frappant qu’à la naissance de Taleb Abderrahmane, en 1930, ces élites nouvelles qui se sont forgées dans la lutte contre les diverse formes de l'exploitation coloniale, se sont distinguées essentiellement de celles qui ont mené les grandes luttes du dix-neuvième siècle et qui se structuraient autour des tribus, des zawias et des tolbas. Nous pouvons en trouver une belle illustration dans « La tête dans un sac de cuir », le livre que Sid Ahmed Mebarek a dédié à son ancêtre Ben Allal Mebarek acteur essentiel puis chef de la résistance dans la Mitidja-Ouest et dans les régions autour de Miliana, Khalifa de l’Emir Abdelkader dans la même ville.
Taleb Abderrahmane naît dans un monde en mutation dans lequel la figure du militant politique, du syndicaliste, du réformateur religieux, de l’animateur associatif dans le sport et dans les arts vont apparaître, accompagner les anciennes élites et exercer une influence sociale parallèle puis dominante. Mieux, Taleb Abderrahmane naît au cœur même du territoire, la Casbah d’Alger, dans laquelle se déroulent ces mutations entre le décor immuable d’un héritage prestigieux et les nouvelles catégories sociales et leurs propositions hiérarchiques.
Les mots n’ont pas que des résonances. Travailleur occasionnel, ouvrier professionnel, ouvrier spécialisé, travailleur permanent, ces termes commencent à structurer un rapport des indigènes au monde de l’économie coloniale et à les situer face au dispositif colonial, en première ligne. Il n’est pas question bien sûr d’ouvrier indigène hautement qualifié, encore moins de technicien ou d’ingénieur même si existent déjà, en quelques exemplaires, des instituteurs, des médecins, des pharmaciens et des avocats d’autant plus remarquables par leur rareté.
Sur le plan social, dans ces années trente, les jeunes commencent à abandonner les habits traditionnels qui sont autant des signes de la positon sociale du passant et qui servaient à faire reconnaître le statut des personnes qui les portaient. Mais dans cette mutation gigantesque une tendance générale dominait : les politiques coloniales précipitaient les Algériens dans une misère noire. De séquestre en dépossession, ces politiques jetaient des dizaines de milliers d’Algériens dans l’exode et dans d’innommables bidonvilles autour des grandes villes. Cet exode affecta aussi la vieille Casbah et modifia sa composante humaine le plus souvent à partir des anciens courants d’échange de la vieille cité avec des régions qui lui fournissaient certains services et certains corps de métiers. Pour ces raisons la Casbah gardera intactes des traditions citadines et urbaines et continuera d’offrir un cadre social et moral préservé malgré les dégradations subies du fait colonial. Cet équilibre partout présent en Algérie entre la préservation d’un « ordre social » et donc moral vital à la résistance et à l’adaptation combative à l’ordre/désordre colonial atteint dans cette Casbah un point culminant.
Ce livre de Mohamed Rebah montre bien que les algériens n’ont pas fait que subir ces mutations. Ils créent leurs organisations sociales, culturelles et politiques. Ils font plus que s’adapter, ils luttent. Dans l’aveuglement de leur centenaire, dont parle si bien ce livre, les colons ne voient pas que les algériens ont récupéré de leurs insuccès et de leurs insurrections inabouties. Ils repartent au combat, ont repris confiance. Ils créent une atmosphère nouvelle à partir de l’idée d’indépendance que répand le mouvement national et qui agit comme une retrouvaille avec l’identité algérienne. En de nombreuses occasions Mohamed Rebah a qualifié ces organisations sociales et politiques d’écoles. Ecoles du nationalisme, écoles politiques, écoles sociales, écoles du courage etc. etc. Je retiendrais à jamais cet exemple de l’équipe de football du Mouloudia de Cherchell dont tous les membres prirent le maquis et qui m’a permis de comprendre en profondeur la notion d’école dans les luttes politiques.
Mais si ces écoles avaient pour but d’éveiller la conscience nationale et de préparer avec les moyens du bord les élites qui devaient mener et diriger les luttes pour l’émancipation nationale, ce n’était pas l’objectif de l’école française pour indigène. Bien au contraire elle avait pour but officiel d’intégrer les rares enfants indigènes admis à l’école aux fonctions nécessaires à la bonne marche des affaires coloniales. En 1929, un an avant la naissance de Taleb Abderrahmane, un chiffre insignifiant de 60.644 (dont 6712 filles) algériens ont accès à l’école dans 564 écoles dont 23 pour filles. (in Eliaou Gaston GUEDJ « L'ENSEIGNEMENT INDIGENE EN ALGERIEAU COURS DE LA COLONISATION -1832-1962). Auparavant, le peu d’Algériens en situation de le faire refusaient plutôt d’envoyer leurs enfants à l’école française. Ils se méfiaient de cet enseignement qui risquait de dépersonnaliser leurs enfants et leur crispation était une forme de résistance.
Pourquoi changent-ils d’avis et deviennent justement demandeurs dans ces années 1930 ? La réponse se trouve dans la description que fait Mohamed Rebah des dispositions d’esprit du peuple algérien qui veut désormais tout à la fois pousser les enfants à « s’en sortir » par la « langue du pain » mais aussi « dérober sa science à l’adversaire ».
La naissance des partis politiques algériens a joué un grand rôle dans cette confiance en soi nouvelle qui a permis d’aborder l’idée scolaire différemment. Nous en retrouvons une expression esthétique dans l’histoire d’un petit kabyle que son grand-père décide d’envoyer à l’école des français concomitamment avec l’apparition du PPA. Nous trouvons trace de ce renversement dans plusieurs autres textes dont une de très grande beauté bien que tardive dans « La baie aux jeunes filles » de Fatiha Nesrine.
C’est une situation très paradoxale qu’une société agressée, carencée sur tous les plans, repliée dans ses dernières défenses, préoccupée par sa sauvegarde et par les moyens de reconstituer ses élites pense à prendre chez l’adversaire ce qu’elle peut prendre pour le combattre. C’est bien sûr une situation unique que de chercher les instruments de son émancipation au cœur même de l’institution le plus ouvertement vouée à la domestication par la culture. Cette situation paradoxale ne concernait pas tous les enfants indigènes : les 60.644 enfants représentent à peine six pour cent des enfants en âge scolaire.
Leur écrasante majorité n’arrivera même pas au niveau du cours de fin d’études qui permettait avec beaucoup de difficultés, à quelques uns d’accéder à un enseignement professionnel. Ils seront encore plus rares ceux qui accéderont au collège d’enseignement général et encore plus rares ceux qui comme Taleb Abderrahmane « pousseront » plus loin leurs études.
C’est cette frange limitée d’adolescents qui vivra cette expérience unique de la dualité. Car le discours nationaliste n’occupe pas seul le terrain social. Le discours assimilationniste spontané des indigènes conseillait aux jeunes en succès scolaire de penser à leur avenir et de se sortir au plus vite de « cette misère des Arabes », et le faisait aussi bien que le discours assimilationniste élaboré qui ménageait à ces nouvelles élites indigènes la fonction de courtier entre deux mondes incompatibles. À distance nous pouvons mesurer grâce à ce travail de Mohamed Rebah le parcours de Taleb Abderrahmane tout à la fois singulier et exemplaire d’une époque. Car n’oublions pas l’engagement de ces centaines de collégiens et de lycéens qui ont rejoint les maquis et la guerre de libération.
Taleb Abderrahmane en est devenu le symbole, car il a élevé au plus haut point le sens de l’engagement patriotique, mais l’expérience de la dualité leur a été commune.
Quelques uns sont encore vivants. Pour les jeunes ou les moins vieux qui n’ont pas connu directement ou par contact générationnel ces années de transformations sociales, ce texte les dépeint avec une grande vigueur. Par contre, de ce récit, pour ceux qui ont connu cette période, émane une profonde émotion et une grande force d’évocation. Au-delà de la netteté et, disons-le, de la sécheresse des faits cette évocation travaille le vécu, le subjectif ; ce qui ne relève pas du travail de l’historien, mais du narrateur, du romancier, du cinéaste que malheureusement l’Algérie indépendante n’a pas su ou voulu mobiliser au service de la mémoire.
Dans ce registre, comment à partir de cette simple, et si narrative, image de Taleb Abderrahmane révisant ses cours à la lumière d’une bougie, ne pas se souvenir de la condition misérable que nous avait fait le colonialisme et surtout ne pas se souvenir de cette course contre la montre qu’a été notre rapport à l’école ?
Le souvenir ne sera pas exactement le même pour les enfants que nous fûmes selon que nous étions citadins ou ruraux mais la dualité était identique.
Nous devions courir dès l’aube vers l’école coranique avant d’aller à l’école française – école française pour indigènes dans notre écrasante majorité – et souvent d’y retourner le soir. Courir sur un sentier de campagne ou sur les pavés de la Casbah ou de toute autre ville d’Algérie n’y changeait pas vraiment grand-chose sur le fond. À six ans déjà nous étions dans un monde scolaire duel, dans un entre deux de la langue et de la culture, en attendant de découvrir que nous étions tout simplement entre deux mondes. Non pas un monde double, un monde unique avec deux faces, un monde à la Janus, mais vraiment deux mondes différents
Nous devenions avec l’entrée en sixième des sortes de contrebandiers ; et l’école coranique aux premières lueurs – et en décembre elles sont froides - nous ne le rappelait constamment de quels territoires nous tenions. Nos parents ne nous disaient pas les choses ainsi. Le plus souvent, ils ne disaient rien.
C’est un ensemble qui le disait. Nous étions des valseurs des frontières et c’est pour ne pas rester de l’autre côté, que, chaque matin, nous allions à l’école coranique ressourcer notre identité. Quelques uns parmi les plus vieux se souviennent-ils encore du blâme social, voire du soupçon de trahison, qu’encourait celui qui s’oubliait à parler en français en dehors de l’école ? Étrange – ou juste – retour des choses à l’endroit d’une école française qui nous interdisait l’usage de notre langue maternelle ou conscience aigue que la langue c’est aussi l’identité ?
Aller à l’école, sur un sentier de campagne ou en zigzaguant dans les ruelles d’une Casbah ou entre les derbs d’une médina, ne jette pas sur les épaules des enfants les mêmes charges sociales et symboliques.
Que dire de la diversité des perceptions sociales qui stimulent Taleb Abderrahmane et tous ces enfants et préadolescents dans la densité démographique de la Casbah.
Pas seulement le nombre, autour de soixante-dix mille vers 1930, quatre-vingt mille en 1954, mais la densité qui renforce tout à la fois le maillage et le lien social. Il n’est pas indifférent, dans la formation, qu’un enfant côtoie, dans des espaces contigus, les scouts musulmans, le club sportif, l’école coranique, l’association des Ulémas, les sigles des syndicats et des partis politiques.
En soi, les rapports sociaux, qui enserrent l’enfant, agissent plus fortement pour la préservation de son identité. Ils le poursuivent quasiment à l’intérieur de la classe. Tout devient un champ de confrontation au cours de l‘enseignement, dans une recherche obstinée des points de comparaison de la longueur des fleuves à la hauteur des montagnes,
il y a un intérieur de l’élève, une lutte qui s’est glissé du champ social au champ de l’individu. Cela fera la différence entre une école française conquérante face aux possibilités réduites d’un village isolé du monde rural et une école française pour indigènes dans une cité millénaire vaincue mais pas défaite, encore immune par sa langue, sa culture, ses arts, ses traditions etc.
En elle-même, cette vieille Casbah contrariait les missions de l’école coloniale. Les chefs ottomans l’avait livrée sans vraiment combattre contre la vague et trompeuse promesse d’emporter leurs trésors dans leur débandade. Les Français avaient détruit ses remparts, son accès à la mer, ses portes, toute sa partie Nord. Il restait quand même cette Alger-là, cette preuve par la splendeur architecturale de notre civilisation ancestrale, qui ruinait le mythe colonial d’une Algérie barbare.
Ce n’est pas rien de vivre à l’intérieur d’une splendeur comme mémoire. Et cette mémoire n’était pas seulement dans les pierres. Malgré un exode dévastateur des anciennes élites, un artisanat émérite, une musique savante, une cuisine et un mode vestimentaire raffinés, des mosquées et des zawiyas rebelles actives dans la survie de la langue affectaient aux pierres du sens historique.
A plusieurs occasions –conférences, émissions radio, animations, conversations ou débats avec tous les types de public - Mohamed Rebah a souligné l’interaction contradictoire entre les changements imposés par les politiques coloniales et ceux que les organisations anticoloniales vont apporter dans le mode de vie et dans les formes de luttes, notamment dans la formation de la conscience nationale.
Son livre « Des Chemins et des Hommes » reste une référence sur ces interactions. Aucune de ces interactions n’explique le caractère trempé de Taleb Abderrahmane, ni son courage, ni la froide détermination à combattre le colonialisme en mettant sa vie dans l’équation. Taleb Abderrahmane est un héros exceptionnel. Le livre le montre avec un grand talent. L’autre mérite de ce livre est de nous rendre intelligible l’engagement massif des autres étudiants et lycéens qui furent aussi des héros. Certains de grands héros.
Alors cinquante ans après, ce livre refermé, je me suis rappelé mes années au collège avec une poignée de camarades algériens au milieu des nos condisciples pieds-noirs, l’intérêt de tous les voisins pour nos études, leurs encouragements incessants, leur métalangage qui nous assignait la mission d’être meilleurs que les jeunes pieds noirs.
Je me rappelle que le collège avait modifié même le comportement de nos camarades de quartier, cireurs, porteurs, vendeurs à la sauvette, coursiers qui rêvaient d'en découdre avec l'école et battre les pieds- noirs sur le terrain de l'intelligence et du savoir dans leurs propres murs.
Nous étions en mission de réparer notre image à tous face au racisme odieux et omniprésent.
Eux, ils devaient être champions de foot, de boxe, de course à pied, de quelque chose et de n’importe quoi mais champions. Rater sa mission d’être champion, c'est-à-dire premier de la classe ou au moins dans une matière, n’était pas sans risque. Nous aurions perdu toute considération.
Mais, pour moi, ces souvenirs restaient des souvenirs jusqu’à la lecture de ce livre. En le refermant, j’ai compris qu’on nous préparait à être des champions d'abord pour être utiles à nos frères de condition, car à quoi sert un intellectuel s’il ne sert pas ses frères ?
J’ai surtout compris ce que je devais à cette atmosphère de lutte que je ne connaissais pas, qu’à mon âge je ne pouvais connaitre à part celle de la grande lutte qu’avait allumée une nuit rebelle de Novembre qui avait pris pour moi les allures du murmure quand on chuchotait les noms de ceux qui étaient montés au maquis, de ceux qui avait plongé dans la clandestinité ou les larmes pour dire les morts ou les prisonniers.
C’était assez pour me rendre presque impossible de parler de ce texte dont la densité reflète celle de la détermination de Taleb Abderrahmane.
L’école française a échoué à nous domestiquer par sa culture car une puissante dynamique sociale, animée par des partis ancrés dans le peuple, lui fermait le champ. C'est toute notre société tendue dans son effort de libération qui préparait ses champions pour cette lutte qu'elle savait, d'expérience, sans merci. Elle fut sans merci, et, grace à cette longue préparation, les sportifs du Mouloudia de Cherchell comme les étudiants et collégiens de 1956 surent supporter la charge inouïe du combat.
La leçon vaut pour aujourd’hui, alors que, de toutes parts et sur tous les supports, déferle, sans digues officielles pour la contenir, une narration de notre guerre qui en fait une erreur et de notre indépendance une inutile vacuité.
Ce livre brise un peu l’encerclement des silences complices de ce révisionnisme triomphant et nous restitue une des plus belles parts de notre histoire que nous pouvons offrir comme mémoire à nos enfants.
« Taleb Abderrahmane guillotiné le 24 avril 1958″
De Mohamed Rebah. Editions APIC - Alger.
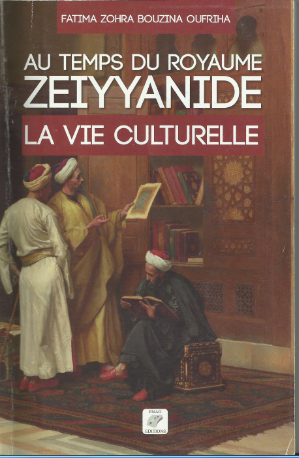
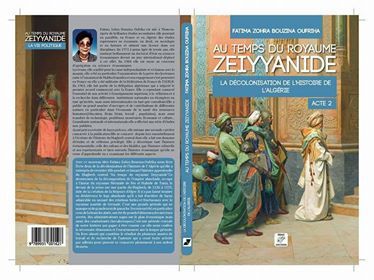
















Les commentaires récents