.
.
Rédigé le 01/05/2023 à 07:31 dans France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
J'essaie, depuis l'enfance, de dessiner ces pays
Qu'on appelle-allégoriquement-les pays des Arabes
Pays qui me pardonneraient si je brisais le verre de la lune...
Qui me remercieraient si j'écrivais un poème d'amour
Et qui me permettraient d'exercer l'amour
Aussi librement que les moineaux sur les arbres...
J'essaie de dessiner des pays...
Qui m'apprendraient à toujours vivre au diapason de l'amour
Ainsi, j'étendrai pour toi, l'été, la cape de mon amour
Et je presserai ta robe, l'hiver, quand il se mettra à pleuvoir...
J'essaie de dessiner des pays...
Avec un Parlement de jasmin...
Avec un peuple aussi délicat que le jasmin...
Où les colombes sommeillent au-dessus de ma tête
Et où les minarets dans mes yeux versent leurs larmes
J'essaie de dessiner des pays intimes avec ma poésie
Et qui ne se placent pas entre moi et mes rêveries
Et où les soldats ne se pavanent pas sur mon front
J'essaie de dessiner des pays...
Qui me récompensent quand j'écris une poésie
Et qui me pardonnent quand déborde le fleuve de ma folie...
J'essaie de dessiner une cité d'amour
Libérée de toutes inhibitions...
Et où la féminité n'est pas égorgée... ni nul corps opprimé
J'ai parcouru le Sud... J'ai parcouru le Nord...
Mais en vain...
Car le café de tous les cafés a le même arôme...
Et toutes les femmes une fois dénudées
Sentent le même parfum...
Et tous les hommes de la tribu ne mastiquent point ce qu'ils mangent
Et dévorent les femmes une à la seconde
J'essaie depuis le commencement...
De ne ressembler à personne...
Disant non pour toujours à tout discours en boîte de conserve
Et rejetant l'adoration de toute idole...
J'essaie de brûler tous les textes qui m'habillent
Certains poèmes sont pour moi une tombe
Et certaines langues linceul.
Je pris rendez-vous avec la dernière femme
Mais j'arrivai bien après l'heure
J'essaie de renier mon vocabulaire
De renier la malédiction du "Mubtada" et du "Khabar"
De me débarrasser de ma poussière et me laver le visage à l'eau de pluie...
J'essaie de démissionner de l'autorité du sable...
Adieu Koraich...
Adieu Kouleib...
Adieu Mudar...
J'essaie de dessiner ces pays
Qu'on appelle-allégoriquement- les pays des Arabes,
Où mon lit est solidement attaché,
Et où ma tête est bien ancrée,
Pour que je puisse différencier entre les pays et les vaisseaux...
Mais... ils m'ont pris ma boîte de dessin,
M'interdisent de peindre le visage de mon pays... ;
J'essaie depuis l'enfance
D'ouvrir un espace en jasmin.
J'ai ouvert la première auberge d'amour... dans l'histoire des Arabes...
Pour accueillir les amoureux...
Et j'ai mis fin à toutes les guerres d'antan entre les hommes et les femmes,
Entre les colombes... et ceux qui égorgent les colombes...
Entre le marbre... et ceux qui écorchent la blancheur du marbre...
Mais... ils ont fermé mon auberge...
Disant que l'amour est indigne de l'Histoire des Arabes
De la pureté des Arabes...
De l'héritage des Arabes...
Quelle aberration !
J'essaie de concevoir la configuration de la patrie ?
De reprendre ma place dans le ventre de ma mère,
Et de nager à contre-courant du temps,
Et de voler figues, amandes, et pêches,
Et de courir après les bateaux comme les oiseaux
J'essaie d'imaginer le jardin de l'Éden
Et les potentialités de séjour entre les rivières d'onyx
Et les rivières de lait...
Quand me réveillant... je découvris la futilité de mes rêves.
Il n'y avait pas de lune dans le ciel de Jéricho...
Ni de poisson dans les eaux de l'Euphrate...
Ni de café à Aden...
J'essaie par la poésie... de saisir l'impossible...
Et de planter des palmiers...
Mais dans mon pays, ils rasent les cheveux des palmiers...
J'essaie de faire entendre plus haut le hennissement des chevaux ;
Mais les gens de la cité méprisent le hennissement !!
J'essaie, Madame, de vous aimer...
En dehors de tous les rituels...
En dehors de tous textes.
En dehors de toutes lois et de tous systèmes.
J'essaie, Madame, de vous aimer...
Dans n'importe quel exil où je vais...
Afin de sentir, quand je vous étreins, que je serre entre mes bras le terreau de mon pays.
J'essaie -depuis mon enfance- de lire tout livre traitant des prophètes des Arabes,
Des sages des Arabes... des poètes des Arabes...
Mais je ne vois que des poèmes léchant les bottes du Khalife pour une poignée de riz... et cinquante dirhams...
Quelle horreur !
Et je ne vois que des tribus qui ne font pas la différence entre la chair des femmes...
Et les dates mûres...
Quelle horreur !
Je ne vois que des journaux qui ôtent leurs vêtements intimes...
Devant tout président venant de l'inconnu
Devant tout colonel marchant sur le cadavre du peuple
Devant tout usurier entassant entre ses mains des montagnes d'or
Quelle horreur !
Moi, depuis cinquante ans
J'observe la situation des Arabes.
Ils tonnent sans faire pleuvoir
Ils entrent dans les guerres sans s'en sortir
Ils mâchent et rabâchent la peau de l'éloquence
Sans en rien digérer
Moi, depuis cinquante ans
J'essaie de dessiner ces pays
Qu'on appelle-allégoriquement- les pays des Arabes,
Tantôt couleur de sang,
Tantôt couleur de colère.
Mon dessin achevé, je me demandai :
Et si un jour on annonce la mort des Arabes...
Dans quel cimetière seront-ils enterrés ?
Et qui les pleurera ?
Eux qui n'ont pas de filles...
Eux qui n'ont pas de garçons...
Et il n'y a pas là de chagrin
Et il n'y a là personne pour porter le deuil !
J'essaie depuis que j'ai commencé à écrire ma poésie
De mesurer la distance entre mes ancêtres les Arabes et moi-même.
J'ai vu des armées... et point d'armées...
J'ai vu des conquêtes et point de conquêtes...
J'ai suivi toutes les guerres sur la télé...
Avec des morts sur la télé...
Avec des blessés sur la télé...
Et avec des victoires émanant de Dieu... sur la télé...
Oh mon pays, ils ont fait de toi un feuilleton d'horreur
Dont nous suivons les épisodes chaque soir
Comment te verrions-nous s'ils nous coupent le courant?
Moi, après cinquante ans,
J'essaie d'enregistrer ce que j'ai vu...
J'ai vue des peuples croyant que les agents de renseignements
Sont ordonnés par Dieu... comme la migraine... comme le rhume...
Comme la lèpre... comme la gale...
J'ai vue l'arabisme mis à l'encan des antiquités.
NIZAR KABBANI POÈTE
Dans des pays où l’on assassine les penseurs, où les écrivains sont des mécréants et où l’on brûle les livres. Dans des pays où l’on rejette l’autre, où l’on scelle les bouches et où l’on enferme les idées. Dans des pays où poser une question est blasphématoire, il m’est nécessaire de vous demander de me permettre…
Me permettez-vous d’élever mes enfants comme je le veux et de ne pas me dicter vos envies et vos ordres ?
Me permettez-vous d’apprendre à mes enfants que la religion est d’abord pour Dieu et non pas pour les gens, les Imams et les Oulémas ?
Me permettez-vous de dire à ma petite fille que la religion est morale, éducation, courtoisie, politesse, honnêteté et sincérité, avant de lui apprendre par quel pied elle doit d’abord entrer dans les toilettes et avec quelle main manger ?
Me permettez-vous de dire à ma fille que Dieu est amour et qu’elle peut lui parler et lui demander ce qu’elle veut ?
Me permettez-vous de ne pas rappeler à mes enfants la souffrance de la tombe alors qu’ils ne savent pas encore ce qu’est la mort ?
Me permettez-vous d’apprendre à ma fille les bases de la religion et le respect qu’elle impose avant de lui imposer de porter le voile ?
De dire à mon jeune fils que faire du mal aux gens, les humilier et les mépriser pour leur origine, couleur ou religion est un grand pêché pour Dieu ?
Me permettez-vous de dire à ma fille que faire ses devoirs et se concentrer sur son éducation est beaucoup plus important pour Dieu que d’apprendre les versets du Coran par cœur sans même qu’elle n’en comprenne le sens ?
Me permettez-vous de dire à mon fils que suivre le Prophète commence par prendre exemple sur sa droiture et honnêteté avant sa barbe et la longueur de son habit ?
Me permettez-vous de dire à ma fille que les autres ne sont pas des mécréants et qu’elle n’a pas besoin de pleurer de peur qu’ils n’aillent en enfer ?
Me permettez-vous de crier que Dieu n’a, après le Prophète, demandé à personne de parler en son nom, ni autorisé quiconque à vendre des indulgences ?
Me permettez-vous de dire que Dieu a interdit de tuer une âme humaine et que celui qui tue un homme est comme s’il avait tué l’humanité entière ? Qu’un musulman n’a pas le droit d’en intimider un autre ?
Me permettez-vous de dire à mes enfants que Dieu est plus grand, plus miséricordieux et plus juste que tous les Oulémas (docteurs en religion) réunis de la terre ? Que ses principes n’ont rien à voir avec ceux des marchands de religion ?
Me permettez-vous
NIZAR KABBANI
.
Rédigé le 30/04/2023 à 18:54 dans Poésie/Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
Ceci est la relation fidèle de ce que j’ai vu et entendu.
Ce matin-là, j’apprends qu’une manifestation pacifique est prévue en début d’après-midi à Alger avec, pour objectif : tâcher de libérer la population de Bab el Oued assiégée et meurtrie par la féroce répression de ceux qui ne nous aiment pas. Des amis très chers habitent ce quartier : je décide donc de m’y rendre dans l’espoir de contribuer à desserrer ce blocus inhumain. J’emprunte un cyclomoteur à un camarade du village, Saint Ferdinand, et file vers Alger à 24 kilomètres de là.
Premier tableau : le barrage des paras, rue Michelet
Je trouve à stationner, place de l’Agha et me rends à pied rue Michelet, là où les premiers manifestants se rassemblent, à vingt mètres au-delà d’un barrage de parachutistes « bérets rouges ». Ils sont une trentaine de paras, l’effectif d’une section de combat, et un capitaine est à leur tête. Ils ont barré la rue et les trottoirs en installant, en travers et à « touche - pare-chocs », deux GMC et deux jeeps.
À cet endroit, côté « manif », ce sont les anciens combattants qui se rassemblent pour former la tête du cortège : ils déploient leurs drapeaux et disposent leurs décorations bien apparentes et quelques-uns arborent aussi les couvre-chefs chamarrés des régiments dans lesquels ils ont servi pour la défense de la Patrie.
A l’heure dite, la foule s’ébranle vers la Grande Poste ; les paras, au coude à coude, font bloc en avant de leurs véhicules ; le capitaine s’avance vers nous agitant les bras pour réclamer le silence : « J’ai l’ordre de vous empêcher de passer ! »
Quelques secondes s’écoulent et c’est alors qu’un ancien combattant s’avance seul vers l’officier para ; il porte son vieil uniforme, c’est un colonel, sa poitrine est constellée de dizaines de décorations, son visage est orné d’une barbe formidable, il se déplace à l’aide de béquilles : il a été amputé d’une jambe après avoir été blessé sur quelque champ de bataille.
Le capitaine salue son ancien, porteur de la Légion d’Honneur et ce dernier, campé à un mètre, répond à son salut et s’adresse à lui d’une voix forte : « C’est toi qui vas m’empêcher de passer, mon petit ? »
L’officier para est pétrifié, décontenancé par ces paroles et l’attitude à la fois digne et intrépide de son ancien ; au bout de quelques secondes d’extrême tension, submergé par l’émotion, ce baroudeur éclate en sanglots : il se tourne vers ses hommes, leur fait signe de s’écarter et il se retire lui-même, l’air navré et comme terrassé par le destin : je me souviens avoir eu de la peine pour lui.
Le chemin est libre : ce premier obstacle franchi, drapeaux en tête, nous reprenons notre marche en avant.
Deuxième tableau : le Plateau des Glières, un deuxième barrage, le contournement, le regroupement.
Je me trouve juste derrière les deux à trois rangées d’anciens combattants qui, sur toute la largeur de la rue, constituent le front de la manif.
Arrivés au milieu du Plateau des Glières, à la hauteur de la statue de Jeanne d’Arc, nouvel arrêt ; je me faufile vers l’avant pour mieux voir ce qui se passe : une troupe espacée nous barre de nouveau le passage vers la rue d’Isly. Nous saurons après coup qu’ils appartenaient à un régiment de tirailleurs. Ils sont en tenues de combat un peu défraîchies, ils arrivent du terrain, du bled ; ils sont disposés à quelque distance les uns des autres, ils tremblent de peur, ils nous menacent individuellement de leurs armes braquées vers nous. Leur chef, un lieutenant, passe, affolé, de l’un à l’autre leur intimant : « Baissez vos armes ! » mais sitôt l’officier passé, ils les pointent à nouveau dans notre direction. A leurs yeux fous, je prends conscience qu’ils peuvent déclencher le feu là, tout de suite. J’ai peur de la panique qui se lit avec évidence dans leur attitude.
Je perçois un mouvement sur ma gauche : d’instinct, je suis et m’engage à travers les jardins pour contourner l’immeuble de la Dépêche Quotidienne qui marque, avec la Grande Poste en face, le début de la rue d’Isly.
Entre temps, sans que je sache comment, les soldats qui barraient la route ont dû s’écarter, car revoilà les anciens combattants qui s’avancent résolument dans cette grande artère entraînant la foule derrière eux.
Je me replace comme auparavant tandis que le cortège poursuit sa progression vers la place Bugeaud.
L’atmosphère est plus détendue, il fait beau, la foule présente est bon enfant, bien que déterminée.
Devant, les anciens marchent d’un bon pas et, passée la place Bugeaud, la manif a tendance à s’étirer un peu : il y a des femmes, des enfants et des gens d’un certain âge qui sont là et qui n’ont pas forcément l’habitude du pas de route imprimé par les vaillants anciens combattants !
Arrivée au bout de la rue d’Isly, à la hauteur du virage qui amorce la rue Dumont d’Urville, la direction de la manifestation décide de marquer le pas pour permettre un regroupement plus homogène du cortège.
Troisième tableau : je grimpe sur un arbre au bout de la rue d’Isly pour rendre compte de l’étendue de la manifestation.
Puisque nous sommes à l’arrêt, je me propose de renseigner les chefs, parmi les anciens combattants, sur l’étendue de la manif et le nombre des participants : j’avise un arbre, un ficus, parmi ceux qui jalonnent le trottoir sur toute la longueur de la rue et, agile et svelte, j’y grimpe sans difficulté. Cet arbre est sur le côté gauche de la rue dans le sens de notre progression.
Je me redresse sur la fourche constituée par les branches maîtresses pour juger de l’efficacité de mon champ de vision : il s’étend sensiblement jusqu’aux deux tiers de la rue, c’est-à-dire que je vois bien au-delà de la place Bugeaud, précédemment dépassée, mais pas tout à fait jusqu’à la Grande Poste dont je n’aperçois que le haut de la construction et les toits de style mauresque : ce sont les frondaisons des ficus qui, par effet de perspective, empêchent mon regard de porter jusque là.
La foule étirée le long de la rue continue d’avancer paisiblement. Je me félicite qu’il y ait tant de gens, plusieurs milliers, peut-être environ dix mille ?
Voilà un hélicoptère Sikorski qui s’approche et survole lentement d’abord le Plateau des Glières. Puis il infléchit sa trajectoire et parvient au dessus de la Grande Poste et là, il effectue un brusque virage à quatre-vingt-dix degrés comme pour aller au-dessus de la manif.
Malgré la distance, je perçois nettement le claquement sec des pales de l’hélico au moment où il effectue ce virage.
C’est alors qu’un film d’images terribles se déroule sous mes yeux et j’ai de la peine à en saisir toute la gravité dans l’instant : je vois en même temps les impacts de tirs d’armes automatiques lourdes, fusils-mitrailleurs ou mitrailleuses, qui fracassent, à hauteur des étages supérieurs, les vitres et les volets des immeubles au-delà de la place Bugeaud : je vois gicler les débris de verre et de bois et la poussière des murs criblés.
Je pense : « Les salauds, ils tirent depuis le G.G. » ; je vois aussi des centaines de gens qui fuient en courant dans la rue depuis la Grande Poste : beaucoup tombent et ne se relèvent pas ; je me dis : « ils font les morts, car on leur tire dessus par-derrière. »
En quelques instants, la moitié de la rue s’est vidée jusqu’à la place Bugeaud.
Je dégringole alors de mon arbre - observatoire et cours vers les Anciens Combattants ; je leur dis : « On nous tire dessus depuis le G.G. et depuis la Grande Poste : la moitié des gens se sont enfuis ! » À ce moment-là je ne peux imaginer qu’il y ait des dizaines de morts et de blessés.
Les chefs se concertent rapidement et prennent la décision de poursuivre la progression vers Bab el Oued.
Quatrième tableau : l’épisode de la rue Dumont D’Urville : les gendarmes mobiles, l’adjudant-chef, l’hélico, les ANP, les gaz.
Lorsque nous arrivons à la hauteur de la rue où, sur la droite, il n’y a plus d’immeubles, mais une placette triangulaire ombragée et bordée par une rambarde en fer forgé, nous voyons accourir, dans la rue en contrebas, un peloton de gendarmes mobiles en disposition de combat : ils ont dû être avisés de la fusillade et progressent courbés en avant comme si nous allions leur tirer dessus alors que nous n’avons aucune arme !
Arrivés à l’extrémité de la rue ils reviennent vers nous, se rendent compte que nous ne présentons pas de danger pour eux et se déploient en travers de la chaussée pour nous barrer le passage.
Nous voilà bloqués, immobilisés, dans une espèce de corps à corps.
J’avise leur chef, qui se trouve quasiment en vis-à-vis et je l’interpelle en ces termes : « Mon adjudant-chef, vous rendez-vous compte du sale boulot que l’on vous fait faire ici ? Vous voyez tous ces anciens avec leurs drapeaux et leurs décorations : c’est pour vous sauver, en France, qu’ils ont été décorés, blessés, mutilés, et maintenant vous voudriez les empêcher de passer pour aller délivrer Bab el Oued où sont nos parents et nos amis ? »
Il commence par ne pas broncher, fait mine de rien puis se jette brusquement vers moi, bousculant les anciens, me saisit aux épaules par mon vêtement et me tire vers lui en arrière : je me retrouve à l’horizontale sur les épaules des anciens combattants ; heureusement, ceux qui se trouvent derrière moi m’attrapent aux jambes et me ramènent promptement en arrière !
Là-dessus, nous voyons approcher le Sikorski déjà cité qui vient tournoyer au-dessus de nous et nous distinguons nettement un de ses occupants qui largue des grenades dans notre direction : il vise mal, car les premières tombent du côté des gendarmes et cela nous fait d’abord sourire, car nous les voyons tout d’un coup s’emparer frénétiquement de leurs ANP (masques à gaz). Nous pensons : « On voit bien qu’ils viennent de débarquer : ils n’ont pas encore l’habitude des lacrymogènes ! »
Erreur ! Lorsque les premières émanations gazeuses nous atteignent, nous ne pleurons pas, nous suffoquons : ils nous ont lancé des grenades asphyxiantes ; nous essayons de happer l’air comme des poissons sortis de l’eau ; d’instinct, en un tournemain, nous nous engageons dans les portes des immeubles les plus proches et nous grimpons les escaliers aussi vite que possible pour retrouver enfin de l’air respirable. Nous restons là une dizaine de minutes à reprendre notre souffle et nos esprits avant de redescendre dans la rue désertée.
Cinquième tableau : le retour sur nos pas, les flaques de sang, le lieutenant para cameraman, le Père Blanc., le retour à l’Agha puis vers le village.
Les anciens se concertent ; le cœur n’y est plus : ces quelques grenades d’un genre inusité nous ont tous affaiblis physiquement et moralement : ils décident de revenir sur nos pas sans idée de manœuvre et de nous disperser.
Pendant cette marche en retraite désabusée fusent les interrogations de toutes sortes sur la sauvagerie de nos adversaires face à des civils désarmés et sur qui l’on tire ou balance des grenades asphyxiantes.
Arrivés à mi-chemin entre la place Bugeaud et la Grande Poste nous découvrons les premières flaques de sang de nos malheureux compatriotes blessés ou assassinés.
Environ une demi-heure s’est écoulée depuis que j’ai assisté de loin au début de la fusillade et les ambulances ou les pompiers ont déjà évacué toutes les victimes. Mais les flaques de sang sont là, stigmates innombrables et tellement pitoyables. Nous entendons encore des rafales sporadiques de FM 24/29 : « doum, doum, doum … doum, doum, doum … » ; ça tire, me semble-t-il, depuis le G.G. mais dans quelle direction, mystère ?
Au pied de l’immeuble de la Dépêche Quotidienne un lieutenant « béret rouge » accompagné de son aide, para lui aussi, est là, caméra sur l’épaule : il est traumatisé ; il sanglote d’émotion horrifiée, il nous dit : « J’étais là, j’ai tout vu, j’ai tout filmé, ces bobines, je les préserverai, « ils » ne pourront pas les détruire ou les camoufler, faites-moi confiance ! ».
Voilà un Père Blanc, habit et cape blancs, chéchia rouge et barbe de conséquence, qui s’apprête à traverser le Plateau des Glières alors que le FM égrène encore quelques rafales : nous sommes trois ou quatre à vouloir le retenir, mais il se dégage, s’élance résolument en nous lançant : « Vous savez, avec l’aide de Dieu, je n’ai pas peur de la mort ! » Nous le regardons s’éloigner avec la crainte de voir sa silhouette hardie s’écrouler après un tir assassin, mais, heureusement, rien de la sorte ne se produit et il n’y aura plus de tirs après son passage.
Nous sommes abasourdis, comme assommés, hébétés par tout ce que nous venons de vivre et, au bout d’un court moment, je décide de regagner ma place de stationnement et de reprendre le chemin du retour vers le village.
Mes conclusions :
J’ai eu beaucoup de peine, sur le moment, à me convaincre que des représentants de l’armée aient pu tirer sur nous comme sur des ennemis et, de plus, dans le dos, sans raison et à l’aveuglette.
Pour moi, c’est l’hélicoptère, par le brutal claquement de pales au moment de son virage serré, qui a provoqué la fusillade en faisant croire à ces soldats du bled - que j’avais vus dangereusement paniqués auparavant - qu’ils étaient attaqués.
Semblable manœuvre n’était peut-être pas accidentelle puisque le même appareil nous a ensuite gratifiés de ses fruits empoisonnés, les grenades asphyxiantes, armes qui, à ma connaissance, n’avaient jamais été utilisées auparavant contre des manifestants civils.
Qui commandait à bord de l’hélico ? À quelle unité appartenaient ses occupants ?
Les gendarmes mobiles postés au G.G., quant à eux, ont alors immédiatement déclenché le feu sur les immeubles qui leur faisaient face : ils avaient donc reçu des ordres pour cela ; il s’agissait donc bien de « casser » du Français d’Algérie puisqu’ils ont osé tirer à l’aveuglette dans les appartements où ils ont tué et blessé des gens qui ne participaient même pas à la manifestation.
L’attitude du capitaine de paras du premier barrage m’avait troublé : pourquoi avait-il éclaté en sanglots avant de nous laisser le passage libre ? Il savait donc ce qui allait advenir ! Il savait qu’on allait nous tirer dessus !
Que faisait cette poignée de soldats du bled à cet endroit ? Qui les y avait installés et avec quelles consignes ? Pourquoi avaient-ils si peur ? Que leur avait - on raconté ? Pourquoi se sont- ils autant acharnés sur nos malheureux compatriotes ?
Tout cela montre bien la volonté du gouvernement de l’époque de nous détruire ou à tout le moins de nous réduire au silence !.... Il fallait laisser le champ libre à nos ennemis d’hier qui maintenant devenaient les maîtres du pays……
https://www.miages-djebels.org/spip.php?article34
.
Rédigé le 30/04/2023 à 18:40 dans France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
« Je voudrais, de toute mon âme, être le Central de la pacification, la vraie cette fois, celle des esprits.
« Je rêve d’une Alger où les hommes s’entraiment enfin, sans plus être séparés par des races, des religions ou des mers. »
SHur sa page Facebook Jean-François Gavoury s’adressant à un ami écrit :
" Le combat que je mène depuis une décennie et demie pour la reconnaissance par les pouvoirs publics des victimes de l'OAS se double, depuis tout juste 5 ans, d'un autre... contre la maladie.
Celle-ci se montre implacable ".
Le 8 février 2022 il prononça une allocution lors de la cérémonie commémorative des neuf morts de Charonne.
« Émotion à l’écoute de Delphine Renard qualifiant si opportunément de « Justes » les neuf morts de Charonne et bénissant leur mémoire ».
L’extrait de vidéo ci-dessous est un montage que j’ai réalisé, patientez 10 secondes avant son début.
Sur sa page Facebook Jean-François Gavoury s’adressant à un ami écrit :
" Le combat que je mène depuis une décennie et demie pour la reconnaissance par les pouvoirs publics des victimes de l'OAS se double, depuis tout juste 5 ans, d'un autre... contre la maladie.
Celle-ci se montre implacable ".
Le 8 février 2022 il prononça une allocution lors de la cérémonie commémorative des neuf morts de Charonne.
« Émotion à l’écoute de Delphine Renard qualifiant si opportunément de « Justes » les neuf morts de Charonne et bénissant leur mémoire ».
L’extrait de vidéo ci-dessous est un montage que j’ai réalisé, patientez 10 secondes avant son début.
http://www.micheldandelot1.com/
.
Rédigé le 30/04/2023 à 17:57 dans France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
http://www.micheldandelot1.com/
.
Rédigé le 30/04/2023 à 17:48 dans France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)

Le général Henry-Jean Fournier, ancien chef de corps du 152e RI dans les années 90, s’attela à reconstituer toute l’histoire de ce régiment, celui des « Diables Rouges » [1]
En 2008, par une annonce dans le bulletin de l’association des anciens, celui-ci rechercha des témoins ayant vécu la période de la guerre d’Algérie, qu’il n’a pas connue en tant que militaire car âgé de 16 ans au moment de l’Indépendance.

J’ai répondu « présent »... ! Appelé directement en Algérie j’y ai accompli la totalité de mon service militaire, d’abord à l’école de Cherchell, puis, en avril 1962, ayant choisi le 152e RIM, j’ai rejoint Zéralda, situé à 25 km à l’ouest d’Alger, où il venait d’arriver. Les « Diables Rouges » s’installèrent dans ce magnifique camp construit par les légionnaires du célèbre 1er REP qu’ils durent quitter dans les conditions que l’on connaît, après le putsch d’avril 1961.
Comme pour beaucoup, cette période du service militaire en Algérie m’a beaucoup marqué, d’autant plus qu’elle coïncida avec celle du dénouement, d’un conflit dramatique, long de sept ans, qui mit fin à un chapitre de l’histoire de notre pays, commencée en 1830... Arrivé à Cherchell six mois avant le cessez-le-feu, j’ai vécu ensuite l’épuisante et démoralisante activité du « maintien de l’ordre » à Alger, pour laquelle nous n’avions nullement été préparés dans cette école.
Elle prit fin au moment de l’Indépendance et nous avons pu regagner notre camp et connaître enfin la vie paisible de garnison comme dans une ville de Métropole, avec comme mission (théorique...), durant deux ans, de faire respecter les accords d’Évian...
Durant cet été 1962, nous redécouvrons l’instruction, de fréquentes prises d’armes devant un parterre de généraux venus d’Alger, de brillantes réceptions, des concerts donnés par d’excellents musiciens de la musique du 9e Zouave car issus du Conservatoire de Paris, la plage, les rencontres sportives entre unités, les excursions (à Tipasa, au tombeau de la Chrétienne) etc.
Nous faisions de l’instruction, parfois à des hommes de troupe décorés de la « VM », (la Croix de la Valeur Militaire) ! C’était en quelque sorte le repos, l’insouciance... Or, justement, à l’automne, nous apprenons, sans en mesurer leur importance, du moins à notre niveau, nous autres officiers subalternes, les exactions à rencontre des « pieds-noirs » et des harkis...
À ce moment-là nous apprenons qu’un camp de réfugiés pour les harkis et leurs familles est créé à l’intérieur de notre camp. Les évènements surprenants, anormaux, se succédant, comme d’autres, je ne me posais pas tellement de questions à ce moment là. Ce n’est que 50 ans après, en rédigeant cette histoire que j’ai commencé à me les poser...
LA SITUATION APRÈS L’INDÉPENDANCE
Tout de suite après l’Indépendance les harkis se sentent de plus en plus menacés. Dans les négociations à Évian ce sujet avait été traité. Ceux-ci devaient pouvoir retourner vivre dans leurs douars. Quelle utopie ! Mais cette solution arrangeait bien le gouvernement français !
Beaucoup d’officiers étaient conscients de ce qui allait arriver. Dès la fin de 1961, certains, en particulier, ceux qui avaient géré des SAS2 [2], ont ramené discrètement leurs hommes en Métropole, ce qui avait irrité le Ministère de l’Intérieur... Certains ont été sanctionnés. Et des mesures ont été prises pour freiner ces initiatives.
En juin 1962, un ancien de Cherchell, le sous-lieutenant Jean-Pierre Fourquin, est chef de la SAU, (SAS urbaine) de la Mékerra à Sidi-Bel-Abbès à environ 80 km d’Oran. En cette période on ne peut plus troublée, où il était strictement interdit de ramener des supplétifs en Métropole, il prit l’initiative de sauver un groupe d’une vingtaine de moghaznis [3]...
Il demanda à rencontrer le commandant adjoint du colonel Vaillant, patron de la Légion à Sidi-Bel-Abbès afin d’obtenir son aide ! Celui-ci mit à sa disposition deux GMC avec des hommes surarmés ! L’opération s’est bien passée puisqu’ils furent ramenés à Sidi-Bel-Abbès où un avion Nord Atlas les a rapatriés par la suite en Métropole. Jean-Pierre Fourquin a eu la chance de ne pas avoir été inquiété par les autorités... « Pas vu pas pris ! ».
Un de mes camarades de promotion, Michel Binauld, avait choisi le 27e RTA [4] en sortant de Cherchell. En avril 1962, à peine arrivé à Tiaret, son régiment quitte l’Algérie pour l’Allemagne. Lui est détaché à l’État-major de la 4e DIM basée à Mostaganem. Sous les ordres du général Fayard, il reçoit comme mission de se rendre (en avion et en hélicoptère) dans les préfectures et sous-préfectures pour récupérer les listes de harkis et leurs adresses... Ensuite une unité du train a été chargée de ramener ces familles qui ont été dirigées sur le port d’Oran pour être évacuées en Métropole. Ces missions « irrégulières » prirent fin juste après l’Indépendance.
Les assassinats se multiplient. Les survivants réalisent qu’ils ne pourront rester dans leur pays. Le phénomène prend de l’ampleur. Le problème est remonté évidemment jusqu’à Paris. Boumediene, le vice-président, interpellé par le gouvernement français, réagit mollement, ne fait rien ou ne peut rien faire... Le général de Gaulle, qui avait définitivement tourné la page de la guerre d’Algérie, aurait dit à ce sujet à Pierre Messmer, son ministre ses armées : - On ne va tout de même pas recommencer la guerre d’Algérie ! Pierre Messmer, qui était lieutenant-colonel de réserve, effectuait une période militaire en Algérie au moment où le Président de la République l’a nommé en 1960. Antérieurement, il avait servi dans la Légion. Il connaissait parfaitement le problème des harkis, ce qu’ils avaient fait pour la France... En Algérie !
Les accords d’Évian prévoyaient que l’Armée resterait en place encore deux années après l’Indépendance. Conscients de ce qui les attendait, les survivants, ont réalisé que leur seule chance de survie consistait à venir, avec leur famille, se réfugier dans les casernes et camps implantés dans le pays. On dit qu’ils n’ont pas toujours été accueillis... Certains auraient été refoulés et abandonnés à leur triste sort, du moins au début. À l’automne, suite à un ordre de l’État-major, les unités ont fini par les laisser rentrer.
Bureau du camp
En 2003, lorsque le problème des harkis a refait surface, l’armée a été à nouveau montrée du doigt. Pierre Messmer est monté au créneau pour la défendre. Interviewé par .P Elkabbach le 7 novembre 2003 au matin sur Europe 1, il a affirmé clairement que l’Armée en avait sauvé 100 000 (en comptant leurs familles). Qui était-ce l’Armée... ? Le 152e RIM ! C’est ce que je me suis empressé de préciser le lendemain dans le journal local, L’Alsace à Colmar, ville de garnison de ce régiment.
LA DÉCISION
À l’automne 1962, il fut décidé de regrouper tous les réfugiés dispersés, venus chercher la protection de l’Armée. Le lieu le plus approprié était Zéralda, probablement parce que le plus grand camp, et surtout le plus proche du port d’Alger, où l’Armée avait conservé le quai Fedallah après l’Indépendance. En principe, cela ne devait durer que quelques semaines !
En réalité ce camp a perduré jusqu’au départ du 152e (devenu RI) sur Colmar en mai 1964, puisque les derniers ont été embarqués avec le régiment, comme me l’a rappelé le colonel Bonnouvrier, à l’époque lieutenant, officier de renseignement.
Récemment, un autre ancien de Cherchell, Vincent Zaragoza, ayant appris mon histoire, s’est confié : affecté au 65e BIMA [5], et basé à la ferme Bastos à Aïn-El-Turk [6], celui-ci a été discrètement approché par le capitaine-major Orlanducci en poste à Bousfer [7], la base arrière de cette unité.
Jusqu’en août de cette même année, il lui confia des missions (en tout une douzaine), apparemment bien organisées mais dont il ne connaissait que la partie le concernant. Il s’agissait d’aller récupérer des « colis », dans un périmètre de 50 à 75 km...
Cela consistait à se rendre, de nuit, en 6x6 Hotchkiss, accompagné du sergent Gabriel Choisy dit « Gaby », et du chauffeur Moussy, équipé d’un brassard de couleur, tous armés, jusqu’à un lieu parfaitement défini. Arrivé à destination, il devait retrouver une famille portant un brassard de la même couleur. Celle-ci était immédiatement embarquée et ramenée jusqu’à son unité. Un jour il est passé sans s’arrêter devant un attroupement suspect, craignant un guet-apens... Ensuite il ne savait ce que ces familles devenaient... La destination ne pouvait être que Zéralda !
Toute la partie sud-ouest du camp, jusqu’à l’allée principale, a donc été réservée aux réfugiés venus de tout le pays. Très rapidement les effectifs dans le camp sont montés à plus de 1 000 personnes.
LE LIEUTENANT MASSOULIÉ
Qui a donné le feu vert pour créer et organiser la gestion du camp de Zéralda ? Question que je ne me suis pas posée à ce moment là... À cette époque, il se passait tant d’événements anormaux que tout paraissait « normal » pour un jeune sous-lieutenant... En 2008, un témoignage important me manquait : celui du lieutenant Massoulié, arrivé quelque semaines après moi, lui aussi détaché comme adjoint du directeur du camp de réfugiés harkis de Zéralda...
Madame Massoulier
Avec une barrette de plus, il m’aurait permis d’obtenir davantage d’informations sur l’origine et la gestion de ce camp... Les trois directeurs successifs du camp, plus âgés que nous, ont probablement disparu...
Seul Michel Massoulié, que j’avais recherché en vain, pouvait les détenir... Celui-ci a été retrouvé en 2010 (dans l’annuaire des anciens de Saint-Cyr !)
Le 17 septembre 2011, une rencontre a pu être organisée à Sarlat, au domicile du lieutenant-colonel Massoulié, en présence du général Fournier, ancien chef de corps du 152e RI, à l’origine de la rédaction de « Diable Rouge à Zéralda ».
Efficace et dévoué à la cause des harkis, ce lieutenant a été l’âme et la cheville ouvrière du camp de réfugiés ! Il s’est donné à fond dans cette mission. Il aura été le représentant de ces chefs qui estimaient avoir une dette vis-à-vis de ces soldats que nous avions entraînés dans l’aventure de la guerre d’Algérie. Non seulement il parlait le français, l’espagnol et l’anglais, mais maîtrisait parfaitement l’arabe. Comme sous-lieutenant, il commanda une harka, pendant un an ! Il était parfaitement à l’aise avec cette population.
Retour d’Alger : capitaine Sendra et lieutenant Massoulier et son épouse.
Il habitait à Alger mais passait le plus souvent ses nuits au camp et venait, accompagné de son épouse qui y travaillait bénévolement. Grâce à lui, j’ai découvert que nous avions la possibilité de prendre beaucoup d’initiatives !
Et cette rencontre de Sarlat a permis de donner les réponses à des questions restées posées jusque là...
QUI A ÉTÉ À L’ORIGINE DE CETTE IMPORTANTE ORGANISATION ?
Les décisions n’ont pas été prises à Paris, mais à Alger, comme nous l’a affirmé le colonel Massoulié. Ce sont les généraux d’Alger qui auraient mis le gouvernement du général de Gaulle devant le fait accompli ! Cependant :
Finalement, comme nous l’a commenté le général Fournier : Aux époques difficiles de notre Histoire, les gouvernements ont parfois pratiqué le double langage... A Le jardin d’enfants. Et cette importante mission est restée discrète !
QUI FINANÇAIT LE CAMP DE RÉFUGIÉS DE ZÉRALDA ?
Le lieutenant Massoulié avait des relations privilégiées avec le commandant Tréjaut qui commandait le « Bastion 15 », c’est à dire les installations portuaires d’Alger, restées françaises après l’Indépendance.
Celui-ci l’a mis en rapport avec l’intendant général Peyrat, qui l’a totalement soutenu dans sa mission de rapatriement des harkis. Celui-ci lui a déclaré qu’il obtiendrait tout ce dont il aurait besoin ! C’est l’Intendant Général qui a financé le fonctionnement du camp (partiellement en liquide).
COMMENT ÉTAIT APPROVISIONNÉ LE CAMP ?
C’est le directeur du camp qui assurait l’approvisionnement au moyen des GMC du camp, auprès des services de l’Intendance. Qui a fourni le matériel, les vêtements ? C’est la « Croix rouge » d’Alger qui a fourni :
L’ORGANISATION
Une structure militaire insolite a été créée, dépendant directement de l’État-major d’Alger. Un premier « Directeur du camp », le capitaine Gagnoulet, un cavalier, a été nommé. Le 13 novembre j’ai été détaché du Régiment comme adjoint au « directeur ».
Deux autres capitaines ont succédé au capitaine Gagnoulet : le capitaine Mauffrais puis le capitaine Sendra, un ORSA [8], détaché lui aussi du 152e. « Pied-noir », il était très préoccupé par sa ferme située dans les environs, au moment où le gouvernement algérien commençait à multiplier les nationalisations.
Il y avait trois médecins, des infirmiers, une assistante sociale, madame Gamondès, des sous-officiers et hommes de troupe également détachés du 152.
En tout, cette structure assez hétéroclite, comprenait une vingtaine de militaires. Il fallait un secrétariat, assurer les approvisionnements, gérer la cuisine, l’école, le jardin d’enfants, l’infirmerie-hôpital avec 12 lits, et même une pouponnière !
Sur cette activité insolite dans un camp militaire, le premier directeur du camp, le capitaine Gagnoulet précise : La patience et la compétence de plusieurs aides bénévoles, de l’assistante sociale, animatrice de l’ensemble font que les parents, déjà étroitement logés, se trouvent très satisfaits d’être débarrassés des criailleries de leurs enfants pendant une partie de la journée...
Tous ont travaillé passionnément. Finalement cette mission plutôt insolite chez les « Diables Rouges » aura été gratifiante pour chacun d’entre nous. Je me souviendrai toujours de la réflexion du général de Massignac, venu nous rendre visite et qui m’a dit : Vous avez beaucoup de chance... Vous participez à la dernière mission intéressante en Algérie !
LA MISSION
Les objectifs fixés étaient :
Pour les enfants, une école et un jardin d’enfants ont été créés. Un instituteur du contingent, « Diable Rouge », s’était donné corps et âme à sa mission avec beaucoup de professionnalisme. Il s’appelait Noël. Nous avions réussi à lui obtenir tout ce dont il avait besoin : fournitures de classe, jouets, tableau noir, tables d’école... Les enfants l’adoraient ! Comme ceux-ci n’étaient que de passage pour quelques semaines, l’organisation de ses cours n’était pas simple.
En tant qu’ingénieur textile, j’ai pu monter un (modeste) atelier textile où des femmes cardaient et filaient la laine avant de procéder au tissage.
Rapidement nous avons libéré les « Diables Rouges » de certaines tâches, à la cuisine par exemple, en les remplaçant « aux pluches » par des femmes. Une façon de les préparer à leur vie future. Les hommes, qu’il ne fallait surtout pas laisser inactifs, étaient rassemblés chaque matin, sur la place pour « la montée des couleurs ». Ensuite nous les employions pour des travaux. Nous souhaitions adapter les baraques militaires à ces nouveaux venus. Nous voulions réaliser des chambres par famille. Des cloisons ont été montées à l’intérieur, puis mises en peinture dans des coloris gais.
Le camp lui-même avait été aménagé avec des allées bien tracées, des petites barrières peintes en blanc, des massifs de fleurs. On a semé du gazon, des radis... Le pauvre secrétaire ne chaumait pas : il passait son temps à se faire dicter les noms de tous ces gens... Avec bien du mal, nous avons réussi à obtenir, en plus d’une camionnette mise à notre disposition dès le début, une « voiture de fonction » : comme il n’y avait pas de jeep, ce fut une 2CV Citroën
Elle servait parfois au ramassage des sous-lieutenants descendant au mess... Une ou deux fois par semaine j’emmenais les listings à Alger où l’on vérifiait qu’il s’agissait bien de harkis. Procédure nécessaire avant de leur donner la nationalité française et de préparer leur prochain embarquement. Et puis, nous avions toujours la crainte de voir ce camp infiltré par des éléments indésirables... Ces procédures ne devaient pas traîner car le camp n’était pas extensible. Au retour de chacun de mes déplacements à Alger, je ramenais
les listings précédents, vérifiés. Il y avait parfois des « gags » car les effectifs ne correspondaient pas toujours à la réalité. L’explication ? Il y avait des naissances, dans le camp, sans que nous en soyons avertis.
LES DÉPARTS
Un détachement du « train » était basé en permanence dans le camp de Zéralda. Celui-ci était commandé par le lieutenant Lavergne qui avait la particularité de porter une grosse moustache. C’est lui qui assurait une ou deux fois par semaine le transport et la sécurité de cet immense convoi comprenant une trentaine de véhicules de transport SIMCA, soigneusement bâchés, une jeep de commandement avec radio et deux blindés placés à l’avant et à l’arrière. Il était mis en place dans l’allée principale du camp.
Chaque départ se faisait avec quand même une certaine appréhension : il s’agissait d’amener au port distant de 25 km environ, par la route de la corniche (la nationale N°11), cet impressionnant convoi confidentiel, dans ce pays indépendant où la chasse aux harkis était ouverte ! Il faut rappeler que tous ont été effectués après l’indépendance et durant deux années !
Avant l’embarquement, il fallait reprendre les listings pour faire l’appel. Sur un bateau nous embarquions en moyenne 400 à 600 personnes. Et puis, retour au camp pour préparer le prochain départ ! Un jour un camion est tombé en panne...
Nous étions déjà dans la banlieue. Le convoi a été stoppé. J’ai assisté à l’habile manœuvre de ces hommes du train. Il y avait heureusement toujours un camion vide. Un espace suffisant a été créé pour pouvoir le faire manœuvrer à l’envers jusqu’à le coller contre l’autre. Les bâches ont été détachées depuis l’intérieur et tous les occupants sont passés de l’un à l’autre sans que personne n’ait vu quoi que ce soit de l’extérieur !ne fois arrivés au quai Fedallah, resté en quelque sorte territoire français, nous étions rassurés : il était gardé par l’Armée.
U
Une fois refermé, le nouveau camion a manœuvré et a été replacé dans le convoi et on est reparti... Ni vu ni connu !
UNE OPÉRATION COMMANDO... RATÉE
Un jour un harki, très malheureux, vient me voir :
J’ai eu pitié de lui... Je suis allé voir mon copain le sous-lieutenant Jarrier, -adjoint de l’officier renseignement du régiment, qui connaissait bien le pays, (où il avait fait ses études supérieures). Je lui explique le problème.
Nous savions que si nous demandions à notre hiérarchie d’organiser une opération, même discrète, dans le contexte actuel, nous aurions essuyé un refus catégorique. Comme cela nous paraissait simple, nous nous sommes mis d’accord pour organiser tous les deux, un « déplacement » à Blida, sans rien dire à personne...
L’après-midi, avec une camionnette, une Peugeot 403 bâchée « empruntée », nous embarquons notre harki à l’arrière et la refermons complètement. Elle portait une immatriculation militaire et nous étions en uniforme (tenue de sortie). Les autorités algériennes ne pouvaient légalement pas nous contrôler. Je ne me souviens pas, mais je pense que nous n’étions pas armés. L’aller se passe sans problème jusqu’à Blida, située à environ 60 km au sud d’Alger.
À peine une heure plus tard, nous sommes arrivés à un endroit discret que notre harki nous avait précisé. Nous descendons, et après avoir vérifié qu’il n’y avait personne dans la rue, nous ouvrons la bâche et le laissons filer. Quoi qu’il arrive nous avions convenu de ne pas bouger de cet emplacement jusqu’à son retour, accompagné de sa famille.
Le temps passe... Les heures s’écoulent... Toujours personne... Finalement, en fin d’après midi, début de soirée même, nous concluons que l’opération était ratée. Il ne reviendrait pas ! Il y avait deux hypothèses :
Nous avons pensé que c’était plutôt la seconde hypothèse... Et nous sommes rentrés un peu dépités...
Attristés par cet échec, nous avons dû faire quelques confidences aux copains. Et des fuites sont arrivées aux oreilles du colonel... Dès le lendemain, en arrivant au mess, le colonel Joana m’attendait et m’a amené dans un coin pour me passer un savon mé-mo-rable... !
Il avait parfaitement raison. Nous aurions dû, soit mettre quelqu’un dans le secret, soit laisser des explications sur un papier. Finalement, pour ce qui nous concerne, nous avons peut-être eu de la chance...
Ce malheureux harki, volontairement ou pas, aurait pu signaler notre présence : nous n’avions pas bougé de l’après midi !
LA FÊTE DE L’AÏD EL SEGHIR
Le 24 février 1963, le camp de réfugiés organise un immense méchoui, à l’occasion de cette fête musulmane qui met fin au ramadan.
Une quinzaine de moutons avait été achetée et ramenée dans le camp. Ils furent hébergés pour la nuit dans une baraque inoccupée. Avant de passer à la broche, on les entendit bêler une bonne partie de la nuit !
Le lendemain, à l’aube, tous les feux, bien alignés, sont allumés. À l’heure de l’apéritif, les personnalités locales et d’autres venues d’Alger entrent dans le camp, en particulier le général Lemasson, commandant la 20e Division, le général de Massignac, commandant la 32e Brigade, notre chef de corps, le colonel Joana.
Tous admirent l’alignement des méchouis, cuits à point, portés par deux hommes, grâce à de grandes broches en bois. Le repas est servi sous des tentes avec décoration locale. Les invités sont assis sur des coussins devant des tables basses. Très belle réception en l’honneur de ces harkis et de nos chefs militaires qui sont venus à cette occasion soutenir et encourager notre action.
UNE ATTAQUE NOCTURNE ?
Jamais, au cours des six mois passés dans ce camp, nous n’avons eu à déplorer un quelconque incident. Certains nous remettaient des armes à leur arrivée. Rassurés par la présence du régiment, nous restions cependant sur nos gardes.
Un soir, le capitaine Sandra (le troisième « directeur » de ce camp), me prévient de son départ chez lui dans sa ferme. Le lieutenant Massoulié m’informe que lui aussi s’en va chez lui à Alger, et me dit :
Pas spécialement inquiet, je vais dîner comme chaque soir au mess, m’y suis peut-être attardé avec les copains puis rentre me coucher au camp. Il était 1h 1/2 du matin, lorsque, comme l’ensemble du camp, je suis réveillé brutalement par des bruits semblables à des rafales d’armes automatiques (FM ou PM), que je n’avais plus entendues depuis 6 mois...
L’officier du matériel du 152e est réveillé. On lui dit que la soute à munitions est en train de sauter ! Non, mais ailleurs on croit partout que le camp de réfugiés est attaqué ! Ce sont effectivement de véritables rafales que l’on a cru entendre provenant de notre camp.
Un homme affolé fait irruption à ce moment là dans ma chambre :
Je m’empresse de savoir s’il y avait du monde à l’intérieur. Seules deux personnes étaient dans la chambre à une des extrémités et sont sorties à temps. Jute à côté se trouvait la cuisine avec six grosses bouteilles de gaz...
Quelques minutes plus tard, je vois arriver en pyjama le lieutenant-colonel Olive. L’adjoint du Chef de corps, était aussi un des personnages du régiment. Plutôt rondouillard, il avait l’accent prononcé de Marseille, sa ville d’origine et ce qui ne manque pas de sel, se prénommait Marius, comme on peut le vérifier dans le JMO.
Aussitôt arrivé, il prit les opérations en main, ce qui me soulageait. Mais nos valeureux pompiers n’intervinrent que 1/2 heure plus tard. La baraque était déjà par terre. Lorsque l’on voulut mettre en route la motopompe, dans le noir, ils prirent beaucoup de temps à trouver le démarreur... Au moment de la mise en route, la lance s’est brutalement retournée dans la direction du colonel en pyjama...
À 3 h tout était éteint. Bien entendu, le matin, je suis prié de faire une enquête et de rendre compte ! Notre camp était clôturé assez symboliquement et par conséquent pas vraiment étanche. Il y avait parfois des passages, mais seulement dans un sens. Les harkis n’avaient aucun intérêt dans la situation précaire qu’ils vivaient, à aller s’aventurer chez les « Diables Rouges ».
Leur seule motivation étant de partir très vite en Métropole, ils restaient très sages. Par contre les « Diables Rouges », je savais qu’ils s’aventuraient parfois de notre côté par des points de passages pas très compliqués à trouver. Ils y allaient « en invités ». Ce soir là, il y avait effectivement une petite réception, plus précisément une « brochettes-party ». Pour rester discrète, celle-ci eut lieu dans une baraque qui n’était occupée que dans une chambre à l’extrémité.
Et pour ne pas se faire remarquer, ils placèrent également leur « kanoun9 », à l’intérieur, sur le plancher même. Une fois la fête terminée, chacun est rentré chez soi, en abandonnant le « kanoun » [9] sur place, sans se rendre compte qu’il devait être encore brûlant !
Je ne me souviens plus s’il y eut des sanctions, mais l’adjoint du chef de corps en a tiré les conclusions nécessaires. Immédiatement, on reçut l’ordre, dans tout le camp, d’installer des caisses à sable, peintes en rouge, devant chaque bâtiment...
LES SOUTIENS AU SEIN DU 152e
Michel Massoulié a souligné le soutien sans faille du chef de corps de l’époque : le colonel Joana, qui a succédé au lieutenant-Colonel Chevillotte le 24 octobre 1962. Un autre officier du 152° a joué un rôle très actif au moment où il a été affecté comme Officier Renseignement au printemps 1963 : Le lieutenant Henri Bonnouvrier.
Antérieurement, celui-ci s’était distingué au combat et obtint la Légion d’honneur alors qu’il commandait la harka à cheval du 7e Tirailleurs dans les Aurès. Lui aussi a terminé sa carrière comme colonel.
LA « QUILLE » POUR LA 61/2-C !
Le 8 avril 1963, le général de Massignac, commandant la 32e Brigade, vient à Zéralda pour présider la revue de libération du contingent 61/2-C, dont je faisais partie.
Incorporé en novembre 1961 pour 28 mois, nous avons été le premier contingent à rester 18 mois sous les drapeaux !
En ce qui me concerne, je n’étais nullement pressé de partir... Mon dernier « job » m’avait passionné et je serais bien resté pour continuer cette mission de rapatriement des harkis !
Nous avons embarqué sur le « Ville de Marseille », tout un symbole, pour moi qui avais débuté cette aventure en novembre 1961 sur le « Ville d’Alger » !
À peine rentré dans ma famille, je suis allé jusqu’au camp de Rivesaltes, près de Perpignan, l’un des deux camps où nous dirigions les réfugiés. L’autre camp était à Saint-Maurice-l’Ardoise, dans la Drôme. Je souhaitais savoir ce qu’ils devenaient ! J’ai été surpris par la bonne organisation gérée par l’armée. Finalement, comme nous autres de l’autre côté de la Méditerranée, ils se sont donnés à fond dans cette mission, se rappelant notre responsabilité dans ce triste destin !
L’hébergement était ce qu’il pouvait être dans un camp militaire. Mais le but n’était pas de les y maintenir, en tout cas à ce moment là. Une antenne d’un ministère (du travail ?), était installée sur place.
Le début des années 60 était une période bénie pour trouver du travail ! Pour moi-même, ce sont deux entreprises qui m’ont ouvert leurs portes. Et cette situation concernait tout le monde : cadres, techniciens, personnel ouvrier.
C’est ainsi que le pays a pu absorber l’arrivée de plusieurs centaines de milliers de « pieds noirs », mais aussi les réfugiés harkis ! Il leur était proposé un job en fonction de leur souhait. Ils étaient conduits jusqu’à la localité de leur choix. Si la proposition ne leur convenait pas, ils avaient la possibilité de revenir dans le camp où une deuxième offre leur était faite.
Il pouvait y en avoir une troisième et dernière. Après, puisqu’ils ne semblaient ne pas pouvoir s’adapter, ils restaient... Finalement ce sont ces gens dont on a entendu parler et qui ont été parqués dans des camps depuis, et ont été employés le plus souvent dans les forêts...
Mon père, chef d’entreprise, en a fait embaucher dans une entreprise de travaux publics. Durant plusieurs mois, ma mère prit à son service Zohra, la veuve d’un ancien harki. Elle ne s’habitua pas à cette vie et retourna dans le camp de Rivesaltes...
Jacques Vogelweith Mai 2016
[1] Le 152e régiment d’infanterie de ligne (152’ RI) est une unité de l’armée française, créée sous la Révolution française. Il a été surnommé régiment des Diables Rouges par les Allemands au cours des combats du Vieil Armand (l’Hartmannswillerkopf) en 1915.
[2] Les sections administratives spécialisées (SAS) étaient chargées de l’assistance scolaire, sociale, médicale envers les populations rurales musulmanes.
[3] Moghaznis : supplétifs des SAS.
[4] Le 27e Régiment de Tirailleurs Algériens.
[5] Bataillon d’infanterie de marine.
[6] Aïn-El-Turk est située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest d’Oran.
[7] Bousfer ou Aïn Boucefar est située à 20 km à l’ouest d’Oran.
[8] ORSA (officiers de réserve en situation d’activité).
[9] Kanoun : Poterie creuse, en terre cuite, utilisée comme un brasero, pour la cuisson des aliments au charbon de bois.
Merci pour votre article sur le camps de réfugiés à Zéralda ou j’ ai ef//04 /64fectuté une partie de mon service militaire du 16 : 10:63 au 08/ 04/64 à la 8 cie ; Vous apportez la réponse que je me posait sur le sort de ces pauvres gens , je n’ ai eu qu’ une seule fois à me rendre dans leur camp , lors du ramassage des poubelles Une pensée également à notre camarade Noel Rosier assassiné le22 janvier 1964 de la 6 cie du capitaine Mestellan à Rampe Valllée Alger , j’ étais de garde ce jour à la caserne Pélissier ; J’ essaie de retrouver l’ endroit exact de ce soir maudit , Jai eu par l’ intermédiaire de l’ ancien radio de la 6 cie ( JM Prely ( quelques renseignements ) j’ essaye de reconstituer cette période , , mais après tout ce temps la mémoire s’ efface quelque peu . CORDIALEMENT Michel RUCH
j aifait 16 mois dans ce camp magnifique avec le commssandant longeret
MERCI pour ce message j’ai effectué d’Octobre 1962 à Décembre 1963 mon service militaire au camp de ZERALDA sous le commandement du Commandant LONGERET. J’ai été affecté au service du chiffre et du renseignement sur la 20DI, avec le colonel IOANAS j’ai donc beaucoup de souvenir sur le camp magnifique de ZERALDA,mais aussi des moments dramatiques, avec l’armée ALGERIENNE contre les harkis. Je me réjouis actuellement que l’actuel gouvernement va reconnaitre ma classe la 62/2A pour la carte du combattant. Merci à tous Pau BLANC
Classe 62/1A. La 2/407 CRD a rejoint le camps de Zéralda en octobre 1962. Nous étions basé auparavant a la ferme des 4 chemins prés de Boufarik. Nous n’étions pas sous les ordres du 152 et notre petite unité se trouvait en exterieur du camps dans l’ancien dépôt de munitions de l’ex 1er REP Notre chef de section etait le lieutenant Chevalier, un vrai chef. Puis remplacé par la suite par le lieutenant Lavergne, cité par un Vosgiens comme faisant parti du génie. Ce qui est faux. Ce même Vosgiens cite aussi les valeureux pompiers ne trouvant pas le démarreur du groupe d’incendie lors de la supposé attaque du camps de Zéralda. Erreur, la batterie était a plat. Je précise que c’est notre section du matériel qui intervient, après avoir pris sous notre protection les harkis. Le guignol qui laisse échapper la lance a incendie c’est moi même, je l’ai fait volontairement. Nous étions rodé par notre passage au bled, nous connaissions tous le sort des harkis, ce Lavergne au grosses moustaches n’était qu’un bleu pour nous. Mais il a eu les honneurs du gallon de première classe du 152 RI. Pendant que ses hommes ont crevé la dalle avec des rations collectives Je garde un respect total pour le lieutenant Chevallier qui a montré un réel sang-froid lors des attaques de la ferme des 4 chemins. Mon livre " Algérie, la route vers l’inconnu" raconte notre jeunesse. Jean Dillinger
Dimanche 9 octobre 2016, par Jacques VOGELWEITH
http://www.miages-djebels.org/spip.php?article326
.
Rédigé le 30/04/2023 à 14:51 dans France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
Guy de MAUPASSANT
À Pol Arnault
La vie si courte, si longue, devient parfois insupportable. Elle se déroule, toujours pareille, avec la mort au bout. On ne peut ni l’arrêter, ni la changer, ni la comprendre. Et souvent une révolte indignée vous saisit devant l’impuissance de notre effort. Quoi que nous fassions, nous mourrons ! Quoi que nous croyions, quoi que nous pensions, quoi que nous tentions, nous mourrons. Et il semble qu’on va mourir demain sans rien connaître encore, bien que dégoûté de tout ce qu’on connaît. Alors on se sent écrasé sous le sentiment de « l’éternelle misère de tout », de l’impuissance humaine et de la monotonie des actions.
On se lève, on marche, on s’accoude à sa fenêtre. Des gens en face déjeunent, comme ils déjeunaient hier, comme ils déjeuneront demain : le père, la mère, quatre enfants. Voici trois ans, la grand-mère était encore là. Elle n’y est plus. Le père a bien changé depuis que nous sommes voisins. Il ne s’en aperçoit pas ; il semble content ; il semble heureux. Imbécile !
Ils parlent d’un mariage, puis d’un décès, puis de leur poulet qui est tendre, puis de leur bonne qui n’est pas honnête. Ils s’inquiètent de mille choses inutiles et sottes. Imbéciles !
La vue de leur appartement, qu’ils habitent depuis dix-huit ans, m’emplit de dégoût et d’indignation. C’est cela, la vie ! Quatre murs, deux portes, une fenêtre, un lit, des chaises, une table, voilà ! Prison, prison ! Tout logis qu’on habite longtemps devient prison ! Oh ! fuir, partir ! fuir les lieux connus, les hommes, les mouvements pareils aux mêmes heures, et les mêmes pensées, surtout !
Quand on est las, las à pleurer du matin au soir, las à ne plus avoir la force de se lever pour boire un verre d’eau, las des visages amis vus trop souvent et devenus irritants, des odieux et placides voisins, des choses familières et monotones, de sa maison, de sa rue, de sa bonne qui vient dire : « que désire Monsieur pour son dîner », et qui s’en va en relevant à chaque pas, d’un ignoble coup de talon, le bord effiloqué de sa jupe sale, las de son chien trop fidèle, des taches immuables des tentures, de la régularité des repas, du sommeil dans le même lit, de chaque action répétée chaque jour, las de soi-même, de sa propre voix, des choses qu’on répète sans cesse, du cercle étroit de ses idées, las de sa figure vue dans la glace, des mines qu’on fait en se rasant, en se peignant, il faut partir, entrer dans une vie nouvelle et changeante.
Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la réalité connue pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. Une gare ! un port ! un train qui siffle et crache son premier jet de vapeur ! un grand navire passant dans les jetées, lentement, mais dont le ventre halète d’impatience et qui va fuir là-bas, à l’horizon, vers des pays nouveaux ! Qui peut voir cela sans frémir d’envie, sans sentir s’éveiller dans son âme le frissonnant désir des longs voyages ?
On rêve toujours d’un pays préféré, l’un de la Suède, l’autre des Indes ; celui-ci de la Grèce et celui-là du Japon. Moi, je me sentais attiré vers l’Afrique par un impérieux besoin, par la nostalgie du Désert ignoré, comme par le pressentiment d’une passion qui va naître.
Je quittai Paris le 6 juillet 1881. Je voulais voir cette terre du soleil et du sable en plein été, sous la pesante chaleur, dans l’éblouissement furieux de la lumière. Tout le monde connaît la magnifique pièce de vers du grand poète Leconte de Lisle :![]() Midi, roi des étés, épandu sur la plaine,
Midi, roi des étés, épandu sur la plaine,![]() Tombe, en nappes d’argent, des hauteurs du ciel bleu.
Tombe, en nappes d’argent, des hauteurs du ciel bleu.![]() Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine ;
Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine ;![]() La terre est assoupie en sa robe de feu.
La terre est assoupie en sa robe de feu.
C’est le midi du désert, le midi épandu sur la mer de sable immobile et illimitée qui m’a fait quitter les bords fleuris de la Seine chantés par Mme Deshoulières, et les bains frais du matin, et l’ombre verte des bois, pour traverser les solitudes ardentes.
Une autre cause donnait en ce moment à l’Algérie un attrait particulier. L’insaisissable Bou-Amama conduisait cette campagne fantastique qui a fait dire, écrire et commettre tant de sottises. On affirmait aussi que les populations musulmanes préparaient une insurrection générale, qu’elles allaient tenter un dernier effort, et qu’aussitôt après le Ramadan la guerre éclaterait d’un seul coup par toute l’Algérie. Il devenait extrêmement curieux de voir l’Arabe à ce moment, de tenter de comprendre son âme, ce dont ne s’inquiètent guère les colonisateurs.
Flaubert disait quelquefois : « On peut se figurer le désert, les pyramides, le Sphinx, avant de les avoir vus ; mais ce qu’on ne s’imagine point, c’est la tête d’un barbier turc accroupi devant sa porte. »
Ne serait-il pas encore plus curieux de connaître ce qui se passe dans cette tête ?
Pour lire le livre au format pdf, cliquer sur le lien suivant :
https://www.miages-djebels.org/IMG/pdf/maupassant_au_soleil
https://www.miages-djebels.org/spip.php?article324
.
Rédigé le 30/04/2023 à 13:52 dans Algérie, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
Au coeur de l’hiver 1959, Joêl et René sont enlevés par un groupe de fellaghas,
alors qu’ils faisaient la classe à Agouni Hamed en Grande Kabylie.
Ils vont rejoindre d’autres prisonniers. S’en suit, à travers les forêts de Kabyle, un
chemin de croix collectif qui va durer 114 jours.
Joël mourra d’épuisement en cours de route.
Depuis, Joël est présent dans le coeur de René et guide son action.
René écrit cette lettre à Joël. Poignant et bouleversant !....
Lettre à Joel.
Tu as disparu brutalement cette nuit-là alors que nous luttions tous pour notre
survie dans cet impitoyable déchaînement des éléments. La pluie, le vent, le noir
de cette nuit d’encre s’étaient ligués contre cette misérable colonne de fuyards que
nous formions et dans laquelle prisonniers et rebelles se confondaient. Un peu
comme si la nature elle-même voulait nous empêcher de fuir devant les soldats
français nous interdire tout espoir de survie…
Nous marchions, nous courrions, nous trébuchions et nous tombions, la peur au
ventre, cette peur de ne pas pouvoir continuer pour aller au bout….
Au bout de quoi d’ailleurs ? Nos gardiens eux-mêmes ne le savaient plus, égarés
qu’ils étaient au milieu de cette forêt de l’Akfadou qui s’apprêtait à nous dévorer
tous, telle une ogresse jamais rassasiée.
Elle nous avait déjà pris Louis Marceau, en tout début de cette course avant de tuer
Jean Azzopardi écroulé dans un fossé. Puis il y a eu cet oued à traverser. Il était en
furie, gonflé par ses eaux tumultueuses et rugissantes. Mais il fallait passer coûte
que coûte…
Nous avons lutté contre ce courant qui voulait nous emporter en s’accrochant les
uns aux autres. Et nous avons réussi. Tous…Écroulés sur l’autre rive encore
vivants. Mais c’est là que Michel Champignoux nous a quittés, asphyxié par l’eau
qu’il avait avalée, paralysé par le froid. Il est mort sur le bord, sans un mot, sans
adieux…À cet instant tu étais encore des nôtres.
Et nous avons continué. Deux groupes se sont naturellement formés, les moins
atteints étaient devant, les autres peinaient à l’arrière. J’ai eu la chance d’avoir
Mokrane près de moi cette nuit-là, c’était mon ange gardien et grâce à lui je
marchais avec les premiers…
Toi, tu étais exténué et à bout depuis quelque temps déjà. Lorsque je t’avais vu
quelques heures avant cette fuite, figés au bord de l’oued, attendant le départ des
soldats français, ton regard m’avait dit que tu ne pouvais plus continuer ainsi…Mais
ton étoile brillait encore et malgré ta faiblesse tu marchais comme nous tous, avec
nous …
Et puis cette chute sur la piste, ton cœur qui combattait depuis des semaines a
cessé de lutter et a abandonné la partie…Mourir à 19 ans quelle ignominieuse
injustice…
Toi, Joel, toi le joueur d’échecs imbattable, tu venais de
perdre cette maudite partie engagée contre une nature
implacable et cruelle. J’ai pleuré ta mort, mais je t’en ai voulu
d’être parti sans prévenir. Ton gardien m’a alors dit que ton
dernier mot avait été « Maman ! »
Ah ! ta maman ! comme tu l’aimais ! et comme elle
t’adorait…
Joël Caye.
Te souviens-tu lorsque nous étions dans la cour de récréation de notre école à
Agouni Hamed ?…Cette façon que tu avais de t’arrêter soudain de me parler pour
fixer la montagne, en face, puis de me dire quelques minutes plus tard : « excusemoi, J’étais avec ma mère… ».
Ta maman qui, cette nuit là, la nuit du douze au treize mars, dans une vision
prémonitoire a entendu ton cri puisque le lendemain elle écrivait à mes parents
« sont-ils encore en vie ? »
Quand nous sommes revenus au camp, plusieurs jours après, nous n’étions plus
que quinze.
Il y avait un vide immense autour de nous. Vous étiez dix à nous avoir faussé
compagnie. Affamés, exténués, désespérés au point de presque envier votre sort
qui vous délivrait enfin de ces douleurs atroces… Nous étions devenus des morts
vivants.
Les jours et les semaines ont passé jusqu’à cet instant où le nouveau chef de la
wilaya III, Mira est venu, accompagné du docteur Benabid nous annoncer que la fin
du cauchemar était proche…Nous allions être libérés !
Lorsque plus tard j’ai retrouvé ma famille, ma mère, mon père, mon frère, mes
amis, j’ai su que le bonheur extrême qui inondait leur cœur ne serait jamais partagé
avec les tiens qui pleuraient ton absence.
Conscients de l’indicible douleur qui les épargnait, mes parents m’engagèrent alors
à aller voir ta maman et ton papa ainsi que ta petite sœur Sylviane.
Je dois t’avouer, cher Joël, que j’ai hésité un temps avant de me décider et de partir
pour Baccarat. Mais les lettres de ta mère me convainquirent et à la mi-août je
rencontrais ta famille. Deux jours, pendant lesquels j’ai pu raconter notre vie
d’avant l’enlèvement et notre séjour forcé en Akfadou.
Ils voulaient tout savoir : comment c’était arrivé, comment nous étions traités, la
description du camp et de notre prison, nos compagnons, nos gardiens,notre
mental et notre forme physique, la nourriture et tout ce qui occupait notre quotidien
d’otages. Mais surtout comment, en cette maudite nuit du au treize mars tu étais
tombé, à bout de force…Pour ne plus repartir…Toi, jeune garçon français,
volontaire pour participer à ce vaste programme de scolarisation des enfants
d’Algérie, tu venais de mourir pour ton pays, la France…
Je sais que tu aurais fait pour mes parents ce que j’ai fait pour les tiens, mais mon
Dieu, que ce fut douloureux, pour eux d’entendre ce récit et pour moi de le narrer,
conscient du mal qui les détruisait au fur et à mesure que je parlais. Mais il fallait le
faire et, heureux rescapé de l’enfer, je savais que ce devoir qui m’était imposé
devenait peu à peu comme un acte d’affection et d’amour envers cette famille
éplorée.
A plusieurs reprises ta maman m’a pris dans ses bras, un peu comme si c’était toi
qu’elle serrait. C’est là, Joel, dans ces instants de tendresses que j’ai senti que je
devenais un peu leur fils, et donc un peu ton frère. Cette amitié qui nous liait, née
dans notre petite école d’Agouni-Hamed et fortifiée par les épreuves que nous
avons subies devenait d’un seul coup de la fraternité…
Quand, un jour de décembre 1959, ta petite sœur, notre petite sœur devrais je dire,
m’a annoncé le décès de votre maman, je n’ai pas pleuré. Madame Caye devait
être la plus heureuse des mamans puisqu’elle te rejoignait dans ce qui allait devenir
votre éternité…De même pour ton papa qui vous a retrouvés deux ans plus tard.
Cette culpabilité de t’avoir laissé partir en Algérie qui le poursuivait sans cesse
l’avait anéanti et finalement terrassé. Tout comme mon père qui est mort presque à
la même date avec les mêmes sentiments d’injustice et d’incompréhension pour
ces malheurs qui s’étaient abattus sur eux.
Puis le temps a passé. J’ai peu à peu enfoui ces souvenirs au fond de ma mémoire
et oublié notre sinistre aventure.
Ta petite sœur, devenue orpheline n’a pas eu l’adolescence épanouie qu’elle
méritait…Elle a grandi seule sans soutien familial pour affronter une vie remplie
d’embûches et sans concession.
Dans le témoignage qu’elle m’a envoyé, elle raconte comment, trente ans plus tard,
nos chemins se sont à nouveau croisés. Et tu n’es pas étranger à ces retrouvailles
puisqu’à la radio où j’intervenais pour soutenir les familles de personnes retenues
en otages au Liban, je parlais de toi…
Depuis, le contact avec Sylviane est rétabli et même si on ne se voit pas souvent,
nous le gardons précieusement.
Puis il y a eu cette conférence donnée en Lozère par un ami qui racontait notre
histoire, notre captivité et tout ce qui en découla….Puis mon livre, et un deuxième
accompagné de conférences pour raconter, témoigner, et montrer enfin combien
les guerres sont cruelles et injustes pour ceux qui les subissent.
Depuis le début de mon engagement pour le « devoir de mémoire », j’ai senti que
je n’étais pas seul, que l’inspiration de mes textes avait une origine : Toi. ! Oui, je
suis certain que c’est toi qui a mis dans mon cerveau cette notion de « ni haine ni
rancune, pardon et souvenir » que j’ai appliquée dans mon bouquin et dans mes
conférences parce que cela correspond à ta mentalité, toi le non-violent, le pacifiste
utopiste et généreux…
Au début je me demandais comment allait être accueillie cette philosophie. On
m’aurait certainement pardonné de me laisser aller à du ressentiment…Mais ton
message, notre message est bien passé. Sais-tu qu’à ce jour personne ne m’a
encore blâmé pour mon esprit de mansuétude ! Au contraire. Remarque, l’idée
venant de toi et placé comme tu l’es là-haut, rien de mauvais ou de négatif ne peut
arriver, car notre témoignage ne peut pas être galvaudé.
Cette idée de témoigner pour la vérité, la tolérance et la réconciliation a permis des
rencontres hors de l’ordinaire. Voir les fils du commandant Mira et faire en sorte
que l’un d’eux, Tarik, député de Béjaia, accepte de participer à ma démarche et
m’envoie son témoignage est à mon avis un signe fort encourageant pour l’avenir.
Merci Joel pour ton aide. De là-haut et de la place que tu occupes entre tes parents
et les miens, continue à nous inspirer.
Et si au détour d’un nuage tu rencontres Mokrane, Mira et le docteur Benabid,
salue-les de ma part…Après tout si je peux t’écrire aujourd’hui c’est bien un peu
grâce à eux !
Allez, adieu Joel, adieu mon frère et à « Quand le Bon Dieu voudra » !
http://www.miages-djebels.org/IMG/pdf/Lettre_a_Joel.pdf
.
Rédigé le 30/04/2023 à 12:26 dans Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
Aujourd’hui nous revenons, dans le cadre des commémorations des massacres de Sétif, Guelma, et Kherrata, sur le regard de deux grands auteurs de la littérature contemporaine des deux côtés de la Méditerranée : Kateb Yacine et Albert Camus. Le premier a alors 16 ans au moment de cet événement déterminant dans sa vie et sa production littéraire ; le second a 32 ans et est déjà un intellectuel engagé reconnu. Les auteurs choisissent deux prismes différents, l’un le roman pour sa catharsis, l’autre la presse pour dénoncer l’urgence de la situation, pour évoquer ce que le 8 mai 1945 fait à l’Algérie.
Kateb Yacine et le 8 mai 1945 : la promesse de liberté
Grosso modo, c’était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis. C’était un grand événement, c’était la fête, on entendait sonner les cloches puis tout de suite la rumeur s’est répandue que le lendemain on serait libre. C’était un jour de liberté. Donc, le 8 mai au matin, il y avait une manifestation officielle, prévue au centre de la ville, et il y avait une manifestation populaire. C’était un jour de grande espérance dans un sens, pour les Algériens. À Sétif, c’était jour de marché, c’était un mardi, et il y avait une foule énorme.
Kateb Yacine décrit ce qui devait être en Algérie et en France, un jour de fête. Les Alliés l’avaient emporté sur les nazis, et la France avait promis aux Algériens, aux Indigènes, plus de droits. Ainsi, le 8 mai 1945 était un jour parfait pour parader dans la rue au nom de la liberté. Cependant, il n’en est rien. Kateb Yacine n’a alors que 16 ans lorsqu’il se joint avec ses amis au cortège. Étudiants, militants et scouts paradent fièrement pour célébrer la victoire de la liberté, mais aussi pour réclamer leurs droits. Soudain, la panique envahit la rue. La population déferle, la foule inonde l’espace dans un brouhaha incessant, fuyant de toute part. L’incompréhension habite les jeunes gens : que se passe-t-il ? Le doute laisse place aux rumeurs : les Turcs débarquent à Bougie, ou encore enfin ! L’Algérie s’est libérée ! La fièvre les habite tous. Le réflexe de l’enfant est alors immédiat : rentrer chez lui. En prenant le car, ce sont des scènes atroces qui s’exposent au regard du jeune adolescent.
Le 8 mai 1945 devient le jour des promesses non tenues.
Les automitrailleuses, les automitrailleuses, les automitrailleuses, y en a qui tombent et d’autres qui courent parmi les arbres, y a pas de montagne, pas de stratégie, on aurait pu couper les fils téléphoniques, mais ils ont la radio et des armes américaines toutes neuves. Les gendarmes ont sorti leur side-car, je ne vois plus personne autour de moi.
Ce jour-là, ce n’est pas un collier de fleurs que reçoit le peuple algérien, mais un collier de balles. Le massacre est violent, les cadavres jonchent le sol, des scènes de viol prennent place dans cette pièce de théâtre inimaginable. Sétif se transforme en ville fantôme.
Ici sont étendus dans l’ombre des cadavres que la police ne veut pas voir ; mais l’ombre s’est mise en marche sous l’unique lueur du jour, et le tas de cadavres demeure en vie, parcouru par une ultime vague de sang, comme un dragon foudroyé rassemblant ses forces à l’heure de l’agonie, ne sachant plus si le feu s’attarde sur sa dépouille entière ou sur une seule des écailles à vif dont s’illumine son antre ; ici est la rue de Nedjma mon étoile, la seule artère où je veux rendre l’âme ; C’est une rue toujours crépusculaire, dont les maisons perdent leur blancheur comme du sang, avec une violence d’atomes au bord de l’explosion.
La rue, témoignant de l’horreur absolue, se transforme alors en un espace anthropomorphe. Kateb Yacine, à son retour, est arrêté par la police. Il est emprisonné au camp militaire de Sétif – devenu bagne de Lambèse dans son roman Nedjma – torturé et menacé d’exécution. Sa mère devient folle. Dans ses romans cette figure maternelle devient le catalyseur d’un univers hanté par les massacres et les traumatismes qui viennent à la fois nourrir la révolte mais incitent à l’oubli. La ville, marquée de manière indélébile par l’inimaginable, est le théâtre de l’histoire malgré cet oubli forcé.
Cependant, la ville porte en elle l’espoir, articulant en son sein une réalité oxymorique : vie et mort se conjuguent pour annoncer un lendemain meilleur, celui de l’indépendance. Le flambeau de la révolte, l’espoir, est sans cesse transmis. Dans Les ancêtres redoublent de férocité/Nedjma, lorsque Lakhdar meurt, c’est Ali qui poursuit le combat. Malgré l’atrocité des événements, Kateb Yacine veut écrire une tragédie optimiste en 1956. Il croit en l’indépendance.
C’est la terreur coloniale que donne à lire Kateb Yacine dans ses travaux. Une terreur qui cependant ne saurait arrêter le peuple algérien en marche vers la liberté.
N’y a-t-il que le crime pour assassiner l’injustice ? Ici est la rue des Vandales, des fantômes, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées ; ici est notre rue. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère en crue où je puisse rendre l’âme sans la perdre. C’est un canon qu’il faut désormais pour m’abattre. Si le canon m’abat, je serai encore là, lueur d’astre glorifiant les ruines, et nulle fusée n’atteindra plus mon foyer à moins qu’un enfant précoce ne quitte la pesanteur terrestre pour s’évaporer avec moi dans un parfum d’étoile, en un cortège intime où la mort n’est qu’un jeu. Sétif, mon étoile, morte sans l’être au demeurant, vivante, corps interdit aux canons, Sétif, c’est l’étoile muée en canon futur…
Kateb Yacine dira alors que cette boucherie a donné naissance à son nationalisme.
Les textes tirés de cette partie proviennent essentiellement de Nedjma (1956) et de la pièce Le cadavre encerclé (1959). Partie essentiellement tirée de l’article d’Ahmed Chenikii sur le blog Mediapart.
Albert Camus et le 8 mai 1945 : un problème de justice
Les médias français ne font aucune mention de l’autre 8 mai 1945. La censure militaire est féroce : ces derniers ne sont autorisés à couvrir l’événement qu’à partir du 12 mai. La tragédie est ignorée ou au pire encensée, reprochant aux nationalistes comme Ferhat Abbas de nourrir le complot antifrançais. Seuls L’Humanité et Combat dénoncent ce qu’il se passe au-delà de la Méditerranée en publiant une série d’articles, du 15 au 30 mai, issus d’une enquête de terrain réalisée par Albert Camus.
Dans une série de cinq articles (« Crise en Algérie », « La famine en Algérie », « Des bateaux et de la justice », « Le Malaise politique », « Du Parti du Manifeste ». Aujourd’hui, l’ensemble de ces textes sont publiés sous le titre de Actuelles III. Chroniques algériennes, 1939-1958), Camus nous livre une analyse détaillée, mais surtout accessible à un large public, de ses observations. L’écrivain est catégorique : « le peuple arabe existe ». Il reconnaît son identité propre, sa culture, son histoire, affirmant que l’Algérie était un pays avant de tomber sous le joug colonial. Loin d’être un simple incident, ce dernier dénonce alors les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata comme une crise algérienne qui interroge directement les fondements du système colonial, menant aux événements du 8 mai 1945.
Tout d’abord, elle se veut selon lui d’ordre économique et social, la population dite indigène vivant dans une misère absolue. Il écrit : « ce peuple n’est pas inférieur sinon par la condition de vie où il se trouve ».
Mais c’est avant tout une crise juridique : le peuple réclame ses droits. Il demande que le gouvernement exporte en Algérie « le régime démocratique dont jouissent les Français », si ce dernier souhaite maintenir sa présence. Il poursuit: « C’est la force infinie de la justice, et elle seule, qui doit nous aider à reconquérir l’Algérie et ses habitants. ». Le gouvernement français ignorera totalement les recommandations de l’écrivain, sonnant ainsi le glas de son Empire. La question de la justice est alors centrale dans la question de la colonisation et de la Guerre d’Algérie, Albert Camus en a conscience. Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de se pencher sur cet aspect occulté par les accords d’amnistie.
En 2005, la France reconnaissait pour la première fois les atrocités commises lors de ces massacres. Aujourd’hui, ce dont la France a besoin, c’est une dénonciation de ces derniers comme crimes d’État, étant directement orchestrés par le corps militaire français.
Par Maïssa
Publié le 8 mai 2022
https://recitsdalgerie.com/ecrire-les-massacres-de-setif-guelma-kherrata/
Les massacres de mai 1945 ont fait des dizaines de milliers de morts du côté des manifestants algériens sortis exprimer leur joie pensant que les autorités coloniales allaient tenir la promesse de leur octroyer l'indépendance. Ce texte donne à lire comment Kateb Yacine a évoqué ces massacres dans son œuvre. Lui-même, il avait été arrêté, il avait 16 ans, sa mère était devenue folle. Une
Ça a été un massacre, un véritable massacre, qui n’a pas manqué de laisser des traces, d’autant plus que pour moi j’ai été touché dans ces deux villes. Ça s’est produit… j’étais jeune, j’avais 15 ans, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais enfin, bon… Grosso modo, c’était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis. C’était un grand événement, c’était la fête, on entendait sonner les cloches puis tout de suite la rumeur s’est répandue que le lendemain on serait libre. C’était un jour de liberté. Donc, le 8 mai au matin, il y avait une manifestation officielle, prévue au centre de la ville, et il y avait une manifestation populaire. C’était un jour de grande espérance dans un sens, pour les Algériens.
À Sétif, c’était jour de marché, c’était un mardi, et il y avait une foule énorme. Moi, j’ai vu venir le cortège. Au début, il y avait les scouts puis après des étudiants, des militants, et j’ai reconnu parmi eux des copains de classe. Ils m’ont fait signe et je me suis joint au cortège sans trop savoir ce que cela signifiait et puis tout de suite ça a été les coups de feu. Coups de feu, la panique, parce que cette foule énorme qui reflue, j’ai vu une petite fille qui a été écrasée devant moi, c’était vraiment terrible. Parce qu’il y a eu vraiment la panique parce que les gens voulaient se sauver dans tous les sens. Puis, bon, il fallait que je rentre chez moi parce que j’habitais dans un village à 45 kilomètres de là. Je suis monté à l’avant du car et j’ai vu alors à ce moment-là des choses terribles parce que le peuple venait de toutes parts. J’ai vu cela vraiment comme une fourmilière. La terre devenait une véritable fourmilière, vraiment je me demandais d’où venaient tous ces gens comment j’avais pu ne pas le voir avant ! On avait l’impression qu’ils sortaient de la terre, c’était de toutes parts, ça grouillait de partout. Et puis, il y avait des rumeurs folles. Je ne sais pas, certains disaient que les Turcs avaient débarqué à Bougie, je ne sais pas moi, d’autres disaient : ça y est, toute l’Algérie s’était libérée. On racontait des tas d’histoire. Et puis il y avait une grande fièvre naturellement parce qu’on sentait qu’il s’était passé quelque chose quoi. L’arrivée au village, ça a été encore plus dur parce que c’est là qu’a commencé la répression. Dans ce village on a amené les Sénégalais. Bon, ça, c’est une vieille pratique d’utiliser les uns contre les autres. Il y a eu des scènes de viols, il y a eu encore des massacres. On voyait les corps allongés dans les rues. Puis, au retour, j’ai été arrêté. Parce qu’en débarquant du car, naturellement : « qu’est-ce qui s’est passé, etc. ? » Moi, j’ai fait un récit épique de ce qui venait de se passer : le peuple sans armes, avec des cannes de paysans a réussi… J’ai fait un récit révolutionnaire de ce qui venait de se passer. Après, on m’a reproché ça.
Kateb Yacine était encore enfant, il rêvait de choses, de belles choses, malgré la cruauté de la colonisation. Il n’avait que 16 ans, ce jeune garçon qui gribouillait des poèmes, avec le sourire qui va par la suite, après ce massacre, s’obscurcir. Le 8 mai1945 devait être une journée importante, c’est-à-dire celle d’une promesse non tenue. Au lieu de l’indépendance, ce furent des balles qui trouèrent des corps à jamais marqués du sceau des horreurs coloniales. C’est aussi le début d’une vraie prise de conscience.
Parler de ce que certains historiens ont appelé avec une grande légèreté les « événements » de mai 1945, c’est convoquer obligatoirement une ville, Sétif, des lieux de mémoire, des éléments d’Histoire et des blessures. C’est évoquer inévitablement le plus grand écrivain nord-africain, Kateb Yacine, c’est aussi revisiter les massacres de 1945, la folie, l’horreur et la rupture définitive avec le colonialisme. Comment justement cette ville de Sétif, les graves événements de mai 1945 travaillent l’œuvre de Kateb Yacine et aussi sa vie ? Sa propre mémoire, c’est-à-dire celle de son « peuple », s’égare-t-elle définitivement ou apparait-elle comme un système de signes latents dans les espaces interstitiels de l’écriture ?
L’auteur n’a jamais réussi à se détacher de cette période qui a fondamentalement marqué l’auteur, son œuvre et l’Histoire de l’Algérie. Que s’est-il passé lors de ces événements de mai 1945 ? Les nationalistes algériens pensaient que cette journée de célébration de la libération allait-être un jour-lumière qui allait voir le colonialisme français tenir sa promesse d’accorder leur indépendance aux Algériens. Dans ce défilé pacifique, les drapeaux alliés étaient déployés, avec des revendications nationalistes et indépendantistes. Vite, le drame survint, des milliers de morts, Sétif allait connaître le jour le plus sombre de son Histoire. L’état de siège est instauré. L’armée, la police, la gendarmerie et des milices de colons organisées sillonnent les quartiers arabes. La loi martiale est proclamée, et des armes sont distribuées aux Européens. La répression sera terrible. La presse française soutenait la répression, à l’exception de l’Humanité (du 15 au 30 mai) et de Combat (du 13 au 23 mai) qui a publié une série d’articles d’Albert Camus qui dénonçait cette chasse à l’homme appelant le pouvoir en place à appliquer aux Algériens « le régime démocratique dont jouissent les Français ». Camus ne pouvait accepter ce type de situations. C’est l’homme révolté qui a fréquenté les couloirs du même journal que Kateb Yacine, Alger Républicain.
Ici sont étendus dans l’ombre des cadavres que la police ne veut pas voir ; mais l’ombre s’est mise en marche sous l’unique lueur du jour, et le tas de cadavres demeure en vie, parcouru par une ultime vague de sang, comme un dragon foudroyé rassemblant ses forces à l’heure de l’agonie, ne sachant plus si le feu s’attarde sur sa dépouille entière ou sur une seule des écailles à vif dont s’illumine son antre ; ici est la rue de Nedjma mon étoile, la seule artère où je veux rendre l’âme ; C’est une rue toujours crépusculaire, dont les maisons perdent leur blancheur comme du sang, avec une violence d’atomes au bord de l’explosion.
Kateb Yacine, alors collégien de 16 ans, participait aux manifestations. Il fut emprisonné au camp militaire de Sétif - devenu bagne de Lambèse dans son roman, Nedjma - torturé et menacé d’exécution. Libéré, Kateb n’oubliera jamais ces moments terribles qu’il a vécus en compagnie de la multitude. Les traces sont indélébiles, sa mère devient folle. Ce n’est pas sans raison que la folie et l’image de la mère vont marquer tragiquement l’œuvre de l’auteur. Il s’en souvient : « Je suis né d’une mère folle. Très géniale, elle était généreuse, simple et des perles coulaient de ses lèvres. Je les ai recueillies sans savoir leur valeur. Après les massacres de 1945, je l’ai vue devenir folle. Elle est la source de tout. ».
La mère investit le territoire tragique d’un univers hanté par le souvenir de massacres et de traumatismes qui, paradoxalement, incitent à l’oubli, mais aussi à la révolte. Dans Nedjma, cette mère qui sombre dans la folie à Sétif, au bruit et aux rumeurs du massacre du 8 mai 1945 tissera une sorte de « camisole du silence », « ne sait plus parler sans se déchirer le visage » tout en n’arrêtant pas de psalmodier la prière des morts et de maudire ses enfants.
Nous sommes morts, exterminés à l’insu de la ville…Une vieille femme suivie de ses marmots nous a vus la première. Elle a peut-être ameuté les quelques hommes valides qui se sont répandus à travers nous, armés de pioches et de bâtons pour nous enterrer par la force.
Dans tous ses textes ( Nedjma, le poème ou le couteau, Nedjma, Le cercle des représailles, Le bourgeois sans culotte ou le spectre du parc Monceau), Sétif associé aux événements tragiques de mai 1945 allaient investir le récit, orientant fondamentalement son discours. Sétif est un lieu d’une mémoire tragique marquée par les jeux de l’oubli que seule peut-être la littérature, selon Kateb Yacine, pourrait libérer. La ville porte et produit l’histoire dans tous les sens du terme, structure les textes, devient Texte. Elle a connu l’inimaginable. La fiction est incapable de saisir le réel.
Les événements de 1945 se drapent des malheurs d’une cité blessée, drapeau du sceau d’une mère jamais consolée. Le cadavre encerclé, texte paru en 1959 aux éditions du Seuil, met en scène des femmes en quête de traces, de souvenirs et d’une mémoire décidément absente, ce qui les incite à ne plus reconnaitre leurs enfants. L’exposition de la pièce donne à lire le lieu où s’était déroulée la manifestation, Sétif qui exhibe ses rues se muant en corps atrocement mutilés, structuré en un cercle de représailles où les corps sont enfermés dans un espace, certes, encerclé, mais ouvert à une grande espérance. L’histoire, le passé viennent à la rescousse d’une mémoire vacillante, oublieuse. L’oubli est parfois volontaire. Aujourd’hui, ces « événements » restent marqués par une sorte d’oubli forcé des deux côtés de la méditerranée.
Ainsi, sont convoqués les ancêtres, les origines qui sont impuissants devant l’ignominie d’une mort annoncée. Les champs lexicaux de la violence caractérisent le discours théâtral et romanesque. Le sang, les geôles, la mort rodent dans cette ville de Sétif sauvée peut-être par la voix des femmes, Marguerite et Nedjma. C’est une impasse qui dessine les contours scénographiques d’une tragédie structurée en une sorte de cercle paradoxalement ouvert. Ainsi s’ouvre le texte : « Ah ! l’espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la rue des mendiants et des éclopés, pour entendre les appels des vierges somnambules, suivre des cercueils d’enfants, et recevoir dans la musique des maisons closes le bref murmure des agitateurs. Ici je suis né, ici je rampe encore pour apprendre à me tenir debout, avec la même blessure ombilicale qu’il n’est plus temps de recoudre ; et je retourne à la sanglante source, à notre mère incorruptible (…). Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue ».
La mémoire est vive, toujours béante, drapée du sceau de la « blessure ombilicale » et ravivée par les bruissements incessants d’une mère-source et d’une rue qui porte et produit l’Histoire, Matière paradoxalement en mouvement, le corps se fond dans la rue qui devient l’élément central du récit. C’est dans la rue qu’il découvre cadavres et blessés et c’est là qu’il est arrêté. Dès la didascalie, l’auteur annonce la couleur, il donne à lire la terreur coloniale et les différentes menées répressives, à partir de l’exposition de corps sans vie, jetés dans la rue. Cette ouverture inaugure le protocole de lecture et expose les différents lieux-mémoires d’une ville meurtrie par la répression et la guerre.
Le prologue de la pièce, Le cadavre encerclé, esquisse dès le début les lieux emblématiques de la ville blessée, meurtrie, la mettant en rapport avec d’autres espaces historiques et géographiques : « l’impasse natale », la « rue des Vandales », mais donnant à lire ce grand traumatisme marqué par la mort et l’errance qui investissent une rue où gisent morts et blessés, mais qui s’identifie aux gens de ce pays qui célébraient innocemment la fin de la guerre. La mort enfante la vie et annonce l’insurrection future, la rue renforce ce sentiment d’éternité. Quand le personnage, Lakhdar, meurt, c’est son fils qui prend la relève : « Je suis plus un corps, mais je suis une rue. C’est un canon qu’il faut désormais pour m’abattre. Si le canon m’abat je serai encore là, lueur d’astre glorifiant les ruines, et nulle fusée n’atteindra plus mon foyer à moins qu’un enfant précoce ne quitte la pesanteur terrestre pour s’évaporer avec moi dans un parfum d’étoile, en un cortège intime où la mort n’est qu’un jeu… ».
La rue se mue en lieu de mémoire qui témoigne, certes, des horreurs du massacre, se transforme en un espace anthropomorphe, prenant parti pour les militants. Rue, corps, mémoire, mère, tout porte les résidus de scènes vécues par l’écrivain lui-même qui n’a jamais arrêté de témoigner de ce massacre. Le corps connait une transposition symbolique, s’assimilant et se confondant avec la rue, devenant le lieu essentiel d’un ensemble oxymorique, mort-vie qui caractérise le discours de l’auteur marqué par la désillusion d’un jour-fête transformé en jour-deuil-résurrection. Le corps-barricade, le corps-multitude se meut en rue d’une ville mutilée, mais devenant, par la force du drame, un espace ouvert. La violence du ton traverse le discours romanesque et met à nu la violence de la répression dans Nedjma.
Les automitrailleuses, les automitrailleuses, les automitrailleuses, y en a qui tombent et d’autres qui courent parmi les arbres, y a pas de montagne, pas de stratégie, on aurait pu couper les fils téléphoniques, mais ils ont la radio et des armes américaines toutes neuves. Les gendarmes ont sorti leur side-car, je ne vois plus personne autour de moi.
Dans les déclarations de Kateb Yacine, des images reviennent souvent : la folie de la mère, la rue où gisent des blessés et des morts, l’espoir d’une indépendance possible après la fin de la guerre. Ces thèmes travaillent profondément tous les textes de l’auteur : « On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues… La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. (…) Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. ».
La ville est porteuse d’espoir, elle est le lieu d’articulation de réalités apparemment contraires, mort et vie, mais qui fusionnent pour conjuguer l’espoir et annoncer des lendemains de libération. La ville devient un acteur fondamental dans la détermination des instances discursives et du mouvement narratif. Elle est anthropomorphe, elle apporte une certaine protection aux personnages. Mais il suffit d’un moment d’inattention de la ville faite actrice pour se retrouver dans une situation de victime : « Nous sommes morts, exterminés à l’insu de la ville ».
Tous les textes de Kateb Yacine décrivent la tragédie de l’Algérie durant la colonisation. Le Cercle des Représailles, publié en 1959, qui est une sorte de suite tétralogique, se compose de trois pièces et un poème dramatique. La première, intitulée Le Cadavre encerclé, une tragédie en trois actes, raconte le drame des événements de mai 1945. Dans la rue des Vandales (titre initial du texte), cadavres et blessés sont par terre ; Lakhdar et Mustapha, éternels amants d’une insaisissable Nedjma, se trouvent parmi les révoltés. Blessé, Lakhdar est sauvé par la fille du commandant, Marguerite qui n’arrive pas à se faire admettre par le groupe d’amis. Mais quelque temps après, Tahar le poignarde et laisse son cadavre au milieu d’un polygone tragique, l’Algérie, une nation qui « n’a pas fini de venir au monde ». Les ancêtres redoublent de férocité, de veine tragique, met en situation deux personnages, Hassan et Mustapha à la quête du chemin du Ravin de la Femme Sauvage, lieu mythique où se trouve Nedjma, hantée par le vautour incarnant Lakhdar. Mustapha et Hassan réussissent à délivrer la Femme Sauvage, enlevée par un ancien soldat de l’Armée Royale marocaine. Hassan meurt, Mustapha est arrêté par l’armée ennemie.
Cet ensemble dramatique puisé dans l’Histoire de l’époque avec ses contradictions et ses ambiguïtés, caractérisé par la présence de traits lyriques et l’utilisation d’une langue simple, ne s’arrête pas uniquement à la dimension politique, mais la dépasse et interroge l’être algérien déchiré, mutilé tout en le mettant en rapport avec d’autres espaces, donnant naissance à un texte tiers, mettant ainsi en pièces la logique binaire, une sorte de « supplément d’origine » pour reprendre Jacques Derrida.
L’identité devient l’otage des configurations historiques, c’est ce que tente d’expliquer d’ailleurs Edward Said dans son texte consacré à la lecture du parcours de Camus, « Un homme moral dans un monde immoral ». Elle est variable, mais aucunement réductible aux espaces mythiques essentialistes. C’est une sorte d’identité-rhizome qui n’exclut nullement la singularité de l’appropriation de la violence en période d’oppression. Dans L’homme aux sandales de caoutchouc, paru en 1972, Sétif se trouve jumelé avec Hanoï, puis, par la suite, dans son dernier texte, Le sans-culotte ou le spectre du parc Monceau, paru en 1989, une commande du ministère français de la culture, les rues de Sétif retrouvent le Paris de 1789 et de 1871, avec ses cadavres, ses mutilés, ses éclopés, ses exilés et des femmes-symboles, Nedjma dialoguant avec Louise Michel.
Sétif subit de sérieuses transfigurations, devenant le lieu de cristallisation d’un espace porteur et producteur d’une Histoire qui le lie à d’autres villes et d’autres événements emblématiques, Hanoï, Paris, Palestine…Cette démultiplication spatiale et temporelle s’inscrit en droite ligne dans la perspective politique et artistique de l’auteur qui considère que toutes les révolutions ont des points de rencontre et concourent au même objectif.
La structure circulaire, en spirale, la fragmentation du récit, la scénographie et les jeux de situation ne sont pas étrangers aux manifestations politiques et aux actions répressives de mai 1945 à Sétif, donnant à voir plusieurs univers structuraux et de nombreuses instances spatiotemporelles, engendrant une unité discursive disséminée, c’est-à-dire cultivant une certaine méfiance. Sétif, 1945 se voient ainsi dans ses textes démultipliés, s’identifiant à d’autres espaces, provoquant un processus de transmutation spatio-temporelle. Le temps épouse les contours d’objectifs politiques et idéologiques, dépassant l’événementiel et mettant en œuvre une entreprise transfrontalière.
La géographie représentée par les blessures de la ville convoque l’Histoire, se muant en mythe libérateur investi d’historicité, devenant le lieu d’articulation de métaphores obsédantes, pour reprendre la belle formule de Charles Mauron. Le lieu de mémoire fonctionne ainsi comme une thérapie contre l’oubli. La mémoire, lieu de latence, grâce à la médiation de l’écriture, se transforme en un espace d’ouverture, enfantant d’autres territoires et porteur d’insurrections futures, le 1 novembre 1954. Sétif se démultiplie et déplace la quête dans d’autres territoires jumeaux. Ce processus de reterritorialisation et de démultiplication des lieux s’inscrire dans le discours internationaliste de l’auteur.
La tragédie est, chez Kateb Yacine, paradoxalement vouée à l’optimisme ; la mort donne naissance à la vie. Ainsi, quand le personnage central, Lakhdar meurt, c’est Ali qui poursuit le combat. Nous avons affaire à une tragédie optimiste qui associe la dimension épique au niveau de l’agencement dramatique et de l’instance discursive. Le « je » singulier (relation amoureuse de Lakhdar et de Nedjma par exemple) alterne avec le « nous » collectif (inscription du personnage dans le combat collectif) prisonnier des blessures béantes d’une ville-mémoire. La mort n’est pas marquée du sceau de la négativité, elle arrive à créer les conditions d’un sursaut et d’un combat à poursuivre. Mai 1945 constitue selon les historiens et Kateb Yacine le prélude à l’insurrection de 1954. Lakhdar, parmi les victimes, est le lieu d’articulation de plusieurs temps (passé, présent et futur virtuel), il prophétise l’à-venir. Ses paroles prémonitoires sont le produit de son combat. Le chœur prend en charge le discours du peuple et s’insurge contre les sournoises rumeurs de la ville : « Non, ne mourrons pas encore, pas cette fois ».
L’histoire de Sétif et de mai 1945 s’inscrit comme élément de lecture d’une réalité précise, d’un vécu algérien ambigu, piégé par ses propres contradictions. Ce n’est ni le passé, ni le présent qui sont surtout valorisés mais le futur, lieu de la quête existentielle et politique de l’Algérie incarnée par Nedjma ou la Femme Sauvage, ce personnage écartelé entre deux voies différentes, sinon opposées. Le paradigme féminin, noyau central des textes de Kateb Yacine, fonctionne comme un espace ambigu, mythique. Nedjma, étoile insaisissable autour de laquelle tourne tous les protagonistes masculins, incarnerait l’Algérie meurtrie, terre à récupérer, témoin des différents massacres visant ses compagnons. Elle se confond avec la ville.
Dans Le Cadavre encerclé et Les Ancêtres redoublent de férocité, l’histoire, espace réel côtoie la légende, lieu du mythe. Histoire et histoire s’entrechoquent et s’entremêlent. Le discours sur la nation suppose une diversité et une multiplicité des réseaux spatio-temporels, convoquant tantôt Sétif, mais aussi d’autres lieux emblématiques des luttes révolutionnaires dans le monde. Le temps historique, paysage des référents existentiels (Commune de Paris de 1871, Octobre 1917, mai 1945, Vietnam, Palestine, guerre de libération…), localisé dans des lieux clos (prison…) ou dans la ville laisse place au temps mythique, instance occupée sur le plan géographique par la campagne, le désert ou le ravin de la Femme Sauvage. Le déplacement de l’histoire à la légende se fait surtout par le retour à la tribu, source du vécu populaire et territoire-refuge de tous les personnages qui reviennent à cet espace afin de retrouver leur force. Le jeu avec le temps et l’espace, un des éléments essentiels de la dramaturgie en tableaux, est lié à la quête de la nation encore perturbée et insaisissable. La légende, lieu d’affirmation- interrogation de l’histoire, investit l’univers dramatique de Kateb Yacine.
Les tenants du discours postcolonial qui reprennent parfois des idées de Frantz Fanon et d’Edward Said qui, malgré le magistral démontage du fonctionnement du discours colonial, tombent parfois dans le travers qu’ils dénoncent en rejetant l’ « Occident » dans sa totalité, privilégiant les jeux trop peu clairs de la géographie dans la définition des rapports entre un « Tiers-monde » censé être pur et un « Occident » corrompu et violent. Comme l’a fait Sartre dans sa préface à l’Anthologie de la poésie nègre et malgache, Orphée noir, célébrant une poésie noire, la seule révolutionnaire, selon lui. Comme d’ailleurs Homi Bhabha qui, dans sa proposition de mettre en œuvre l’idée d’hybridité en lui donnant le sens de « coexistence consensuelle des différences », semble oublier que l’hybridité caractérise tout discours social et littéraire. Bhabha semble oublier les pratiques du colonisateur et met sur une ligne horizontale colonisateur/colonisé. Pour Kateb Yacine, Sétif est en accord avec les populations exploitées, colonisées, partout dans le monde.
N'y a-t-il que le crime pour assassiner l’injustice ? Ici est la rue des Vandales, des fantômes, d. e la marmaille circoncise et des nouvelles mariées ; ici est notre rue. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère en crue où je puisse rendre l’âme sans la perdre. C’est un canon qu’il faut désormais pour m’abattre. Si le canon m’abat, je serai encore là, lueur d’astre glorifiant les ruines, et nulle fusée n’atteindra plus mon foyer à moins qu’un enfant précoce ne quitte la pesanteur terrestre pour s’évaporer avec moi dans un parfum d’étoile, en un cortège intime où la mort n’est qu’un jeu. Sétif, mon étoile, morte sans l’être au demeurant, vivante, corps interdit aux canons, Sétif, c’est l’étoile muée en canon futur…
P.S : Les passages en italique sont tirés de la pièce, Le cadavre encerclé (Le Seuil, 1959) et du roman, Nedjma (Le Seuil, 1956)
Ahmed Chenikii
30 JUIL. 2020
https://blogs.mediapart.fr/ahmed-chenikii/blog/300720/setif-ville-blessee-massacree-un-8-mai-1945-racontee-par-l-ecrivain-kateb-yacine
.
Rédigé le 30/04/2023 à 07:34 dans colonisation, France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
“Nous étions les dindons de la farce d’un conflit politique“. Louis Defranchi fait partie de cette génération d’hommes qui, il y a soixante ans, a été appelée pour combattre en Algérie. Il en fait le récit dans l’article.
Illustration par Alexis N.
Un accent du Sud, des réponses enthousiasmées et drôles, c’est avec beaucoup de recul et de pudeur que Louis me parle d’une période de sa vie : 1960-1962.
Recul, car c’est en voulant tirer une leçon du passé que Louis accepte de livrer son récit. Pudeur, car je comprends vite qu’il n’est pas forcément à l’aise pour parler de la guerre. C’est ce qui fait, d’ailleurs, toute la complexité du projet. Parfois, les personnes livrent un récit riche d’anecdotes et de faits historiques si marquants qu’on ne reste que scotché à leur parole, tant leur expérience est incroyable et émouvante. D’autres fois, un certain silence s’installe. On comprend alors directement qu’on touche à un sujet délicat, dont les souvenirs sont vifs et intimes; celui de la guerre. Mon échange avec Louis fait partie de ceux-là. Il accepte toutefois avec une grande gentillesse de m’aider dans mon projet, et de me confier quelques anecdotes.
“Contraints et forcés”
Louis n’a que 20 ans lorsqu’il est appelé d’office par l’armée française pour aller combattre en Algérie. Il y restera alors deux ans, jusqu’en 1963, un an après l’indépendance. Bien qu’il estime n’avoir « rien à faire dans ce pays », il doit se rendre à l’évidence : combattre les Algériens n’est pas un choix mais une obligation car « c’était comme ça avant, sinon, c’était la prison ».
Dans le cadre de cette convocation, Louis se rend donc en Algérie avec l’objectif d’entrer en lutte contre le FLN en Kabylie et à Alger. Il participera notamment aux combats à Tizi Ouzou ainsi qu’à la bataille de Bab el Oued en 1962. Cependant, très rapidement, Louis me confie qu’un sentiment particulier le traverse. Ses différentes expériences sur place lui font prendre conscience de l’état réel de sa mission. Sa parole d’ancien militaire se libère lorsqu’il me confie qu’il estime avoir été utilisé dans un conflit purement politique. Il va même jusqu’à se qualifier lui-même, ainsi que ses camarades, de « dindons de la farce ». La cause ? Une sorte de paradoxe entre ses convictions et son action, comme de nombreux autres appelés qui étaient pour la paix, mais « contraints et forcés à rejoindre l’armée française ».
“Mon père pensait que j’étais parti en vacances”
En 1954, l’Algérie connaît un soulèvement sans précédent. Le FLN réclame l’indépendance de la population par des attentats à la bombe à divers endroits du pays. Cet épisode a été camouflé au mieux par les autorités françaises. L’heure était davantage à la dissimulation qu’à la transparence, et régnait alors en France une sorte d’indifférence généralisée due à l’ignorance de la réalité du conflit. Louis lui-même en était victime et pensait ainsi qu’il était appelé pour une petite rébellion. L’ignorance était telle que son père pensait que son fils était simplement « parti en vacances ».
Louis m’explique que la bascule entre rébellion et guerre a eu lieu lorsque de Gaulle a commencé à parler « d’indépendance ». C’est à partir de ce moment que les tensions se sont accumulées à la fois en Algérie et en France. Sur place, Louis et ses collègues réalisent alors qu’ils n’ont pas affaire à une petite insurrection, mais bien à une véritable guerre. Parallèlement, en réaction aux propos du leader français de l’époque, les pieds noirs expriment leur mécontentement, eux qui « souhaitaient continuer de dominer ».
Cette domination, Louis en a été témoin. Il parle ainsi des Algériens comme d’un « peuple noyé », qui avaient « tellement subi qu’ils ne disaient plus rien ». Jusqu’au jour où est proclamée leur indépendance, le 5 juillet 1962.
Louis rentrera en France quelques mois plus tard, en 1963, 20 francs en poche et une guerre « inutile » en mémoire.
Par Farah
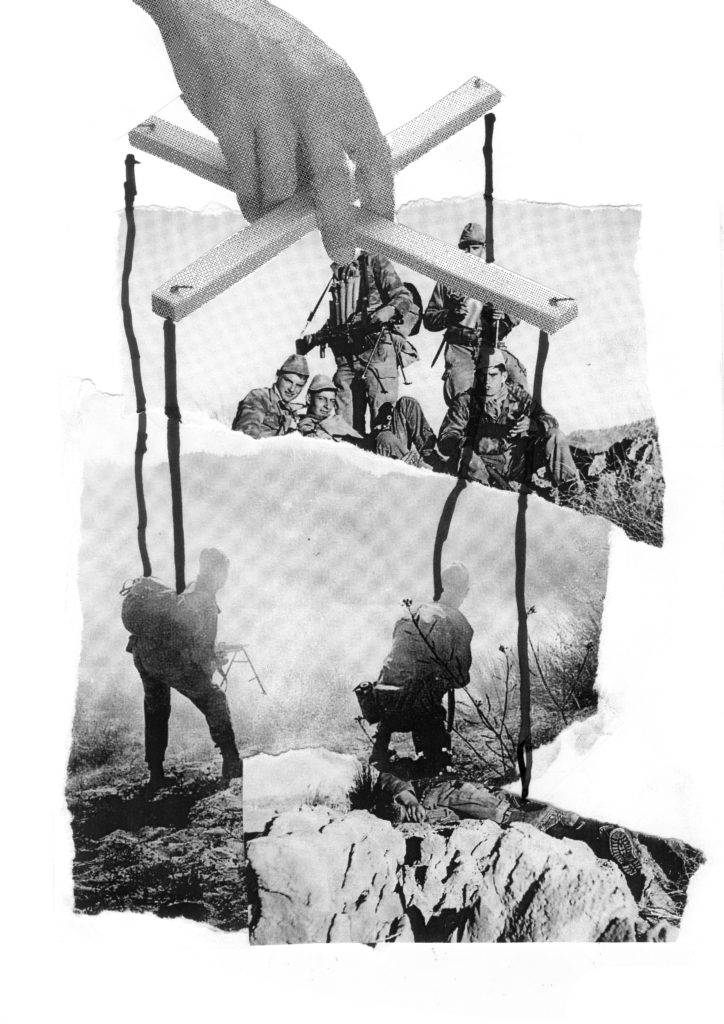
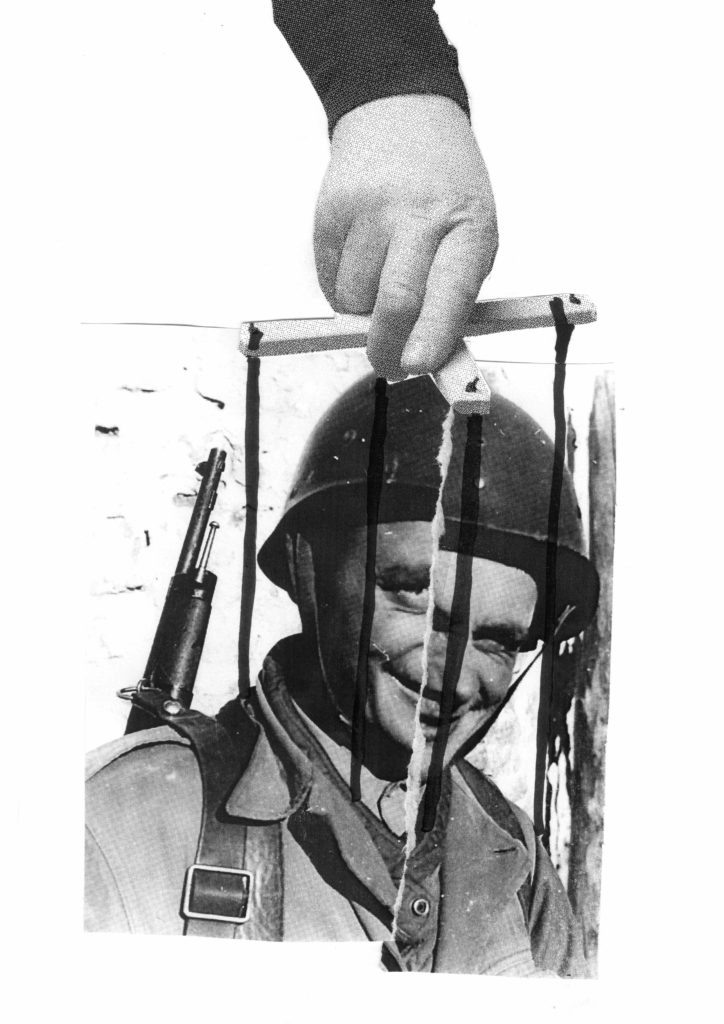
Explication des illustrations et ressenti d’Alexis N., 22 ans :
« Pour réaliser ces visuels, j’ai essayé de créer une esthétique rappelant des souvenirs anciens en travaillant avec des photographies d’époque en noir et blanc, collées et froissées pour faire référence à une époque lointaine, qui n’a été qu’une parenthèse dans la vie de Louis Defranchi. J’ai ensuite travaillé sur des collages de marionnettes pour faire référence au sentiment de manipulation dont parle Louis Defranchi, l’idée qu’il a pris part à un conflit purement politique. Je suis intervenu sur ce collage avec un feutre noir pour créer un contraste dans les techniques utilisées et j’ai créé des déchirures sur les photographies pour donner un côté brut à l’image, pour rappeler qu’il s’agissait d’une guerre et donc d’une période violente. »
Par Farah
Publié le 25 avril 2020
https://recitsdalgerie.com/appele-louis-defranchi/
.
Rédigé le 29/04/2023 à 20:51 dans France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires récents