C’est un bras de fer géopolitique qui se déroule aux frontières du Donbass. Poutine veut faire advenir un nouvel ordre international plus favorable à Moscou et à l’axe illibéral. Pour Joe Biden, la crédibilité des Etats-Unis dans le monde est en jeu.
C’était en 1997, six ans à peine après le démantèlement de l’Union soviétique et trois ans avant l’arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin. L’hégémonie américaine était alors absolument incontestée. L’ancien conseiller à la sécurité nationale du président démocrate Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, considéré comme l’un des meilleurs spécialistes des rapports de force dans le monde, publiait un ouvrage prophétique intitulé « le Grand Echiquier. L’Amérique et le reste du monde » (Bayard). Il y exposait comment, à son avis, les Etats-Unis devaient agir pour préserver leur suprématie. Ce faisant, il expliquait pourquoi, au XXIe siècle, l’Ukraine serait, selon lui, l’un des « pivots » majeurs de la géopolitique mondiale, si ce n’est le plus important. Que là se jouerait l’avenir de la domination américaine, et donc de la planète. Nous y sommes.
Bras de fer entre démocraties libérales et autocraties
Depuis deux mois, l’Ukraine est l’épicentre de la nouvelle guerre froide, le théâtre principal du bras de fer entre les démocraties libérales occidentales, Etats-Unis en tête, et les grandes puissances autoritaires, Russie et Chine. C’est Vladimir Poutine qui en a décidé ainsi. Homme fort du Kremlin depuis vingt-deux ans, il parie que le temps est enfin venu de provoquer l’émergence d’un nouvel ordre géopolitique international plus favorable à Moscou et à l’axe illibéral. Et que le dossier Ukraine en sera le catalyseur.
Pour déclencher cet orage désiré, il a, depuis l’automne dernier, déployé plus de 100 000 soldats à la frontière russo-ukrainienne, en Crimée et dans la Biélorussie voisine. Puis, fort de cet étalage de puissance, il a présenté à Washington et aux capitales européennes un ultimatum radical. Dans ce texte rendu public le 17 décembre, Vladimir Poutine place la barre très haut. Il exige que Kiev renonce définitivement à quitter le giron de Moscou et que les Etats-Unis réduisent drastiquement leur zone d’influence et leur présence militaire en Europe.
Concrètement, le maître du Kremlin somme les pays membres de l’Alliance atlantique de s’engager par écrit sur quatre points principaux : un, malgré le souhait exprimé par le président ukrainien Zelensky et une majorité de son peuple, l’Ukraine ne rejoindra jamais l’Otan ; deux, aucun autre pays ne sera admis dans cette organisation militaire ; trois, l’Amérique retirera ses armes nucléaires d’Europe ; et, quatre, le déploiement des forces de l’Alliance atlantique reviendra au niveau de ce qu’il était avant juillet 1997, c’est-à-dire avant l’intégration dans l’Otan des pays d’Europe centrale autrefois membres du pacte de Varsovie. En cas de refus, les chars russes rouleront sur Kiev. C’est du moins la menace implicite de ce déploiement de force sans précédent sur le Vieux Continent depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le joyau de l’empire russo-soviétique
Pourquoi Poutine est-il à ce point obsédé par l’Ukraine ? Il y a vingt-cinq ans, le visionnaire Brzezinski expliquait ainsi les tourments des autorités russes :
« En tirant leur révérence de manière abrupte [en déclarant leur indépendance en 1991, NDLR], les Ukrainiens ont mis un terme à plus de trois cents ans d’histoire impériale. Ils ont dépossédé leurs voisins d’une économie à fort potentiel, riche de son industrie, de son agriculture et d’une population de cinquante-deux millions d’habitants, dont les origines, la civilisation et la tradition religieuse étaient si proches de celles des Russes, que les liens impériaux ont toujours, pour ces derniers, relevé de l’évidence. »
De plus, ajoutait Brzezinski, « l’indépendance ukrainienne a privé la Russie de sa position dominante sur la mer Noire, car Odessa servait traditionnellement de point de passage pour tous les échanges commerciaux russes avec le monde méditerranéen et au-delà ». Si bien que, « pour Moscou, rétablir le contrôle sur l’Ukraine […], c’est s’assurer le moyen de redevenir un Etat impérial puissant s’étendant sur l’Europe et l’Asie », concluait l’ancien conseiller de Carter.

Voici donc pourquoi Vladimir Poutine, qui répète que la destruction de l’Union soviétique a été « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle », entend, au XXIe, récupérer d’une façon ou d’une autre le joyau de l’empire russo-soviétique. A ses yeux, il ne s’agirait que d’une correction légitime du cours de l’histoire puisque « Russes et Ukrainiens sont un seul peuple, une seule entité », ainsi qu’il l’a écrit en juillet dernier dans un long texte remis à tous les soldats russes. Ce n’est pas du tout l’avis de la majorité des Ukrainiens. Neuf sur dix ont voté pour l’indépendance de leur pays lors du référendum de décembre 1991. Et depuis que Poutine est au pouvoir, ils ont tenté à deux reprises de sortir de l’orbite dans laquelle le Kremlin a maintenu son ancien satellite.
En 2004, après un scrutin présidentiel truqué, des centaines de milliers de jeunes descendent dans les rues de Kiev. Ils exigent le départ du président prorusse Ianoukovitch, réélu frauduleusement. La « révolution orange » commence. Les manifestants réclament des élections transparentes, la fin de la corruption, mais aussi un rapprochement avec l’Occident. Ils obtiennent le départ de Ianoukovitch et l’installation de son successeur légitimement élu, Viktor Iouchtchenko. Les opposants au nouveau chef de l’Etat ont pourtant tout essayé pour l’écarter de la course à la présidence. Pendant la campagne électorale, il a été gravement empoisonné à la dioxine. Par des sbires du clan Poutine ? C’est l’hypothèse la plus probable.
Car le président russe, dont le pouvoir est, en 2004, encore instable, a peur. A l’époque, les « révolutions de velours » font trembler les autocrates postcommunistes. Elles ont déjà renversé le Serbe Milosevic en 2000, le leader géorgien Chevardnadze trois ans plus tard, et ensuite Ianoukovitch en Ukraine. Poutine redoute une contagion en Russie de ce mouvement démocratique, non violent et pro-occidental, qu’il soupçonne d’être téléguidé par Washington.

Son inquiétude s’accroît encore quand le héros de la « révolution orange », Iouchtchenko, négocie un début de rapprochement avec l’Alliance atlantique. Certes, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy refusent bec et ongles que l’Ukraine obtienne le statut de « candidat » à l’adhésion. Mais un sommet de l’Alliance à Bucarest en avril 2008 lui reconnaît « la vocation » à rejoindre, un jour, l’Otan. A la Géorgie aussi. Cette seule vague promesse met Vladimir Poutine en rage. Il le fait savoir manu militari quatre mois après, en envahissant, non sans mal, une partie de la Géorgie.
Il ne frappe pas – pas encore – l’Ukraine, pays beaucoup plus vaste que la petite République du Caucase, plus peuplé et mieux armé. Mais il fait tout pour déstabiliser son président. Celui-ci lui facilite la tâche en multipliant les bévues qui exaspèrent son peuple. Si bien qu’en 2010 le prorusse Ianoukovitch revient au pouvoir à Kiev, réélu cette fois à la loyale. Le clan Poutine est aux anges. Pas pour longtemps.
Fin 2013, Ianoukovitch décide, à la demande du Kremlin, de mettre un terme au rapprochement de son pays avec l’Union européenne engagé par son prédécesseur. Les Ukrainiens sont furieux. Ils descendent de nouveau en masse dans la rue, notamment sur la place principale de Kiev, Maïdan, qui donnera son nom à ce soulèvement plus violent que le précédent. Ianoukovitch finit par fuir en Russie et l’opposition pro-occidentale s’installe au pouvoir. Un coup d’Etat fomenté par l’Amérique, hurle le Kremlin sans preuve.

Poutine redoute, une fois encore, de perdre le joyau de l’empire russe. Mais il se sent plus fort qu’en 2004. Il vient d’être triomphalement réélu pour un troisième mandat. Son armée est plus puissante et bien mieux organisée que durant son attaque désordonnée contre la Géorgie. Il peut se lancer dans une aventure militaire contre Kiev. Et tant pis si, en 1994, en échange du transfert vers la Russie des armes nucléaires soviétiques stationnées en Ukraine, le Kremlin s’était engagé par écrit à respecter l’intégrité territoriale de ce pays, engagement reconfirmé par la partie russe en 2009.
Cinq ans plus tard, Poutine décide de s’asseoir sur cet accord, de soutenir les rebelles du Donbass, la région russophone de l’Ukraine, et surtout de mettre la main sur la Crimée par une opération éclair des forces spéciales russes. C’est un succès. Une majorité de Russes acclament leur leader. Les opposants sont bâillonnés. Pris de court et divisés, les Occidentaux réagissent mollement par des sanctions économiques peu douloureuses.
Faire reculer l’Otan
Amputée, assiégée, l’Ukraine s’enfonce dans la crise politique et économique. Mais l’invasion russe ne la dissuade pas de rejoindre l’Otan. Au contraire. Kiev voit dans l’adhésion à l’Alliance atlantique, dont l’article 5 prévoit la solidarité de tous les membres si l’un d’entre eux est attaqué, sa seule planche de salut face à son encombrant voisin.
Si bien qu’en 2017 le Parlement ukrainien désigne l’adhésion à l’organisation militaire occidentale comme l’objectif prioritaire de la politique étrangère du pays. En 2019, cette clause est même inscrite dans la Constitution. Et, en septembre 2020, le nouveau président, Volodymyr Zelensky, élu triomphalement un an auparavant, approuve officiellement cette stratégie. C’est probablement cette décision qui convainc Poutine de déclencher la mère de toutes les crises.
Car le maître du Kremlin s’est fixé une mission historique : faire reculer l’Otan le plus loin possible de la Russie. Pour lui, l’élargissement de l’Alliance atlantique, même librement décidé par ses nouveaux membres, est une injustice de l’histoire qu’il doit réparer. Il le répète à tous ses interlocuteurs : les Américains n’ont pas respecté les engagements oraux pris en 1990 après la chute du mur de Berlin, durant la négociation de la réunification allemande. Et, de fait, d’après les archives américaines et britanniques que « l’Obs » a étudiées, différents leaders occidentaux ont assuré oralement à Mikhaïl Gorbatchev et à d’autres responsables soviétiques de l’époque qu’ils n’entendaient pas « pousser leur avantage », que l’Otan ne progressera jamais « d’un pouce » vers l’Est.
Pourtant, dès 1994, alors que plusieurs pays d’Europe centrale piaffent à la porte de l’Alliance atlantique, impatients d’être protégés par l’Amérique contre les velléités coloniales de leur ancien maître russe, Bill Clinton demande au président Boris Eltsine d’accepter l’élargissement de l’Otan. En réponse, « Boris » supplie « Bill » de n’en rien faire. Intégrer si vite dans l’Otan d’anciens membres du pacte de Varsovie serait une « terrible humiliation » pour la Russie, martèle-t-il. Mais, en campagne pour sa réélection, le président russe, malade et impopulaire, a besoin du soutien financier et politique du charismatique chef de la Maison-Blanche. Donnant-donnant. Eltsine remporte un second mandat et, en 1999, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque rejoignent l’Alliance atlantique, sans que le Kremlin y fasse publiquement obstacle.
Les années suivantes, après que Vladimir Poutine a remplacé Eltsine, d’autres pays d’Europe de l’Est sont admis dans le club militaire de l’Occident, y compris les trois Républiques baltes qui faisaient partie intégrante de l’Union soviétique. A l’époque Poutine ne dit pas grand-chose. Il évoque même la perspective d’une adhésion de la Russie à l’Alliance atlantique. Mais après l’invasion américaine en Irak de 2003, contre laquelle Jacques Chirac et lui ont durement mais vainement bataillé, l’atmosphère entre la Maison-Blanche et le Kremlin se dégrade fortement. Le chef du Kremlin prend de plus en plus de distance par rapport au modèle libéral occidental qu’il finit par désigner comme l’ennemi principal de son pays. Et l’élargissement de l’Otan comme la première menace.
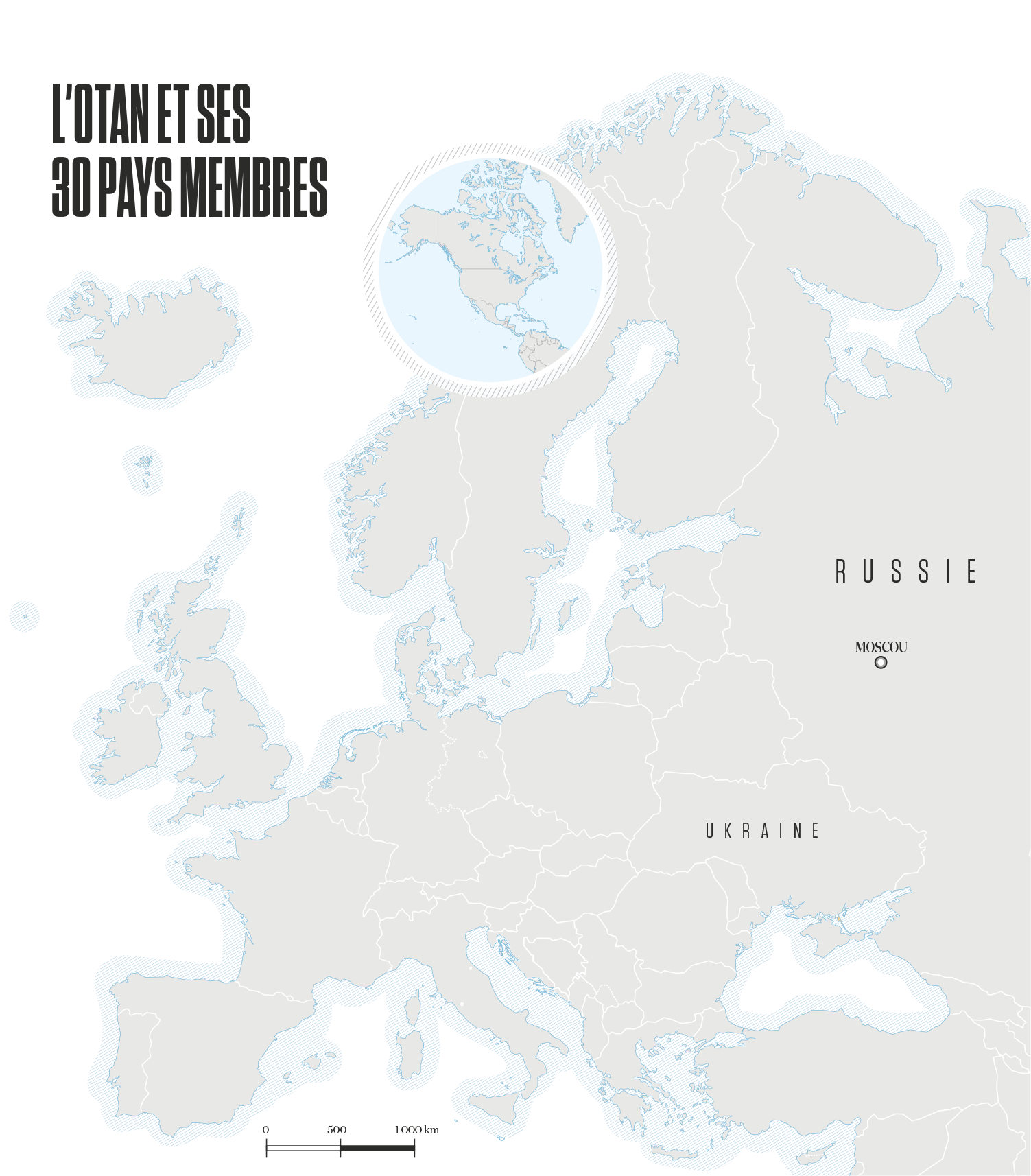
Signaux contradictoires
L’élection de Joe Biden renforce chez Poutine la conviction qu’il est temps pour lui d’agir. Car, à la différence de Donald Trump et même de Barack Obama, le nouveau président américain est un fervent partisan de l’Alliance atlantique et de son élargissement, y compris à l’Ukraine. En 2009, alors vice-président, il s’était rendu à Kiev puis à Tbilissi en Géorgie. Il y avait affirmé haut et fort qu’il souhaitait voir les deux anciennes Républiques soviétiques rejoindre l’Otan.
Poutine prépare alors son bras de fer avec l’Amérique dans les moindres détails. Il balaie les dernières poches internes de résistance à son pouvoir absolu. Il jette ainsi en prison son principal opposant, Alexeï Navalny, après avoir vainement tenté de le faire empoisonner. Puis il profite de la crise sanitaire pour faire adopter, en juin 2020, une Constitution à sa main qui lui permet, de fait, de rester président à vie. Parallèlement il muscle son armée. En dix ans, selon le « New York Times », elle a reçu mille avions de combat supplémentaires et des chars T-72B3 lanceurs de missiles d’une portée inégalée. Et elle dispose désormais de missiles hypersoniques à tête nucléaire qui pourraient contourner le bouclier antimissile américain. Quand Poutine les a présentés aux haut gradés russes, il leur a lancé : « Maintenant ils vont m’écouter ! »

Selon lui, le camp occidental est un ennemi à sa portée. Il est faible et divisé. En Europe, les différents partis d’extrême droite, aidés voire financés par le Kremlin, prônent une alliance avec la Russie. Miné par la crise sanitaire, le Vieux Continent n’a plus de grand leader unanimement respecté, capable de faire face au tsar : Angela Merkel a quitté la scène. Après le Brexit, auquel les services russes ont contribué par des fake news sur les réseaux sociaux britanniques, Boris Johnson fait figure de bouffon. Et Emmanuel Macron, qui répète que « l’Otan est en mort cérébrale », tergiverse. Pis, ou mieux, pour Poutine, tous doutent de la fiabilité du nouveau président américain, Joe Biden, obsédé par la montée en puissance du rival chinois.
Poutine a-t-il raison de miser autant sur les fragilités du camp adverse ? A ce jour, les signaux émis par les alliés occidentaux sont contradictoires. Quand, à l’automne, les Européens assistent à la projection de 100 000 soldats russes à la frontière russo-ukrainienne, ils croient à un nouveau bluff de Poutine : en avril 2021, ce dernier avait déjà déployé des troupes au même endroit, avant d’ordonner leur repli. Mais les Américains tirent la sonnette d’alarme. Ils font le tour des capitales de l’Otan avec des renseignements confidentiels : des comptes rendus d’écoutes, des images satellites, des rapports de sources à l’intérieur du pouvoir russe. Ils assurent que, cette fois, Poutine est décidé à aller jusqu’au bout. « Il peut envahir l’Ukraine à tout moment », répètent-ils.
Après quelques bourdes de Biden le gaffeur, l’Amérique se met en ordre de bataille. La Maison-Blanche annonce que, certes, en cas d’agression russe, elle ne défendra pas militairement l’Ukraine, qui n’est pas, et pour cause, membre de l’Alliance atlantique. Mais le président des Etats-Unis assure que ses équipes préparent contre la Russie et le clan au pouvoir une liste de sanctions économiques à « l’effet d’une bombe nucléaire ». Il n’en précise pas le détail mais laisse entendre que l’Amérique pourrait s’en prendre notamment aux avoirs à l’étranger de Vladimir Poutine en personne. Puis il annonce qu’il met des troupes en alerte et qu’il va en dépêcher certaines en Europe.

Les Français et les Allemands se mobilisent plus prudemment. A Paris comme à Berlin, on soupèse la volonté réelle de Poutine de franchir le pas. On temporise. D’autant plus que les Européens se chamaillent sur la conduite à tenir. Quand certains, comme la République tchèque et les Royaume-Uni, livrent des armes à Kiev, l’Allemagne se contente d’envoyer quelques casques. Paris accepte de déployer des troupes en Roumanie, pays membre de l’Otan, frontalier de l’Ukraine. Tandis que Berlin hésite à suspendre la mise en route du gazoduc Nord Stream 2, qui relie directement l’Allemagne à la Russie − mesure de rétorsion qui pourrait, selon Washington, modifier le calcul de Poutine.
Et puis les Européens tergiversent sur la sanction « nucléaire » que Washington voudrait brandir : débrancher les banques moscovites du système Swift de compensation interbancaire, une action qui porterait un coup terrible aux échanges commerciaux de la Russie. Les Allemands et d’autres hésitent à aller jusque-là, à mettre à genoux un pays dont ils sont dépendants.
Malgré ces divergences sur les sanctions, Etats-Unis et pays européens rédigent une réponse commune à l’ultimatum de Poutine. On ne connaît pas le contenu exact de leur missive remise le 26 janvier aux autorités russes. On sait qu’ils refusent catégoriquement d’accorder à Moscou un droit de veto sur les nouvelles adhésions à l’Otan et sur les autres lignes rouges de Poutine. Seule concession connue : Joe Biden assure que « l’Ukraine ne rejoindra probablement pas l’Alliance atlantique à court terme », et qu’il est prêt à s’engager à ne pas y déployer d’armes nucléaires. Pour l’instant, c’est donc l’impasse.
La Chine à l’affût
Au bord de l’abîme, qui va céder ? Pour Poutine, s’arrêter en chemin, ce serait dire à son peuple et au monde qu’il renonce à parachever cette grandeur russe qu’il restaure petit à petit depuis vingt ans et dont les citoyens de son pays lui sont largement reconnaissants. Ce serait aussi – et peut-être surtout – mettre en danger son pouvoir et celui de son clan, lui qui a misé tout son capital politique dans cet affrontement avec le président américain Joe Biden. Mais attaquer l’Ukraine, même de façon « hybride », déclencherait une escalade avec l’autre superpuissance nucléaire, dont personne ne peut prévoir l’issue. Même pas le deus ex machina du Kremlin.
Pour Washington, il en va de son statut de leader du monde dit libre. Accepter de réduire sa présence militaire en Europe sous la pression russe reviendrait à dire à ses alliés qui, pour leur sécurité, dépendent encore − sauf la France − du parapluie nucléaire des Etats-Unis, que sa parole n’est plus aussi ferme qu’autrefois. Ce qui provoquerait une importante incertitude, voire un chaos. Et le déclin (irréversible ?) de la puissance américaine.
Mais reconcentrer toute son énergie dans un conflit avec la Russie pourrait l’affaiblir dans sa compétition avec la Chine. Celle-ci est à l’affût. Le 27 janvier, les autorités de Pékin ont pour la première fois pris parti. Elles ont déclaré qu’elles défendaient « les préoccupations raisonnables » du Kremlin dans le dossier ukrainien. Certains observateurs assurent qu’il s’agit là d’un cadeau pour remercier l’ami Poutine d’assister en personne à l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin le 4 février, cérémonie boycottée par un grand nombre de chefs d’Etat. D’autres croient plutôt à une faveur mesurée faite en échange de la promesse russe de ne pas attaquer l’Ukraine avant la fin de ces Jeux. D’autres encore considèrent que la Chine se range du côté russe afin de maintenir Washington le plus longtemps possible dans le bourbier est-européen.
Quoi qu’il en soit, les conséquences d’un pas en arrière de la Maison-Blanche, si petit soit-il, seraient immenses sur l’équilibre des forces dans le monde. Le moindre recul américain sur le Vieux Continent pourrait inciter Pékin à avancer ses pions dans la sphère américaine en Asie, et avant tout contre Taïwan, l’autre pivot de la géopolitique planétaire. Xi Jinping, le leader chinois, pourrait en conclure que le moment tant attendu est arrivé : que l’île ne sera pas défendue par l’US Army. Que l’heure de la Grande Chine a sonné. Et le monde entrerait définitivement dans une autre ère.
Les commentaires récents