.
Trois mois après la signature des accords d'Evian, l’OAS dépose les armes, la guerre d’Algérie est terminée.

- Malgré la situation de guerre, des Algérois se détendent à la plage près d'Alger le 2 avril 1962, sous des graffiti favorables à l'OAS. AFP -
Comme ils le font tous les soirs, de nombreux Européens de la capitale écoutent à la radio l’émission pirate de l’OAS, l’Organisation Armée Secrète, qui rassemble les derniers fervents de l’Algérie française dans un combat crépusculaire, violent et désespéré. Il est 20 heures 30, ce 17 juin 1962 à Alger. Ceux qui ne sont pas au courant des négociations qui se tramaient depuis plusieurs semaines entendent, stupéfaits, un porte-parole annoncer d’une voix grave:
« Aujourd’hui, 17 juin, à midi, à l’issue d’entretiens auxquels l’OAS a participé, le FLN vient, par la voix de son délégué général, de définir les bases d’un accord entre Algériens. Le haut commandement de l’armée secrète donne l’ordre à partir de ce soir de suspendre les combats et d’arrêter les destructions».
Certes, les violences ne cesseront pas tout à fait. Certes, il y aura encore des blessés, des morts, des disparus, comme autant de derniers tributs au monstre pas encore rassasié. N’empêche: le 18 juin au matin, un air de paix semble envelopper la ville blanche. Surtout: les desperados de l’OAS stoppent la politique de la terre brûlée et ne mettent pas en application les opérations prévues de destruction massive, comme l’explosion des puits de pétrole, le minage des égouts de la Casbah, la destruction des barrages.
De leur côté, les chefs du FLN d’Alger parviennent à retenir des centaines de combattants armés décidés à «descendre» sur les quartiers européens pour se venger des exactions de l’armée secrète. La guerre d’Algérie est bel et bien terminée.
Jacques Chevallier, l'homme de la dernière chance
Cinquante ans après, le voile commence à être levé sur ces «accords» FLN-OAS, un des épisodes les moins connus et les plus riches en rebondissement d’une histoire qui n’en est pas avare.
Un homme, Jacques Chevallier, a joué un rôle central dans ces négociations de la dernière chance. Ce fils d’une Américaine de Louisiane et d’un grand commerçant algérois, propriétaire d’une tonnellerie où travaillera l’oncle d’Albert Camus, a onze ans en 1922, quand, venant des Etats-Unis, il débarque dans la ville blanche. Après des études au collège des pères jésuites de Notre Dame d’Afrique, ce jeune homme pressé brûle les étapes et commence une carrière politique à l’extrême droite, précisément chez les Croix de Feu du colonel de la Roque.
En 1941, le général Weygand, délégué général du gouvernement de Vichy le nomme maire d’El Biar, une des communes d’Alger. Trois ans plus tard, après avoir fait la guerre en Italie, il est envoyé à Washington, cette fois par Jacques Soustelle, le patron des services secrets de la Résistance, pour réorganiser le contre-espionnage français aux Etats-Unis.
De retour à Alger à la fin de la guerre, il est élu conseiller général puis député sur des listes «d’entente» défendant bec et ongles le régime colonial. Tous prédisent un avenir des plus brillants à cet homme élégant, déjà père de famille nombreuse. L’Algérie française a trouvé son héraut.
Sa vie bascule au début des années 50 quand il comprend que la voie étroite de la colonisation n’a pas d’issue et que le dialogue s’impose entre tous les Algériens, quelles que soient leurs origines, leurs religions et leurs convictions politiques, pour trouver une nouvelle manière de vivre ensemble.
Elu triomphalement maire d’Alger en 1953, il va immédiatement mettre ses idées en application et prend comme premier adjoint un avocat musulman, Me Kiouane, qui ne cache pas son engagement nationaliste. Il lance aussi, avec l’architecte Fernand Pouillon, «la plus vaste opération d’urbanisme social qu’ait jamais connue l’Afrique du nord», selon les mots de l’historien Jean-Louis Planche.
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/AFE85005317/alger-ville-en-plein-developpement.fr.html
Nommé secrétaire d’état à la guerre dans la «dream team» de Pierre Mendès France en juin 1954, il tente, sans beaucoup de succès, de convaincre ses collègues de la nécessité d’ouvrir le dossier algérien avant qu’il n’explose. Ainsi il organise une rencontre entre Mendes France et Ferhat Abbas, un des leaders modérés du nationalisme algérien.
Trop tard. La guerre commence le 1er novembre 1954. Et avec elle, le calvaire de Jacques Chevallier et de tous les européens d’Algérie considérés comme «libéraux», d’Albert Camus à Monseigneur Duval, l’archevêque d’Alger, qui veulent, contre toutes les violences et les extrémismes, continuer à défendre l’indispensable dialogue.
Une lettre de Salan
Voué aux gémonies par les ultras de l’Algérie française, Chevallier ne peut apparaitre dans une manifestation sans être sifflé, hué. Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre son combat pour améliorer les conditions de vie des Algérois, notamment des plus pauvres. Le «maire des Arabes», comme le nomment maintenant les extrémistes, se bat aussi pour aider, autant que faire se peut, les familles des «disparus», victimes de la bataille d’Alger.
En mai 1958, le général Salan, chef des armées d’Algérie, qui a été investi de tous les pouvoirs par le dernier gouvernement de la IVe république éjecte purement et simplement Chevallier de sa mairie. Revenu aux affaires quelques temps après, le général de Gaulle, qui doit alors compter avec les extrémistes, ne fait rien pour le sauver. Jacques Chevallier quitte alors la politique.
Meurtri, abandonné, l’ancien maire monte une société immobilière à Paris avec Fernand Pouillon. Il tente de refaire sa vie entre Alger et Paris. Les «durs» de l’Algérie française ne veulent pas l’oublier et, en janvier 1961, font exploser un pain de plastic devant le portail du «Bordj», sa villa des hauteurs d’Alger.
On imagine alors sa surprise lorsque, fin août 1961, il reçoit une lettre du général Salan, qui a pris la tête de l’OAS. L’ancien maire a du mal à retenir - son rire? sa colère? - tant Salan y va dans la flagornerie:
«Votre incontestable prestige sur la masse musulmane d’Algérie, écrit l’ancien chef des armées, est encore assez fort pour que votre voix soit entendue et que vous contribuiez à faire basculer l’opinion dans le sens d’une Algérie fraternelle telle que nous la souhaitons tous et pour laquelle nous luttons».
Bigre ! Après une longue réflexion, Chevallier accepte de voir Salan. S’il y a une chance de faire cesser les violences, qui se multiplient, il faut la tenter. Le 30 octobre, lui qui avait déjà pris de sérieux risques en rencontrant, dans le plus grand secret, des responsables indépendantistes algériens, le voilà qui accepte un rendez-vous avec l’homme sans doute le plus recherché de France.
Salan, le beau général au profil de médaille, aux cheveux blancs argentés, aux tenues impeccablement repassées, n’est plus que l’ombre de lui-même dans son costume civil avec ses cheveux teints en noir et sa moustache. Il a beau assurer qu’il se rallie à la formule fédérale toujours prônée par Chevalier et qu’il va faire cesser les attentats, rien de concret ne sort de la discussion.
Sur le terrain, la situation se dégrade de jour en jour. En janvier 1962, si les pouvoirs spéciaux sont décrétés en Algérie, ce n’est plus pour lutter contre le FLN mais contre l’OAS. Celle-ci multiplie les attentats. Musulmans comme Européens sont visés. Le 15 mars, l’écrivain Mouloud Feraoun, grand ami d’Albert Camus, est assassiné.
Le lendemain, la signature des accords d’Evian et la proclamation du cessez-le feu entre l’armée française et l’ALN exacerbent encore la violence de l’OAS. Certains quartiers d’Alger donnent l’impression d’avoir été bombardés. Le 23 mars, un commando de l’armée secrète ouvre le feu sur un camion de l’armée française et tue six jeunes appelés.
Trois jours plus tard, ce sont les troupes françaises qui tirent sur les Pieds Noirs venus manifester pacifiquement dans le centre d’Alger. On relèvera 54 morts. L’arrestation de Salan, le 20 avril 1962, va faire encore monter la terreur. Ordre est donné de massacrer froidement tous les Musulmans se rendant dans les quartiers européens.
Pour les démiurges de l’OAS, il s’agit de pousser les Musulmans à bout pour qu’ils se vengent et, alors, obliger l’armée française à intervenir. Début mai, l’explosion d’une voiture piégée dans le port d’Alger, qui fait 62 morts parmi les ouvriers musulmans, pourrait être le déclencheur de ce processus infernal.
Terre brûlée
Le commandant Si Azzedine, à la tête du FLN pour la région d’Alger, doit empêcher la foule des musulmans de fondre sur les quartiers européens. Il autorise en revanche des commandos du FLN à mitrailler des cafés fréquentés par les Européens et de faire plus de 20 morts.
L’exil des Pieds Noirs commence et, avec lui, la politique de la terre brûlée. Ecoles, centrales électriques, installations portuaires sont incendiés. «Au train où vont les choses en Algérie, écrit alors Jacques Chevallier, et où se couche sur son grand livre la comptabilité tragique des destructions et de l’assassinat, l’affreuse recherche de la balance dans de la tuerie, il ne restera bientôt plus rien de ce pays naguère robuste, organisé et structuré.»
C’est dans cette atmosphère crépusculaire qu’entre Alger, Paris, Tripoli, Tunis et Le Caire va se jouer le dernier acte de la tragédie algérienne. Avec une question en ligne de mire: Alger va-t-elle brûler?
Jean-Jacques Susini sort du bois le premier. Eminence grise de Salan, ce jeune homme, même pas trente ans, au teint blafard, passe pour l’idéologue de l’OAS. Brillant, ouvertement fasciste, peu économe de la vie de ses adversaires, il comprend que l’OAS a perdu à moins d’opérer un virage à 180 degrés et de s’entendre directement avec le FLN.
Il prend alors contact avec Abderrahmane Farès, qui préside l’exécutif provisoire mis en place par les accords d’Evian pour gérer l’administration publique en Algérie avant le referendum du 1er juillet devant consacrer l’indépendance du pays.
Homme rond, affable, profondément francophile, Farès a rejoint tardivement les rangs du FLN et a toute la confiance du général de Gaulle. Rendez-vous est pris pour le 18 mai avec Susini. Celui-ci, pour montrer combien l’OAS est encore puissante, téléphone à Farès pour l’avertir qu’une bombe a été placée dans un bac de fleurs devant son bureau de «Rocher Noir», la cité administrative située à 20 km d’Alger, où siègent les membres de l’exécutif provisoire ainsi que Christian Fouchet, le dernier haut représentant de la France en Algérie.
Les agents de sécurité se précipitent et constatent en effet qu’un pain de plastic est bien enfoui à l’endroit indiqué! (Ce qu’ils ne savent pas, et que Susini a révélé récemment à l’auteur de ses lignes, c’est que l’OAS n’avait pas les moyens de mettre l’engin à feu).
Farès et Susini se retrouvent donc dans une ferme de l’Alma, à une trentaine de kilomètres d’Alger. Activement recherché par la police, Susini est venu seul, sans armes. Et le miracle se produit. Touchés par on ne sait quelle grâce, les deux hommes, que tout oppose, sinon une ambition démesurée, jette sur le papier les «éléments de base d’un protocole d’accord» échafaudant les contours d’une «république algérienne» accordant notamment des droits très importants à la communauté européenne qui pourrait disposer d’un droit de véto contre toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits.
Ce nouvel état, où les deux langues officielles seraient l’arabe et le français, devrait interdire les partis «à base raciste» ou «d’obédience étrangère» comme le parti communiste. Prévu, aussi, un directoire national algérien dirigé par Farès où siègeraient quatre membres du gouvernement provisoire algérien, en exil, et trois membres du conseil supérieur de l’OAS.
On imagine l’effet que pourrait produire dans le monde la révélation d’un tel accord, qui va beaucoup plus loin que les accords d’Evian. Le hic, c’est que Farès n’a jamais reçu du FLN l’autorisation de négocier ainsi avec l’OAS.
Alors, il tergiverse, remettant toujours au lendemain la publication du «protocole». Pressentant qu’ils ont été bernés, les autres chefs de l’OAS, fous de rage, annoncent des opérations d’envergure.
Tenu au courant, Christian Fouchet, le haut représentant français, pense alors que Jacques Chevallier reste la seule personne susceptible de débloquer la situation. Les deux hommes, qui ont fait tous les deux partie du gouvernement de Pierre Mendès France, s’estiment. Fort du soutien du gouvernement, l’ancien maire reprend alors son bâton de pèlerin dans la mission de la dernière chance.
Il voit Fouchet, mais aussi Susini et Farès qui, écrit l’ancien maire, «se pose déjà en chef de la république algérienne». Tout semble s’écrouler lorsque le docteur Chawki Mostefaï, qui représente légalement le FLN au sein de l’exécutif provisoire et qui est, en fait, le vrai «patron» de Farès, parait s’étrangler lorsque l’envoyé spécial du Monde, Alain Jacob, évoque des contacts en cours entre l’OAS et le FLN!
«Pourquoi négocier avec les criminels de l’OAS alors que nous aurons notre indépendance dans quelques semaines et que les accords d’Evian donnent suffisamment de garanties aux européens d’Algérie», s’emporte Mostefaï qui publie alors un communiqué très sec demandant l’arrêt de toute négociation.
Celle-ci pourtant va se poursuivre. A ce moment du récit, il faut tenter de se remette dans l’ambiance de l’époque pour comprendre cet imbroglio. Alger est une ville à la dérive, où les informations ne circulent plus vraiment ou alors dénaturées, amplifiées.
La direction de l’OAS est partagée entre les militaires, partisans du baroud d’honneur et les civils qui croient à la négociation. Dans les quartiers, les petits chefs font la loi. Les chefs du FLN, eux aussi, se déchirent dans une lutte fratricide pour un pouvoir qui va bientôt leur appartenir. Seul de Gaulle semble clair: il faut en finir le plus vite possible.
Partie de pétanque
Chaque jour apporte alors son lot de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Un matin, on apprend que les discussions se poursuivent et progressent. On raconte même que, pour tuer le temps, les gardes du corps des dirigeants de l’OAS et du FLN ont disputé une partie de football dans le jardin de la villa de Chevallier.
«Très exagéré, précise aujourd’hui un des témoins de l’époque. En fait, les types du FLN s’amusaient avec un ballon d’enfant. Celui-ci est arrivé jusqu’à moi et je le leur ai renvoyé d’un petit shoot». Dans ses mémoires, Christian Fouchet évoque, lui, une partie de pétanque entre les gros bras des deux camps!
Le lendemain l’ambiance peut changer du tout au tout. Susini peut ainsi se lancer dans une description froide de l’opération terre brulée envisagée par l’OAS. Une fois leurs femmes et leurs enfants envoyés en métropole, les européens attaqueront les quartiers musulmans, les barrages seront détruits, inondant les plaines, Le colonel Gardes, un des chefs de l’OAS, qui vit dans un état proche de la folie, menace de «reprendre les armes en France, où il y a 400.000 Kabyles que l’on peut tuer»!
Pour montrer qu’ils ont encore une belle capacité de nuisance, des commandos de l’OAS mettent le feu à la grande bibliothèque d’Alger. 600.000 livres vont brûler sous les applaudissements de la foule. L’hôtel de ville aussi va être plastiqué.
Alors que Chevalier note sur ses carnets que «tout parait foutu», Mostefaï prend les choses en main. Deux éléments l’ont poussé à reprendre les négociations. Aujourd’hui, il raconte :
«Si Azzedine, raconte-t-il aujourd’hui, est venu me voir pour me dire qu’un haut responsable de l’armée française très engagé dans la lutte anti-OAS lui avait confirmé que les égouts de la Casbah et de Belcourt étaient bourrés de dynamite et que l’OAS pouvait les faire sauter. Là, je me suis dit que cela devenait sérieux. Le fait que Fouchet me dise un peu plus tard que le général de Gaulle jugeait la situation très grave et que des négociations au plus haut niveau avec l’OAS pourraient donner de bons résultats m’a aussi ébranlé. Alors, j’ai réuni mes amis et je leur ai dit : ”Cela se corse, cela devient une affaire de gouvernement”».
Le 7 juin, Mostefaï décide de se rendre à Tunis et à Tripoli pour rencontrer ses chefs. Ceux-ci l’écoutent mais ne veulent pas prendre parti. Ils ont d’autres chats à fouetter. Seul Ben Khedda, le président du GPRA, entre, sans vraiment se mouiller, dans le vif du sujet. «Faites ce que vous voulez, dit-il à Mostefaï, on ne peut pas prendre le risque de dix, vingt ou trente mille morts. Essayez de négocier sans rien changer aux accords d’Evian».
Accord sans substance
C’est avec ce carnet de route bien vague que Mostefaï rentre à Alger. Susini, de plus en plus contesté au sein de l’OAS, tente de sauver ce qui peut l’être du protocole d’accord mis au point avec Farès.
Il revendique ainsi la formation d’un gouvernement provisoire de l’Algérie dans lequel les Européens auraient, de droit, la vice-présidence et le ministère de l’Economie. Inacceptable, bien entendu, pour Mostefaï qui va réussir à vider l’accord de toute substance.
Il est seulement convenu que Mostefaï, Susini et Chevallier prendront la parole officiellement pour se féliciter de la fin des hostilités. Il faudra malgré tout encore plusieurs jours, et une nuit, pour que Mostefaï accepte de citer le nom de l’OAS dans son allocution. Ce qu’il fera le 17 juin en s’adressant directement aux Européens d’Algérie:
«C’est une page de l’histoire de notre pays que nous allons tourner […] Je sais le désarroi dans lequel vous êtes. Vous vous posez des questions sur votre avenir dans ce pays. Ces sentiments ont été exprimés par les dirigeants des organisations syndicales et professionnelles, et en particulier par les dirigeants de l’OAS, avec lesquels nous nous sommes entretenus. Si j’ai participé à ces entretiens, c’est parce que leur utilité a été reconnue par les dirigeants algériens».
C’est dit!
«Algériens d’origine européenne, conclut Mostefaï, au nom de tous vos frères algériens, je vous dis, que si vous le voulez, les portes de l’avenir s’ouvrent à vous comme à nous. Que ce soir, que demain cessent les dernières violences, les derniers meurtres, les dernières destructions ».
Le porte-parole de l’OAS lit d’abord deux messages codés, dans le style de Radio-Londres. «Pour le renard des sables et pour le fennec : les briquets ne doivent pas être allumés» (traduction: on ne fait pas sauter les puits de pétrole) et «Les piscines doivent rester pleines» (Ne pas toucher aux barrages).
D’une voix grave il annonce alors que les dirigeants de l’armée secrète ont décidé de suspendre les combats. La guerre d’Algérie est terminée.
Et Alger n’a pas brulé!
Epilogue
Cet accord ne suffira pas à rassurer les Pieds Noirs. Ils n’y croient plus et quittent à jamais l’Algérie. Jean-Jacques Susini partira, lui, à la mi-juillet pour poursuivre une vie de clandestin. Condamné deux fois à mort par contumace, notamment pour avoir commandité l’attentat du Mont Faron contre le général de Gaulle en 1964, il sera amnistié en 1968. Il vit actuellement à Paris.
Le docteur Mostefaï, à qui on reprochera longtemps ces négociations avec l’OAS, vit entre Paris et Alger. Jacques Chevallier, qui avait choisi la nationalité algérienne, est mort à Alger en 1971.
.
José-Alain Fralon
«Jacques Chevallier, l’homme qui voulait empêcher la guerre d’Algérie» (Fayard).
Présentation de l'éditeur
Juin 1962. L’Algérie française vit ses derniers instants dans une violence crépusculaire. L’OAS, qui pratique la politique de la terre brûlée, menace de déverser une énorme citerne d’essence sur Alger et de dynamiter tous les égouts de la ville. Les responsables du FLN se préparent à lancer un millier d’hommes sur les quartiers européens. Pour tenter d’empêcher les massacres annoncés, Jacques Chevallier, l’ancien maire, apparaît aux yeux de tous comme le recours ultime, le seul homme à pouvoir encore réunir tout le monde autour d’une table. Il réussira à faire taire les armes et à empêcher le pire :
Alger ne brûlera pas.
Jacques Chevallier a onze ans en 1922 lorsqu’il débarque à Alger avec ses parents. De retour en Algérie après guerre, il comprend dès 1952 que la politique coloniale n’a plus de raison d’être et prône un dialogue entre les différentes communautés d’Algérie. Ministre de Pierre Mendès France au moment où commence la guerre d’Algérie, il devient la cible des extrémistes, qui lui reprochent de vouloir négocier avec les indépendantistes. Il ne sera pas entendu. Les militaires l’éjecteront de sa mairie en mai 1958.
Au-delà du récit détaillé des journées haletantes de juin 1962, racontées pour la première fois, José-Alain Fralon retrace, à partir d’archives inédites et d’entretiens avec certains des acteurs encore vivants de ce drame, l’histoire romanesque et exemplaire d’un homme qui, si on l’avait écouté, aurait pu éviter la guerre d’Algérie.

Un appelé FS -Français de Souche se souvient :
publié le 18/03/2012 à 12:08
Comme une petite honte secrète restée enfermée dans le silence pendant tant d’années.
Arrivée dans la région de Tlemcen fin 61.
Quelques opérations de routine, le secteur est très calme, on sent qu’on approche de la fin de la guerre. Fasciné par les paysages que je découvre, magnifiques, rudes (la neige ; c’est l’hiver et on est en altitude), l’incroyable couleur du bleu du ciel….….Je vais souvent au ‘douar’ voisin, j’approche les enfants, suis abasourdi par leur dénuement matériel.
Etant radio, nous faisons les ‘3 X 8’. Cela permet de capter beaucoup d’informations qui remontent du terrain. Dans les mois qui suivront, j’aurai l’occasion de mesurer l’écart entre la réalité, et ce qu’en disent les journaux….
Une nuit, alors qu je suis ‘de permanence’, arrive un message « extrême urgent » - ce qui ne se produisait jamais – provenant du Premier Ministre (Michel Debré) annonçant qu’un accord à été signé à Evian, et que depuis minuit le cessez-le-feu est effectif. Je me souviens de mon excitation, et de l’énergie avec laquelle je suis allé réveiller l'officier de permanence….
C’était le 19 Mars 62.
Il y a eu alors le projet de ce qui s’appelait la « force locale », qui devait être composée paritairement de militaires Français, et de combattants Algériens de l’ALN (Armée de Libération Nationale) pour assurer ensemble l’ordre pendant ces mois de transition avant l’ "autodétermination".
Je me suis porté volontaire, malgré l’incompréhension de mes camarades, mais il n’y a pas eu de suite, la Force Locale n’a jamais été constituée.
Nous nous réjouissions du cessez-le-feu, mais ne savions pas encore que c’était pour nous le vrai début de notre guerre.
En effet, les accords d’Evian ont vu se déchaîner les actions terroristes de l’OAS, fruit du désespoir des ’ultras’, les européens, Français, d’Algérie, qui ne pouvaient accepter l’autodétermination qui était la position officielle de la France, mais dont tout le monde savait qu’elle allait vouloir dire ‘indépendance ‘.
Peu après, nous quittons notre village près de Tlemcen pour Oran, et notre mission était de neutraliser, ou contrer, l’OAS.
25 Mars, affrontement à Alger entre l’Armée et l’OAS.
Le lendemain (je crois), c’est à Oran que ça se passe. Barricades dressées dans les rues par l’OAS (soutenue par une grande majorité des Européens, totalement désespérés et victimes de la propagande extrémiste de droite), barricades faites de voitures renversées, de bus…. Spectacle hallucinant des chars écrasant ces barricades. Ca tire de partout… un capitaine, à bout de nerfs, craque et se jette à plat ventre sous une voiture… Des hommes qui tombent. La pensée, très lucide : « dans 2 secondes, ce sera peut-être moi »…
Et puis tout d’un coup, ça s’arrête. L’extrême tension se relâche. Avec mes camarades, nous nous asseyons sur un banc, l'un de nous sort une bouteille, nous buvons un coup, mangeons un saucisson. Et, à quelque mètres, deux cadavres de militaires qui venaient d’être tués. Au bout de quelques minutes, j’ai réalisé que je n’avais pas eu une pensée pour eux, pas pensé une seconde à dire la moindre prière…Et j’ai réalisé combien il faudrait être vigilant pour ne pas se laisser happer et détruire psychiquement, moralement, par cet engrenage terrifiant….
Pendant quelques semaines, nous sommes ensuite allés dans un village près d’Oran, qui alors s’appelait ‘Perrégaux’. Notre mission était de protéger la population des descentes de l’OAS, qui déboulaient à bord de voitures d’où ils tiraient à la mitraillette sur tous les Arabes qu’ils voyaient.
En montant la garde, j’avais fait connaissance d’un voisin algérien qui m’a invité plusieurs fois chez lui. Ils n’avaient rien. Un jour il a dit : « le plus dur pour moi, c’est quand, le matin, je me dis que je ne sais pas si je vais trouver à manger aujourd’hui pour mes enfants ». Et pourtant il n’était pas question de ne pas accepter le thé et le si peu de galettes ou de fruits qui leur restaient…..
Après Perrégaux, retour à Oran.
Des semaines absolument terribles. Certes le sentiment d’être au coeur d’un endroit où l’Histoire était en train de se faire, mais aussi, surtout, la haine absolue, sans frein, aveugle, totalement folle…. vu le cadavre d’un ado algérien tué à coups de pied dans la tête…entendu, dans une rue, une détonation toute proche et vu un homme (Arabe bien sûr) s’écrouler, personne ne se détournant, tout le monde enjambant sans problème le cadavre en train de se vider de son sang….. les camions bourrés d’essence lâchés en haut de la rue pour venir exploser contre le lycée que nous occupions…… les attaques à la mitrailleuse contre ce lycée… l’incendie du port d’Oran, avec des flammes de 250 m de haut, qui nous ont empêché de voir le soleil pendant plusieurs jours… les insultes qui nous étaient criées –par les Français – quand nous passions dans la rue...
Il y avait aussi le spectacle très triste de tous ceux (l’immense majorité des ‘Pieds noirs’ n’étaient que de ‘petites gens’) qui s’embarquaient pour ne plus revenir, avec de misérables valises….
Le 5 juillet, c’était l’Indépendance…les incroyables scènes de liesse, et les drapeaux algériens surgis de partout…les horreurs aussi ; je n’ai pas été témoin de massacres de harkis, mais j’ai su (grâce à la radio), et je me souviens de cet homme, Français, lynché à mort dans sa voiture simplement parce qu’il passait là où il ne fallait pas…..
Puis notre régiment est dissous, et je suis affecté au sud d’Alger, au cœur de la Mitidja, plaine fertile et riche, désertée par les colons.
Permissions à Alger. Quelques semaine à peine après l’Indépendance, marchant au hasard des rues (malgré les consignes), en uniforme, je suis invité (moi, membre d’une armée qui venait de ‘perdre la guerre’) par un Algérien inconnu à venir prendre chez lui un café. Il me dit : « Tu sais, chez vous comme chez nous, il y a les bons et les mauvais »… Mais je me rappelais l’après-guerre en France…il aurait été tellement impensable d’inviter un Allemand…
En août 62, permission en France, …impression d’être complètement décalé, que personne n’avait la moindre idée de ce que nous vivions depuis des mois…et au fond, je n’avais qu’une envie : repartir au plus vite en Algérie.
Avec le recul, je m’aperçois qu’il est resté en moi comme une petite honte secrète, restée enfermée dans le silence pendant tant d’années. Certes, il m'a été donné d'aimer, si follement, si amoureusement, ce peuple algérien, et son si beau pays, mais la question demeure : est-ce que le seul fait d’accepter de faire le Service militaire à cette époque ne voulait pas dire qu’on approuvait, ou qu’on cautionnait une politique qu’en même temps on réprouvait ? Est-ce qu’il n’aurait pas fallu être objecteur de conscience, ou insoumis ? Et cette question ne me quitte toujours pas….…
Il me semble bien que j’ai compris l’inéluctabilité, et la légitimité, de l’indépendance de l’Algérie dès le tout début des « événements », et que j’en ai été partisan sans autre restriction que le refus inconditionnel du terrorisme aveugle.
Et que j’étais convaincu que la plus belle mission de l’armée française était d’être là-bas justement pour préparer cette indépendance.
Et donc je ne voyais pas pourquoi je n’aurais pas joué le jeu de cette armée.
La seule réserve, non négociable, consistait à exclure formellement toute participation, de près ou de loin, à tout ce qui pourrait toucher à la torture.
Le refus de devenir officier (malgré les pressions du genre : « quand on a comme vous un père officier… etc…») était, je crois, ma façon de garder ma liberté intérieure.
Arrivé en Algérie à la fin de la guerre, j’ai eu la chance d’être en accord avec mon unité, qui était clairement contre l’OAS, et qui se donnait comme mission de protéger les Algériens contre cette OAS.
J’ai vraiment cru que nous allions écrire une page belle, enivrante, porteuse d’avenir, celle d’une Algérie enfin indépendante, mais restant en relation étroite avec la France.
Sans doute que je ne savais pas encore que l’Histoire, habituellement, ne sait pas se faire autrement que dans la désolation et le drame…..
Témoignage tiré de :
La génération du djebel, 50 ans après :
"En sortir indemne, certainement pas".

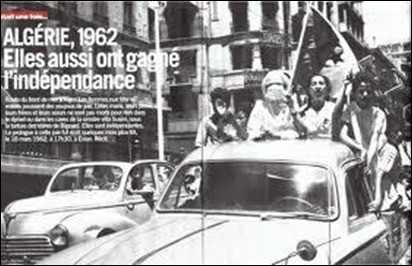












Les commentaires récents