.
![]() Histoire d’un parjure
Histoire d’un parjure ![]()
Comment en effet, en 1830, le peuple algérien, après trois siècles de paix interrompue seulement par des guérillas de tribus et des incursions sans lendemain (et parti, au XVe siècle, d’un niveau certainement beaucoup moins bas que celui de 1872) eut-il pu ne pas atteindre le chiffre qu’il devait retrouver en quatre-vingt-dix ans, dans des conditions de misère et d’oppression qui furent pour lui un handicap écrasant, refoulé ou contenu par une population européenne qui tenait le meilleur de villes et des campagnes? Et comment expliquer, en supposant exact le chiffre absurde de deux millions en 1830, que la population n’ait pu passer de deux à cinq millions entre 1830 et 1870 - comme elle le fit, de 1870 à 1910, en partant d’un pays ravagé et capitonné, à moins d’y voir les effets de notre politique d’extermination?
Le proverbe: « A brebis tondue, Dieu ménage le vent » n’était pas fait pour lui. Ce furent d’autres famines, d’autres épidémies, d’autres expropriations, d’autres exodes, dont les plus importants sont ceux de 1875, 1889, 1898, 1910-1911, les saignées de nos guerres coloniales et des deux guerres mondiales (les unités algériennes étaient réservées aux missions de sacrifice et la guerre de 1914 fut pour la jeunesse de l’Algérie une véritable hécatombe), les répressions comme celle de 1945, qui fit, estime-t-on plus de 40.000 victimes.
Quant aux progrès de l’hygiène, ils ne toucheront le peuple algérien que beaucoup plus tard. Dans les tribus, notre équipement sanitaire brillait par son absence. Loin d’augmenter, le niveau de vie allait baissant; il passait de deux moutons par habitant en 1872 à un mouton pour deux habitant en 1920, de six quintaux d’orge ou de blé par habitant en 1870 à deux quintaux en 1950. Si le refoulement militaire faisait trêve, le refoulement économique se poursuivait, inexorable. Les meilleures terres cultivables, 430.000 hectares de vignes et d’agrumes, se trouvaient pour 98% entre les mains des Européens, qui détenaient les deux tiers de la production végétale totale du pays. Un million de chômeurs, un million de paysans sans terre, un revenu moyen de 16.000 francs contre 450.000 francs à l’Européen, une densité de tuberculose six fois plus élevée qu’en France, ainsi soufflait le vent de Dieu. « Nulle part au monde, écrira en 1934 un journal de l’Algérie française, La presse libre, la vie humaine n’est aussi précaire et aussi misérable. La plus grande masse de ces hommes connaît, résignée et bouche close, une existence tellement faite de privations que des chiens n’en voudraient pas. »
Telle était « l’accommodation » qu’on leur avait promise. Depuis une deuxième « nation en formation » qui renaît des cendres de la première, et Mostafa Lacheraf pourra dire que dans l’Alger de 1950, il n’est pas quarante noms d’algériens pour rappeler ceux de l’Alger de 1830. Mais ce qui était tolérable avec deux ou trois millions d’habitants ne l’était plus pour un peuple qui approchait à grand pas de son chiffre de 1830, et menaçait de sombrer dans « la misère la plus nue, la plus criante du monde » (Réforme, 1959). On lui donnait à choisir entre l’extermination économique, celle de l’Irlande du XIXe siècle (déjà en 1890, le député Mermeix disait que « l’Algérie était l’Irlande de la France »), où la lutte armée - la France, depuis trente-cinq ans, restant sourde à tous les appels pacifiques - c’est-à-dire le risque de cette extermination planifiée qu’il avait déjà subie. Cette déclaration de guerre apparaissait comme une témérité insensée, un défi lancé non seulement à l’armée qui, par les fautes de nos maîtres, était devenue l’une des plus amères du monde. Aucun Dien-Bien-Phu n’était à prévoir. Le monde n’interviendrait pas avant que les sacrifices de ce peuple n’eussent dépassé les limites humainement et politiquement supportables. Soulevés par cet esprit numide de « la mâle et forte ville d’Afrique », comme Froissart appelait l ’Algérie de son temps, les chefs algériens prenaient la décision la plus grave de son histoire. Le 1er Novembre 1954, les clés de fer étaient lancés avec la même détermination que le 26 juillet 1830. Ils roulent encore et ne s’arrêteront qu’à l’heure de la raison ou du désastre.
« ...Tous jusqu’au dernier ».
Ce carnage amena-t-il au moins la pacification du pays? Même pas, puisque en 1871 près de la moitié de l’Algérie était en flammes. « Nous avons brûlé, pillé, ravagé les tribus entre Blida et Cherchell, écrivait le maréchal Canrobert, mais le but, la pacification, est loin d’être atteint ». « La force ne les subjuguera jamais, écrit le général Cler. Semblables aux Suisses, ennemis de Charles le Téméraire, ils ont leurs montagnes et leur pauvreté pour se défendre ». Le résultat le plus certain fut « d’entretenir d’éternelles inimitiés ». La commission nous en avait avertis dès 1833: « En égorgeant sur de simples soupçons des populations entières, nous sommes nos plus cruels ennemis en Afrique... Et nous nous plaignons de n’avoir pas réussi auprès d’eux! » Les exodes qui accueillaient notre arrivée étaient, comme dit Vilot, l’indice sûr de la désaffection d’un peuple. Le jour où nous entrâmes à Cherchell, il ne restait pour nous accueillir qu’un boiteux et un idiot, qui erraient dans les rues désertes comme des reproches silencieux.
L’étranger ne l’ignorait pas. Dans une enquête sur l’Algérie publiée à Londres en 1845, le capitaine John Kennedy écrit: « Si l’Europe ne bouge pas, le nombre et les ressources des Arabes sont voués à l’anéantissement dans un combat courageux, mais sans issue ». Devant la commission e 1872, la conclusion de garante ans d’extermination fut tirée par le chef des Bureaux arabes: « On a razzié, pillé, déporté, séquestré, ruiné les tribus. Des populations entières ont été chassées de leur territoire. La désaffection est générale ». Mais du moins, l’historien Verne, ce fanatique de l’Algérie française, pouvait-il enfin écrire: « Deux millions d’indigènes meurent de faim sur une surface capable de nourrir dix millions de chrétiens ».
Cette fois, c’était vrai. Les chiffres truqués de Clauzel en 1830, lui et ses successeurs, en quarante ans de guerre d’Algérie, en avaient fait une réalité... Mais, on déclara - et on déclare encore - que l’état d’abandon de l’Algérie française en 1872 n’était que l’héritage de la Régence de 1830, et de l’insurmontable paresse arabe... Comment s’écrit l’histoire de l’Algérie française, le rapprochement de deux documents va nous l’apprendre. En 1842, le général Baraguay d’Hilliers, l’exterminateur des tribus du Djebel Edough, proclame dans un ordre du jour à ses troupes: « Vous avez dignement répondu à l’attente de la France. Vous avez enlevé à l’ennemi ses femmes, ses enfants, ses troupeaux; vous avez détruit ses habitations et brûlé ses moissons. Partout vous avez porté le fer et le feu ». Sept ans plus tard, le colonel d’Illiers qui n’avait pas connu l’Algérie de 1830, dans un rapport sur la région ravagée et vidée par les troupes de Baraguay, écrit: « En mettant le pied en Algérie, nous avons trouvé un peuple paresseux et ignorant, un malheureux pays dévasté sans cesse par la main de l’homme et par le feu ». Car « c’est toujours le vainqueur qui écrit l’histoire, défigure sa victime et fleurit sa tombe de mensonges », écrit Brecht dans Le Procès de Lucullus. C’est bien pourquoi, prophétiquement, Hamdan, en affirmant solennellement à la face de l’histoire ce qu’était sa nation, savait et disait qu’il remplissait un devoir sacré qui valait à ses yeux le sacrifice de sa fortune, de sa vie, de celle des siens. Ce carnage n’est-il pas d’ailleurs la meilleure preuve de ce qu’il affirme? Supposer que l’armée la plus forte d’Europe n’ait pu venir à bout de deux d’Algériens, parce que désarmés en quarante ans de combat d’extermination est une absurdité. Prétendre qu’au bout de ces quarante ans, le chiffre de la population n’avait pas baissé l’est tout autant. En réalité, une fois réduit à deux millions, le peuple algérien dut renoncer à la lutte ouverte et attendre d’avoir presque retrouvé le chiffre de 1830 avant de la reprendre.
Si l’on tient compte de son taux d’accroissement moyen de 1870 à 1930, environ un million tous les quinze ans, ce n’est pas huit, neuf, dix millions d’habitants que le peuple algérien a perdu de 1830 à 1872. Pourtant le problème fut un problème moral et non un problème comptable . Ce n’est pas le nombre de millions qui est en jeu: « Des généraux illustres n’ont pas hésité à proposer l’extermination d’une nation entière en se basant sur un petit nombre d’habitants, écrit Hamdan. Même en admettant que ce nombre ne dépasse pas deux millions comme ils l’ont dit, ne serait-ce pas un crime aux yeux des peuples civilisés?... Nous ne sommes pas qu’un peuple d’esclaves infortunés et impuissants; pourtant les Algériens sont aussi des hommes. » Et il ajoute: « Les calamités du XVIe siècle se renouvelleraient-elles au XIV ème siècle? »
Le sort des Indiens d’Amérique hantait alors les Algériens. Que répondait-on à cette question angoisse? Ecoutons un scribe de Clauzel, ce noble précurseur de l’Algérie franquiste: « On a reproché à l’Espagne sa cruauté en Amérique. Pour le philanthrope, la prise de l’Amérique a été un bonheur. Or, l’Algérie est une nouvelle Amérique. Mieux que nous, l’Espagne pourrait européaniser l’Algérie. » (C’est un fait que la mentalité de reconquista de l’élément espagnol en Algérie a contribué à y durcir notre politique et y aggraver l’inimitié) A la même question, voici ce qu’osera répondre en 1835, devant la Chambre, le ministre de l’Instruction publique: « Qu’ont fait les Puritains en Amérique du Nord au XVIe siècle? Ils ont combattu la race rouge, l’ont laborieusement refoulée, lui ont enlevé le sol pied à pied. Les populations arabes ne résisteraient certainement pas mieux... Certes, ils faut procéder avec plus de mesure... Mais il ne faut pas croire que, dans les entreprises du XVIe siècle, il n’y ait rien à imiter. » Le général Duvivier répond à cette créature du roi: « Croyez-vous que la postérité ne vous demandera pas de compte, comme à Cortez et à Pizarre? Eux, au moins, avaient réussi. Si nous ne réussissions pas, à quelle exécration serions-nous voués! Nous libérons les nègres et nous exterminons tout un peuple sans même avoir un but arrêté. » Le général de Brossard ajoute: « Devant les populations détruites la terre couverte de ruines, les champs tendus incultes, il faut le dire, France devra rendre raison ».
Que ceux qui se refusent - et je les comprends - à croire à pareil génocide, lisent le discours prononcé le 4 juillet 1845 par la maréchal de Castellane. « Par ce système de tout détruire (d’avril à juin, on a porté le massacre de Ténès à Orléansville) en brûlant, détruisant, enlevant les femmes et les enfants, nous allons grand train. Mais cette guerre ne finira jamais. C’est une éternelle partie de barres. L’Algérie coûtera sans doute beaucoup à la France. Il faut se résigner ». Que pouvait faire, hélas Castella contre l’implacable dictature du criminel de guerre installé aux Tuileries?
Mais la note la plus cynique du parjure s’est donnée par le « libéralisme humanitaire » de Napoléon III. « Le dieu des armées, proclame-t-il à Alger en 1860, n’envoie aux peuples la guerre que comme châtiment ou comme rédemption. Dans nos mains, la conquête ne peut être qu’une rédemption. La providence nous a appelés à répandre sur cette terre de bienfaits de la civilisation. Or, qu’est-ce que la civilisation? C’est compter la vie de l’homme pour beaucoup, élever les Arabes à la dignité que la providence y a enfouis et qu’un mauvais gouvernement laisserait stériles: telle est notre mission ».
Et Napoléon, solennellement, renouvellera la caution de la France aux proclamations de 1830, ces « monuments ». « La Restauration, dira-t-il en 1863, a promis aux Arabes de respecter leur religion et leurs propriétés. Cet engagement solennel existe toujours pour nous et je tiens à honneur d’exécuter ce qu’il y avait de grand et de noble dans ces promesses. L’Algérie n’est pas une colonie mais un royaume arabe... » Il reviendra sur les proclamations dans son appel aux Arabes du 3 mai 1865. « Lorsqu’il y a trente-cinq ans la France a mis le pied sur le sol africain, elle n’est pas venue pour détruire la nationalité d’un peuple, mais au contraire affranchir ce peuple... Néanmoins, pendant les premières années, impatients de toute suprématie étrangère, vous avez combattu vos libérateurs... Deux millions d’Arabes ne sauraient résister à quarante millions de Français. Une lutte de un contre vingt est insensée! » Nous entendons alors notre Machiavel donner toute la mesure de ses talents: « Vous m’avez d’ailleurs prêté sacré, vous obligeant à garder vos engagements (Coran, chap. VIII. Du repentir, verset 4). » Le cercle de l’imposture se refermait sur le plus impudent des tours de clefs!
Le monarque confirmera cette bonne conscience et celle de la France dans sa proclamation du 7 juin 1865 à l’armée d’Afrique: « L’Afrique a été une grande école pour l’édification du soldat... il y a acquis ces mâles vêtus, senti son âme s’ouvrir à tous les nobles sentiments. Jamais dans vos rangs la colère n’a survécu à la lutte, aucune haine..., aucun désir de s’enrichir de ses dépouilles. Vous êtes les premiers à tendre aux Arabes une main amie. Soldats de Mouzaïa, des Zaatcha de Constantine... vous avez bien mérité de la patrie! » serment et votre conscience, comme votre livre.
« ... La pure vérité ». Comment, le peuple français d’alors, celui de Hugo et le Michelet, a-t-il pu se laisser imposer quarante ans de guerre d’Algérie? La réponse est sous nos yeux. Depuis six ans, le même problème de nouveau se pose à la France dans les mêmes termes, obscurci par les mêmes équivoques et les mêmes interdits, enlisé dans le même marécage d’intérêts, de corruption et de répression. Si les chiffres qui circulent dans le monde (et que les Français sont les seuls à ignorer) sur les victimes de cette guerre sont exacts, si on tient compte des taux de moralité qui sévissent dans cet univers concentrationnaire de « regroupés », « hébergés », évacués ou internés, le rythme de destruction est comparable à celui du siècle dernier. Ainsi, d’un siècle dernier. Ainsi, d’un siècle à l’autre, le sacrifice d’un million d’Algériens tous les cinq ans serait la rançon permanente de cette guerre. La guerre d’Algérie s’accompagnait en France d’une vaste entreprise de camouflage, de chantage et de diversion. C’était le deuxième front celui de la subversion, celui des « Bédouins de Paris ».
La presse en était le premier objectif. En 1834, elle se retrouvait pratiquement muselée moins libre que sous la Restauration. Le décret impérial du 17 février 1852 lui appliquera le nouveau bâillon. Armand Carrel écrivait alors dans le National: « Un dictateur militaire qui détruit la liberté de la presse chasse d’abord à coups de pieds les messieurs du Palais Bourbon, il est comme anarchistes, mais comme incapables bavards et brouillons. La liberté de la presse et celle de la tribune ne se séparent pas. Elles ne peuvent que vivre ou succomber ensemble. « Et il ajoute: « Pendant trente ans de guerre, la presse a été enchaînée au nom d’un principe qui a dévoré des générations entières. »
La vérité, réduite au silence, laissait place nette au mensonge: « Cette presse d’Algérie écrit le maréchal de Castemma, en 1838, est d’autant plus dangereuse qu’elle publie en France des choses qui se passent trop loin pour que l’opinion puisse faire justice de ses mensonges. Le gouvernement se laisse influencer par cette presse... Quand je lui parle des exactions, il en est fâché et ne prend pas de mesures: il se plaint de ce qu’on n’obéit pas. » La note officielle, c’était celle que donnaient, par exemple, dans La Revue des Deux mondes, les études de Jules Duval, qui faisaient autorité: « En aucun temps, en aucune colonie, les peuples conquis n’ont été traités avec une pareille mansuétude. »
Les chefs militaires intervenaient de tout le poids de la terreur dont ils disposaient pour influencer l’opinion. En débarquant à Alger en 1830, le maréchal Clauzel menace de « punitions exemplaires » (ces deux mots étaient redoutables sur les lèvres du personnage) ceux qui osent répandre de faux espoirs d’indépendance. « Les plaintes des Algériens n’excitent en nous qu’un redoublement de rage », constat d’Aubignosc. Et lorsque les Maures d’Alger adressent une supplique au roi, ils lui disent qu’elle ne portera aucune signature, car « ce sont de nouvelles fortunes contre ceux qui écrivent des protestations ».
Les menaces sont à peine voilées: « Faisons savoir à l’armée, écrit le Drapeau blanc, ce que les libéraux pensent d’elle, pour la mettre à même de leur témoigner, au besoin, sa reconnaissance. » Pour Clauzel, ceux qui discutent la guerre d’Algérie sont des traîtres et des lâches. « Il y a des amis de la paix, dit-il, la race des peureux est éternelle. » Ceux qui parlent de l’indépendance de l’Algérie, « cette chimère ambitieuse d’une race perfide », sont « des hommes sans foi et sans patrie, des âmes vénales, qui égarent l’opinion et donnent une sorte de vertige au gouvernement lui-même, et cela après les récentes manifestations enthousiastes en faveur de l’Algérie: on ose maintenant déclarer hautement la nécessité de l’abandon! » (L’Afrique française, 1837).
Les députés sont, eux aussi, menacés. Au maréchal de Castellane lui-même, le président du Conseil reprochait de compromettre son uniforme en dénonçant l’extermination; Castellane répondra qu’il parle en homme libres. Il le pouvait: il était pair, marquis et maréchal. Après le débat de juillet 1845, où certains osèrent douter des vertus de l’extermination, Bugeaud, furieux, écrivit au gouvernement: « C’est à bon droit que je puis appeler déplorables ces interpellations. Elles vont produire sur l’armée un pénible effet ». Suit cet argument; « C’est cette philanthropie qui éternise la guerre d’Algérie et l’esprit de révolte. » Sémerie, député ultra, renchérit: « L’impossibilité de gagner la guerre? Je vais vous dire où elle est: elle est dans cette Chambre! »
Bugeaud terrorise l’opinion. Le général de Brossard flétrissant ses méthodes, Bugeaud tentera de le faire condamner pour corruption. Brossard est acquitté. Au procès, son avocat révèle que Bugeaud a touché d’Abd-el-Kader un pot-de-vin de 150.000 francs (près de 100 millions de nos anciens francs). Bugeaud, tireur d’élite qui ne pardonnait pas, veut traîner l’avocat sur le pré, comme il l’avait fait en 1834 avec le député Dulong, qui avait osé dire à la tribune que l’obéissance militaire avait des limites et « devait s’arrêter à l’ignominie ». Des dizaines de milliers d’ouvriers parisiens avaient assisté aux funérailles de Dulong: Ce fut leur protestation muette contre la guerre; vingt mille hommes en armes contenaient la foule; deux pièces d’artillerie, mèches allumées, suivaient le cortège.
Les « intellectuels » étaient suspects par essence. Pour l’Afrique française, c’est « une race dégradée et anti-française de folliculaires ». Ces gens-là, écrit Armand Hain, en 1833, sont « les étouffeurs du patriotisme. Ils font marcher la nation à grands pas vers sa décadence. Heureusement, Alger est enfin le salut de la France qui se déploie sur elle en arc-en-ciel, sur l’horizon de la patrie qui se rembrunit sans cesse. » Dès 1830, était mis en place le mécanisme terrorise du silence et du mensonge, en même temps que ce « lobby » « algérien dont Thiers et Clauzel étaient l’âme. Le peuple algérien devait souffrir et mourir en silence. Hamdan avait beau s’écrier: « Il n’est au pouvoir de personne de forcer au silence! », on sut l’y forcer: annoncé, le deuxième volume de son Miroir ne fut jamais publié.
Pris entre d’autres, voici un exemple de ce terrorisme de l’information. Le 23 janvier 1835, un communiqué est publié dans l’officiel Moniteur algérien. Une de nos colonnes, après avoir détruit une vingtaines de villages hadjoutes pour se mettre en appétit, pénètre chez les Mouzaïa: « Le résultat a été le châtiment des tribus insoumises. Leurs douars ont été détruits, beaucoup de blé et de bestiaux enlevés. Nous avons pu voir un pays encore jamais exploré. Cette partie de la plaine est très riche, très fertile et bien cultivée. » Relatant l’affaire à son tour, le correspondant de guerre du Toulonnais écrit le 25: « On croirai vraiment assister à la conquête du Pérou par les Espagnols. Parce que les Hadjoutes veulent l’indépendance, faut-il se conduire en vandales?
Les Mouzaïas, la plus belle des tribus que nous avons détruites, se trouvaient au milieu d’un vaste jardin d’oliviers et d’orge. Le feu y fut mis et le bruit des flammes se mêlait aux cris des femmes et des enfants. « Rien, dans ces lignes, qui ne confirme le communiqué. Pourtant, le 27, le Moniteur se déchaîne, brandissant l’inévitable chantage à « nos braves soldats »: « Il fallait retracer ces scènes imaginaires (sic) pour avoir le droit d’insulter nos braves soldats... Certes, il a fallu incendier de misérables douars. Mais pense-t-on qu’on pourra faire des exemples avec de l’eau de rose? On est saisi d’indignation et de dégoût devant ces diatribes, et on doit regretter la légèreté de la presse française. Il faut avoir perdu toute pudeur pour faire un tableau aussi dégradant pour l’honneur de nos armes et notre patrie, aussi faux que malveillant. Le Toulonnais ne fera pas mal de choisir comme correspondant parmi nous un cerveau moins malade et un coeur plus français. Qu’il se présente, Le Toulonnais à la main, et il dira au retour, si toutefois, il a encore la tête sur les épaules, comment il aura été reçu et la récompense que sa philanthropie lui aura méritée. » Je ne sais s’il garda sa tête, mais Le Toulonnais rendra dans le rang.
La vérité est qu’il fallait veiller au grain, car cette guerre d’Algérie n’avait jamais cessé d’être impopulaire. Même à ses soldats, Bourmont, avant d’embarquer, n’osa parler dans sa proclamation que de libérer un peuple opprimé. Les fêtes organisées par les préfets pour célébrer la prise d’Alger provoquèrent des troubles, à Bordeaux en particulier. Aux élections, qui eurent lieu au moment de la conquête, Alexandre de Laborde, chef de file des « anti-algéristes » fut triomphalement élu à Paris avec quatre fois plus de voix que son adversaire ultra. D’Haussez, le ministre de la Marine (considéré comme l’organisateur de l’expédition), se présenta devant cinq collèges et subit cinq échecs. Mais les pouvoirs élus au nom de la paix s’empressaient de s’enfoncer dans la guerre.
Ce n’est que par suite d’une erreur malencontreuse que les procès-verbaux de la commission de 1833 furent publiés. Le gouvernement s’en irrita. Des huit commissaires, un seul avait donné des raisons favorables à notre maintien en Algérie. Lesquelles? L’Algérie serait une école où nos soldats s’exerceraient aux dangers des combats, et un moyen de débarrasser les bagnes d’une « population qui croupit dans les vices ». Face à ces considérations élevées, quelles étaient les raisons des sept autres? Les voici par ordre: 1e conquête fâcheuse, 2e legs onéreux, 3e fardeau pour la France, 4e source d’énormes sacrifices, 5e nous coûtera des flots de sang et notre avenir, 6e lourde charge, 7e désavantageux. Et pourtant, la commission conclura à l’occupation. Pourquoi? Parce que, dit-elle, c’est une question d’honneur, une nécessité de la paix intérieure, et que l’indépendance soulèverait haines et passions (« bien que, plus tard, la nation nous saurait gré de notre courage », remarque un des commissaires). La démission de ces parlementaires devant le roi, ses ultras de l’Algérie française et les intérêts qu’ils représentaient enlisera donc leur pays dans « une conquête fâcheuse ». Il faut éclairer l’opinion », concluait la commission: on ne pouvait rien faire, « l’opinion publique » n’était pas prête! Pas prête, cette opinion qui vote toujours pour la paix?
Le stratagème du dernier quart d’heure facilitait ces dérobades. En juillet 1830, on affichait en France la proclamation de Bourmont qui apprenait à des Français avides de paix: « Tout le royaume d’Alger sera probablement soumis au roi avant quinze jours, sans avoir un coup de fusil de plus à tirer. » Les semaines de Bourmont furent des siècles, qui, de « page tournée » en « tiraillade », et de dernier en dernier quart d’heure, nous mène au tout dernier, celui d’aujourd’hui, où je lis enfin que, face à une tourbe de 8.000 tueurs fellagha, notre armée de 600.000 hommes s’honore en outre de 220.000 harkis et auxiliaires musulmans. Allons, cette fois-ci, c’est bien fini, c’est vraiment le dernier! « Chaque année, déclarait en 1845 le maréchal de Castellane à la Chambre des Pairs, nous exprimons le voeu que la pacification prenne fin. Et quand on nous annonce à la tribune, avec beaucoup d’aplomb, que la pacification est complète, quelque événement ou embuscade vient aussitôt donner un démenti ». « Voilà une de ces guerres, prophétisait Le Pour et le Contre en 1830, où trente victoires égaleront une défaite. » « Un succès ne termine rien, écrivait Poujoulat trente ans plus tard. Il faut toujours avoir l’arme au bras et toujours triompher. » C’est que la victoire répond ici à la définition de Von der Goltz: « On vainc l’ennemi non pas en le détruisant lui-même, mais en détruisant l’espoir qu’il a de vaincre ». Alors, où est le vainqueur?
Il est vain de prétendre limiter cette guerre dans le temps et dans l’espace. Une guerre d’Algérie ne peut être qu’une guerre avec le Maghreb tout entier. Nos maîtres le savent bien. Dès la prise d’Alger, leurs journaux écrivaient: « Pourquoi s’arrêter à Alger? Et Tunis, et Maroc? Il faut que l’oeuvre soit complète. » (L’Apostolique, juillet 1830). La deuxième proclamation de Bourmont s’adressait, non pas seulement aux Algériens mais aux « tribus maghrébines ». En 1844, les Kabyles écrivaient à Bugeaud qu’ils reculeraient jusqu’à Tunis s’il le fallait, pour y lever de nouvelles troupes. « L’armée tunisienne est composée des nôtres, disaient-ils, nous serons soldats comme eux. »
« Si encore, au-delà des frontières de l’Algérie, les partisans de l’extermination ne devaient pas retrouver d’arabes, écrivait alors le général de Bussy, ils expliqueraient cet horrible massacre, mais nous sommes destinées à les avoir partout devant nous. » Et, découragé, le général Esterhazy concluait en 1872 que « la Tunisie, le Maroc, le Sahara seraient éternellement de vastes foyers de résistance », faisant « écho au général Paxhans qui déclarait à la Chambre, après la prise d’Alger, que c’était là un simple germe qui bientôt pousserait d’Alger à Tombouctou, et de l’Egypte à Gibraltar. « Eh bien, nous aurons un continent spacieux », répondrait Dupin.
Les ultras qui rêvaient d’aller détrôner l’empereur du Maroc ou le Bey de Tunis, après le dey Hussein, ne manquaient pas d’une certaine logique. De cette logique de paranoïaque qui échafaude un monde parfaitement cohérent sur un défi aux réalités et aux lois naturelles, et qu’on retrouve à l’origine de tous les forfaits, ceux de Pizzare, de Cromwell, de Hitler ou des responsables d’Hiroshima. En 1830, il fallut des démonstrations navales pour obliger Tunisiens et Tripolitains à la neutralité. Avec le Maroc, ce fut, de 1830 à 1903, une guerre plus ou moins froide, coupée de brusques flambées, puis à partir de 1903, une guerre de conquête qui s’acheva, ou plutôt se transforma en 1934. (Les dernières tribus se soumettaient en mars 1934, les premières émeutes de Fès éclataient deux mois plus tard). De 1872 à 1903, la guerre d’Algérie s’étendra vers les confins oranais (où Lyautey inaugurait sa méthode du « Vilebrequin » qui succédait dans le vaste garage de notre mécanique punitive à « la compression par la répression » de Clauzel, à la tache d’huile, au ruban de fer ou à la meule) vers le Sahara et la Tunisie. Après la trêve de la guerre mondiale, les soulèvements constantinois et marocains, la lutte des fellagha tunisiens débouchaient le 1er Novembre 1954 sur la seconde Guerre d’Algérie. Le premier cercle de la guerre franco-maghrébine se fermait ainsi au bout de cent trente-trois ans d’hostilités ininterrompues. S’ouvrait le deuxième cercle auquel la nouvelle solidarité arabe et africaine promet un rayon d’action enfin à la mesure de nos va-t-en-guerre.
« Comme autrefois dans votre pays ».
La légende au dernier quart d’heure ne va pas sans le mépris de l’ennemi. Les Algériens, dès 1830, perdirent soudain toute face humaine. Dès lors, ils ne seront plus qu’une « tourbe indisciplinée de tueurs armés de yatagans et de couteaux », comme disait le colonel de Prébois. Le couteau surout, cette arme sans blason, était honni. On s’étendait avec une complaisance sadique sur les forfaits terroristes, pour donner bonne conscience « aux instruments de la vengeance divine », comme disait l’archevêque de Paris. « Tout Arabe, disait Hain, est un bourreau par essence et par vocation. » « A ces forbans rapaces et inexorables, écrivait Le Moniteur, la civilisation est apparue avec son esprit de douceur, et d’affectueuse sympathie. » Une victime française pèsera aussi lourd sur la balance de l’indignation que 300 ou 400 victimes algériennes. Et parfois, hélas! sur celle des représailles.
Ce mépris de l’adversaire s’exprima sans retenue pendant la famine de 1868: « S’entre-dévorant entre eux, ils firent baisser leur nombre d’un cinquième », affirmait alors Aristide Bérard. En réalité, il n’y eut que de très rares cas d’anthropophagie, dus à des égarés devenus fous de misère. Il y en eut d’autres au retour de la première mission Flatters; ils furent le fait des Français: les Algériens de la mission avaient su y résister. Ce mépris datait de loin, de l’intarissable légendaire qui avait cours sur les pirates d’Alger. La captivité de Saint-Vincent de Paul (une des pièces de sa béatification) tira des larmes à des générations d’âmes sensibles. Larmes gratuites car cette pieuse captivité (dont nos tribunaux accablent encore les patriotes algériens!) n’a jamais existé que dans la fertile imagination du bon Saint. Quand on lit des témoins objectifs, comme le Danois Leweson, il faut bien convenir que les esclaves chrétiens à Alger étaient beaucoup mieux traités que les esclaves maures à Malte, Toulon ou Cadix, où les conditions de vie étaient effroyables. Des raisons politiques inspirées de la Ligue, puis de la Congrégation, les intérêts d’ordres religieux spécialisés présidaient à ces contes de loup-garou. L’abbé Poiret, dans son savoureux récit de voyage, nous apprend qu’à son passage en 1785, la plus grande partie des « esclaves chrétiens » d’Alger étaient des soldats espagnols qui désertaient d’Oran au péril de leur vie (repris, il étaient décapités), préférant de beaucoup l’esclavage chez les Maures d’Alger à la « liberté au milieu des leurs. Louis XIV dut publier deux ordonnances interdisant aux mousses français de débarquer à Alger (une fois à terre, ils refusaient de rembarquer) et obligeant les négociations français à quitter Alger au bout de dix ans de séjour (la plupart préféraient finir leurs jours au milieu des infidèles). Les Musulmans tenus en esclavage chez les Chrétiens étaient d’ailleurs beaucoup plus nombreux: à Malte, Bonaparte libéra près de trois mille galériens du seul bagne de la Valette, et il y en avait d’autres. Dans le même temps, les bagnes d’Algérie ne comptaient que 750 Chrétiens, dont 64 Français.
Thomas Shaw qui passa cinq ans dans l’Alger du XVIIIe siècle, nous apprend qu’il y avait dans cette ville de 117.000 habitants plus de 30.000 renégats. Avec leur famille, il en formaient donc la majorité. (Les Musulmans n’encourageaient pourtant pas des conversions qui leur faisaient perdre l’espoir d’un rachat). A la prise d’Alger, il n’y eut pas un rénégat pour rentrer en France. Les quelques Françaises qui se trouvaient dans la ville, en dépit de toutes les pressions, préférèrent rester avec leurs époux ou leurs époux ou leurs maîtres et même les suivre dans leur exode. La leçon était cuisante pour les civilisés venus apporter « l’éclat lumineux de la délivrance ». Mais pourquoi ces exilés seraient-ils rentrés dans un pays où souffraient quatre millions de mendiants, quatre millions d’indigents et quatre millions de salariés (qui gagnaient de 30 centimes à 1 franc 50 par jour), où 27.000 communes sur 38.000 n’avaient pas d’école, où plus de la moitié des soldats étaient illettrés, où la classe ouvrière était massacrée dès qu’elle élevait la voix, où la détresse était telle que les enfants trouvés atteignaient par an le chiffre incroyable de 130.000?
Les témoignages sont formels. En 1830, tous les Algériens savaient lire, écrire et compter, « et la plupart des vainqueurs, ajoute la commission de 1833, avaient moins d’instruction que les vaincus ». Les Algériens sont beaucoup plus cultivés qu’on ne croit, notre Campbell en 1835. A notre arrivée, il y avait plus de cent écoles primaires à Alger, 86 à Constantine, 50 à Tlemcen. Alger et Constantine avaient chacune six à sept collèges secondaires, et l’Algérie était dotée de dix zaouia (universités). Chaque village ou groupe de hameaux avait son école. Notre occupation leur porta un coup irréparable. Du moins, les avions-nous remplacées? Mgr Dupuch nous répond en déplorant qu’en 1840 il n’ait trouvé que deux ou trois instituteurs pour toute la province d’Alger. En 1880, on ne trouvait encore que treize (je dis bien treize) écoles franco-arabes pour toute l’Algérie. « Nous avons, dit notre grand orientaliste Georges Marçais, gaspillé l’héritage musulman à plaisir. »
Telle était la barbarie de ces barbaresques. Certes, les moeurs parfois frustes d’un peuple resté à l’écart, certains traits orientaux, le comportement expéditif de leur administration, leurs routines, leur indifférence au confort, leur superstitions, leur pointilleuse dévotion choquaient nos sensibilités occidentales. Mais l’Algérie avait sa culture. Cet héritage méritait d’être préservé. « Le propre d’une civilisation n’est-il pas de savoir en accepter une autre sans la détruire? » demandait Hamdan. En fait, ce fut une véritable extermination culturelle.
La commission d’enquête met ici les points sur les i: « Nous apportions à ces peuples les bienfaits de la civilisation, et de nos mains s’échappaient les turpitudes d’un ordre social usé. Nous avons débordé en barbarie les Barbares qu’on venait civiliser. » La discipline turque leur apparut sous nos pouvoirs comme une nostalgique oasis. Rovigo est aussi brutal: « Notre seule supériorité sur eux, c’est notre artillerie, et ils le savent. Ils ont plus d’esprit et de sens que les Européens, et on trouvera un jour d’immenses ressources chez ces gens-là, qui savent ce qu’ils ont été et qui se croient destinées à jouer un rôle ». « Ce qu’il faut, dit Tocqueville, c’est donner des livres à ce peuple curieux et intelligent. Ils savent tous lire. Et ils ont cette finesse et cette aptitude à comprendre qui les rend si supérieurs à nos paysans de France ». A la commission d’enquête qui lui demande ce qui manque le plus aux Maures d’Alger, Bouderba répondra: « Des journaux ». Suivant le général Pellissier, avant notre arrivée, « Alger était peut-être la ville du monde où la police était le mieux faite... Avec nous, les vols, naguère presque inconnus, se multiplient dans des proportions effrayantes ». Laurence, directeur de la Justice nous dit: « L’Arabe tue son ennemi, il ne le détruit pas. Ne parlez pas de dévastations. Il les ignore. Un chose qu’on peut nous reprocher, c’est d’avoir importé en Algérie cet usage barbare, tradition sauvage de nos grandes guerres ».
Une forme de mépris plus subtile, mais beaucoup plus dangereuse refusera au peuple algérien rien toute existence nationale. La calomnie se fait collective. En disant que l’Algérie n’est pas et n’a jamais été une nation, on tente d’atomiser « en poussière d’individus », de robotiser « en machines agricoles et contribuables » un peuple qu’on a sorti du néant et qu’on a donc le droit d’y renvoyer. On ne peut exterminer ce qui n’existe pas. Ces mots-là sont la clef des charniers. Hamdan le savait. Son Miroir répète dans une adjuration pathétique, comme s’il prévoyait le danger qu’ils couraient: « Mon peuple est une nation d’âmes » - et l’âme d’une nation. En 1860, quand Clément Duvernois écrit « qu’il admet l’Arabe-individu, mais que l’Arabe-peuple est mort et bien mort », il ajoutera très logiquement que « les Arabes seront supprimés en tant que nationalité jusqu’au jour où l’armée française abandonnera le sol algérien... »
En 1830, nier l’existence de la nation algérienne eût semblé absurde. L’idée n’en vint qu’avec les progrès de l’extermination: elle la justifiait. Et pour cela, on ira jusqu’au ridicule. Des historiens comme Augustin Bernard ou Esquer, pour nous prouver que l’Algérie n’était pas une nation, nous diront qu’elle nous doit jusqu’à son nom. L’argument est spécieux et l’erreur est fâcheuse. En 1830, on disait la Régence comme on disait la Porte, ou le plus souvent le Royaume d’Alger, comme on disait le Royaume de Naples, de Tunis, de Mexico ou de Maroc. Et même le mot Algérie, s’il n’était pas courant, était loin d’être inconnu (voir les Mémoires d’Apponyi). Les termes « nation algérienne », étaient couramment employés. En Allemagne, l’Algérie se disait « der algarische Staat ». Sans remonter au début du XIVe siècle qui vit le premier traité entre la France et le roi Khaled ou même aux traités de Louis XIV entre « l’Empereur de France et le Royaume d’Alger » pour « la paix et le commerce entre les deux royaumes », le très important traité de 1802 (1er nivose, an X) reconnaissant que « l’état de guerre sans motif et contraire aux intérêts des deux peuples n’était pas naturel entre les deux Etats », et rétablissant avec « le gouvernement algérien » les relations « politiques et commerciales », fait mention de l’ « Algérie », en sept lettres. Le traité fut confirmé en 1814 par Louis XVIII, pour « la paix entre les sujets respectifs des deux Etats ». Cette reconnaissance diplomatique e la nation algérienne par l’Angleterre, les Etats-Unis, et les autres, aussi bien que par la France, ne faisait que constater l’existence et l’unité d’un Etat qui connaissait ses actuelles frontières depuis des siècles. Sur ce point, les anciens voyageurs de la Régence, Poiret, Peysonnel, Shaw ou Laugier, sont tous d’accord. Il n’en est pas un pour voir que la Régence ait eu alors moins de réalité que le Maroc ou la Tunisie, sinon pour constater qu’elle était la plus considérable des puissances barbaresques. Ceux, qui, pour mieux nier aujourd’hui la nation algérienne, simulent quelque objectivité en voulant bien admettre que le Maroc et la Tunisie existent, étaient les premiers naguère à douter de l’unité et du bien-fondé de ces nations. L’Algérie existait dans ses frontières avant l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, la Norvège ou l’Irlande - pour ne parler que de l’Europe occidentale.
On tente encore de faire de l’Algérie une ancienne colonie turque. Mais le doulatli et l’odjak algériens, depuis le début du XVIII siècle, ne dépendaient pas plus de la Porte que l’empereur germanique ne dépendait du pape. Le doulatli était partout reconnu comme souverain. En réalité, les Turcs étaient les « portiers » de l’Algérie - et les moins coûteux qu’il se pût trouver. On oublie trop que les Algériens, voisins des Espagnols, furent pendant des siècles obsédés par l’angoisse de subir le sort des Guanches et des Caraïbes. Ximenes, le cardinal d’Espagne, leur en avait donné un avant-goût en 1509, lors de la prise d’Oran: il y fit brûler et égorger les Maures par milliers, pendant qu’il se recueillait en son oratoire, remerciant le Seigneur des Armées de ce triomphe de la Croix sur le Croissant. Le célèbre Cortez, l’ange exterminateur des Indiens d’Amérique, était un des chefs de l’armée d’invasion que Charles Quint lança contre Alger trente ans plus tard. C’est pour se protéger contre cette effroyable menace que les Maures, qui n’avaient pas oublié les horreurs de la Reconquista, firent appel à la marine turque. Ils n’étaient pas marins et l’étendue de leurs côtes les ouvrait sans défense aux incursions maritimes.
En 1572, devant une nouvelle menace, ils demandèrent au roi de France Charles IX de les « recevoir en sa protection » Charles IX décida de leur envoyer son frère, le duc d’Anjou et lui manda des instructions tout à fait pertinentes: « ... Qu’il ne leur soit fait aucun déplaisir en leurs mosquées et religions, ni en leurs personnes et biens. » Parlant du doulatli de l’époque, « il faut, ajoute-t-il, une fois la menace espagnole écartée, protester de lui rendre son pays » - et « le gracieusement traiter » pour pouvoir se retirer sans dommage, « dextrement »... « comme il est bien mal aisé qu’autrement il se puisse faire, vu l’insolence de l’homme de guerre français, lequel se rend insupportable en pays de conquête. » Finalement, les Algériens hésitèrent, les Turcs aussi. Le projet n’alla guère plus loin. Quelques mois, plus tard, le duc d’Anjou poussait le roi au massacre de la Saint-Barthélemly, montrant que sa foi était tout aussi « ardente » que celle du cardinal d’Espagne. « Cette calamité du XVIe siècle », que les Algériens redoutaient tant de l’Espagne, devait, deux siècles et demi plus tard, leur venir de ceux que, jusque là, ils tenaient pour leur meilleurs amis parmi les Chrétiens, et qu’ils avaient sauvés de la famine aux temps de la République.
Certes, l’Algérie était alors un ensemble oriental et médiéval de démocratie communaliste, de normadisme féodal et de théocratie maraboutique, que maintenait et défendait, contre un monde hostile et tout proche, un Etat encadré par une oligarchie militaire (oligarchie incorporée au pays, les Coulouglis, les Maures et même les Juifs en étant souvent les vrais maîtres). Elle ne correspondait pas à tous les aspects de notre conception de la nation; mais nombreuses étaient alors les nations dont la structure n’était guère plus cohérente. Bien peu, en tout cas, possédaient cette ferveur nationale, dont, depuis cent trente ans, le peuple algérien nous donne un témoignage peut-être unique au monde. Avant 1830, Jouffroy écrivait dans une série d’études publiées dans Le Globe: « L’histoire n’offre aucun autre exemple d’une nationalité aussi opiniâtre et aussi persévérante ». Shafer, dans ses souvenir sur la Régence, l’avait déjà noté: « Telle est l’emprise de ce sentiment national, écrivait-il, que mes domestiques m’abandonnent d’un seul coup quand leurs pays les appelle. » La commission de 1833 souligne « leur amour de l’indépendance, leur caractère éminemment national », qui prenait parfois des formes très imprévues: « Le numéraire a disparu, poursuit la commission. L’argent qu’ils gagnent sur nos marchés n’y revient jamais. Il est employé à acheter les armes et de la poudre pour lutter contre nous. » Même nos ultras (Armand Hain convient que « les Maures ont toujours été constitués en corps de nation ») et nos généraux de la conquête devront le reconnaître. Et au maréchal Canrobert qui déclare, décourage, qu’on ne les subjuguera jamais », le général Montagnac répond qu’une nation comme l’Algérie ne perd jamais sans regret son indépendance ». « Chez eux, dit Bugeaud, tout est guerrier, de l’enfant de quinze ans au vieillard de quatre-vingts. Chaque tribu est un camp prêt à combattre, et le pays sera toujours disposé à suivre tous les Bou-Maza qui se présentent. » La « pacification » achevée, en 1872, le général Esterhazy reste sans illusions: « Malgré la pression de l’armée et des colons, le résultat est négatif. On invoque des causes religieuses. Mais les Romains, en six cents ans, n’ont pas réussi à les assimiler. Ce qui est en cause, c’est l’esprit d’indépendance. » Expression de cet indomptable « esprit numide », le cri de Si Hamdan « Nous sommes une nation!), dès 1920, le peuple algérien le reprendra et de plus en plus fort, sitôt qu’il sentira ses forces lui revenir, derrière ses barreaux, et en dépit d’une répression policière sans merci. Ce cri, que l’on entend si bien dans l’ouvrage de Robert Davezies, Le Front, ce cri, sachons-le, nous ne le ferons plus jamais taire. Napoléon III lui-même, dans ses moments de lucidité, saluera « cette nation guerrière et intelligente... qui renfermait pas encore propres à constituer une démocratie viable ». Et c’est vrai que, pas plus que la France de 1860, la Régence de 1830 n’était une démocratie. Mais c’était une nation.
Les Algériens ne cesseront de répondre ce que les Kabyles répondaient à Louis Philippe en 1844: « Nous ne reconnaissons pour chefs que les nôtres et ne nous comptez pas au nombre de vos sujets. Si vous voulez prendre toute l’Algérie, nous vous dirons que la main de Dieu, arbitre souverain qui punit l’injuste, est plus élevée que la vôtre. »
Cette négation de l’âme nationale rejoint dans le mépris de « l’autre », cette maladie de l’esprit et du coeur qui s’appelle le racisme. En 1834, Passy le déplorait à la tribune de la Chambre en ces termes: « Partout où il y a comme à Alger coexistence de races et de civilisations différentes, le vainqueur méprise le vaincu. Rien de plus étrange que le langage que l’on tient aux Etats-Unis. Le sentiment est si naturel, naît et se propage si facilement, qu’on le partage à son insu ». Ce racisme avait son théoricien; un docteur Bodichon, dont les ouvrages indigestes et menaçants eurent leur temps de célébrité. Il eut ses activistes, avec Rochefort et Max Régis. La littérature anti-arabe ou antisémite qui s’épanouit en Algérie de 1880 à 1910 est d’une incroyable est d’une incroyable bassesse. L’exemple venait de haut. Voici, par exemple, les conclusions « ethnologiques » de ce noble cénacle de pairs de France et de généraux qu’était la commission d’Afrique de 1833: « Les juifs? La plaie du pays, êtres bas et méprisables, dont l’âme se résume en un seul mot: argent... Les Maures? Peuple mou, intrigant et parasite, qui ne produit rien. L’Arabe? Paresseux, perfide et cupide. Le Kabyle? Féroce après la victoire. » Seuls les Turcs trouvèrent grâce à leurs yeux: « Ils ont de la gravité, de la dignité et de la loyauté. » On comprend pourquoi: ils avaient été expulsés; et puis, leur discipline, qui rappelait les ordres de Chevalerie, n’était sans doute pas pour déplaire aux présidents, le comte d’Haubersart et le général-comte Bonnet. Pour le Moniteur algérien, suivant l’humeur ou l’intérêt du moment: « Le juif est le garde avancé de la régénération africaine » (13 octobre 1832), ou bien: Ne parlons pas ici des Juifs, qui ne sont que des accidents au milieu des empires » (14 juin 1833). Aux diatribes racistes du maréchal Clauzel, Hamdan répondit avec beaucoup de dignité: « Maures ou Bédouins, nous sommes tous frères et créatures de Dieu... Si nous étions grecs ou polonais, est-ce que vous nous traiteriez de cette manière? ».
En 1843, Bugeaud avait conçu le généreux projet de débarrasser, en deux ans, l’Algérie de tous ses Juifs, « qui constituent, disait-il un fléau et un danger permanent ». Paris l’en dissuada: ils étaient trop nombreux; il valait mieux les « régénérer ». Ce sont les mêmes hommes qui justifieront leurs effroyables représailles de 1871 en accusant les Musulmans de réactions antijuives dont la plupart n’étaient que l’effet de provocations délibérées.
Ce racisme était la philosophie d’une caste féodales de latifundiaires, qui traitait l’Algérie comme son carrosse et l’armée française comme son cocher. Déjà, la commission de 1833 devait d’en indigner: « Il faudrait que la France prodiguât ses soldats et ses trésors pour rassurer une immense fortune à des gens qui ne lui permettaient même pas le léger dédommagement de la reconnaissance, et qui regardaient les efforts de leur patrie comme une dette envers eux. Les colons qui voulaient à tout prix compléter leur spéculation exigeaient à grands cris de la France qu’elle versât pour eux son sang et fit en Afrique, sur les derniers du peuple, ces grands travaux qu’elle ne peut faire chez elle. L’intrigue s’empara de toutes les avenues, l’armée eut aussi à se défendre de cette puissance. Les passions politiques se firent jour, servirent merveilleusement le désordre. Que pourrait-on attendre de gens qui emploient contre la machine administrative tous les ressorts désorganisateurs? »
Ces ressorts ne cesseront de jouer d’une hystérie nationaliste accordée aux diatribes de Maurras ou de Déroulède, et du chantage à la sécession. Déjà en 1871, Alexandre Lambert, et Vuillermoz, le maire d’Alger, réclamaient un protectorat anglais ou américain. On connaît les menaces de rupture, aux temps de la crise vinicole, des viticulteurs et de leurs représentant, comme le sénateur Brière. Poussant à la panique leur masse de manoeuvre européenne de « petits blancs » ou de « pieds noirs », organisant la corruption de « toutes les avenues », ils condamnaient ceux qu’ils prétendaient défendre cette absurde et funeste fuite en avant, qui s’attache à élargir chaque jour un peu plus le fossé où ils redoutent de tomber.
Nos maîtres s’empressaient d’ajouter à la panique, en leur prédisant, dans une Algérie « livrée » aux Algériens, un « chaos désespérée ». Clauzel disait déjà en 1833: « Notre départ serait le signal du massacre de tous nos partisans juifs maures, il livrerait le pays à toutes les horreurs de la guerre civile ». « Ce serait abandonner nos partisans et ceux qui ont engagé leurs capitaux », précisait la commission. A une époque où ces partisans et ces colons se comptaient quelques centaines, la mauvaise foi du prétexte était manifeste. Chacun savait que l’ordre régnait à Alger avant 1830. Les « otages » - tel était alors le nom officiel de nos partisans - servaient à faire pression non pas sur les Algériens, mais sur la France. Rendre son indépendance à un pays conquis soulève des problèmes épineux. Les aggraver en ajournant leur solution était une lourde faute.
Vieux comme le monde, le stratagème du chaos est celui de tous les conquérants: on détruit, on surplante l’appareil d’Etat, après quoi on déclare hautement qu’on se refuse à abandonner un pays dévertébré: « On a tente de dissoudre l’organisation des tribus, bouleversé la justice, détruit les vieilles coutumes de la nation... de sorte que, sans guides, ce malheureux peuple erre à l’aventure », écrivait Napoléon III, qui aboutit à l’inévitable conclusion: « La pacification des Arabes est la base indispensable de la colonisation? » Au lendemain de la prise d’Alger, les « progressistes » de l’Avenir disaient déjà « qu’Alger sans nous serait jeté dans une affreuse anarchie ». L’Egypte, le Liban, le Maroc étaient, eux aussi, promis à un chaos qui n’est dû le plus souvent qu’aux séquelles de la conquête ou aux intrigues des anciens maîtres. « On trouvera un jour d’immenses ressources chez ces Algériens », disait Rovigo.
Louis-Philippe osera conter à Thomas Campbell qu’il rendrait Alger aux Algériens s’il savait seulement comment en « restaurer l’Etat »! Il se plaisait à invoquer son abnégation, à laisser entendre qu’il était las, tout le premier... de cette guerre interminable: « A qui le dites-vous! » On claironnait tout aussi haut les obligation de l’honneur. A ce clairon qui sonne depuis 1830; voici ce que répondait, au cours du débat algérien de 1834, le savant et député Passy: « A Madrid, les Cortes n’ont pas eu le courage d’émanciper les colonies d’Amérique. L’orgueil espagnol ne pouvait s’y résoudre. C’était se déshonorer aux yeux du monde. Eh bien, les colonies ne s’en sont pas moins émancipées. Mais les Espagnols, payant le prix de l’orgueil, ont tout perdu. Voilà, messieurs, le résultat de ces invocations à l’honneur national. L’honneur d’une nation est dans la morale et la raison et non dans l’obstination, et ne pas savoir renoncer à des conquêtes ruineuses et à une domination brisée, c’est une faute et souvent un crime. Peuples et rois devraient le savoir. »
L’honneur d’une armée n’est-il pas de servir celui de la Nation?
Les assurance des chefs algériens sur le sort de nos colons et de nos partisans ‘ont jamais fait que confirmer de la façon la plus nette (par exemple, le manifeste de mai 1955) ce qu’en disait Hamdan en 1830: « Les Français sont des hommes et la fraternité nous unira à eux. La religion est une chose morale qu’on ne disputera pas. » Mais, dès 1830, on oublia qu’au temps de la Régence le commerce de l’Algérie indépendante se faisait presque entièrement avec la France. On présentait le tableau d’un peuple français étouffant dans ses frontières sans l’exutoire de son espace vital algérien. Là non plus, l’argument ne reposait sur rien. Le seul pas que l’Algérie soulagea de son surpeuplement fut les Baléares, qui lui donnèrent d’ailleurs ses meilleurs colons! En réalité, jusqu’à la fin du siècle, la colonisation fut dérisoire. En 1844, l’Algérie comptait 2.237 colons, femmes et enfants compris? Il y avait alors 45 soldats pour un colon, et un Européen sur trois se trouvait à l’hôpital. En 1872, on ne comptait toujours qu’un colon pour mille Européens... « La Mitidja, qu’on appelait avant la mère des pauvres, qu’en avons-nous fait? » demandait alors le général Esterhazy: « Quelques hameaux éparpillés ici et là ». L’Algérie de 1870 ne comptait encore que 200.000 Européens, et la proportion de véritables colons était toujours aussi infime. En 1954, on trouvera 25.000 propriétaires européens dont quelques centaines seulement possèdent les neuf dixièmes des terres de la colonisation.
Devant ces résultats, Tocqueville, toujours lucide, indiquait en 1840 ce qui était alors l’évidente solution, la plus raisonnable, celle-là même qu’Hamdan avait suggérée dix ans plus tôt: Si nous voulons coloniser sérieusement avec des Européens, ce sera la guerre. Ce qu’il faudrait faire? Exploiter le pays à la manière de l’Egypte. » Déjà sous le Second Empire, on évoquait la tragédie du reflux massif. Et l’on affectait de croire que, privé de ce débouché, le peuple français risquait d’étouffer dans ses frontières. La réalité était moins tragique. Soyons sérieux: Si, des chiffres donnés avant 1954, on déduit les habitants nés ailleurs et qui n’ont pas fait souche, les étrangers, les juifs autochtones, les Musulmans assimilés, il reste environ 50.000 Français dont l’ascendance et pour moitié d’origine française. Comment faire croire que les 250.000 Français de plus compterait la France sans cette émigration en Algérie n’auraient pu trouver place chez elle, ou émigrer ailleurs? Comment les Algéristes du Second Empire ne voyaient-ils pas que mener une guerre de quarante ans, « boucher l’avenir » de deux nations et de quarante millions d’être humains pour pareil résultat était plus qu’un non-sens: une trahison?
Cette guerre était un gouffre: cent millions par an, qui nous paraissent infiniment loin de nos trois milliards quotidiens. Mais pour l’époque, et pour le territoire exigu que nous occupions, c’était une somme énorme. Devant cette absurdité l’Anglais Sainte-Marie écrivait dans un rapport publié à Londres en 1846: « Comment ne voient-ils pas que cette colonie est un gouffre sans fond, et qu’après toutes sortes de sacrifices il faudra l’abandonner? Elle ne rapporte rien que 400.000 francs de droits de douane ». Dans son fameux pamphlet. Ce qui se voit, ce qu’on ne voit pas, l’économiste Bastiat consacre un chapitre à l’Algérie: « l’Etat dit à Jacques Bonhomme: je te prends cent sous pour installer un colon en Algérie, sauf à te prendre cent sous de plus pour l’y entretenir, et autres cent sous pour entretenir un soldat qui garde le colon, et autre cent sous pour entretenir un général qui garde le soldat, qui... etc..., etc... Que fait Jacques Bonhomme? Il crie: Mais c’est la forêt de Bondy! Mais comme l’Etat sait qu’il crie, que fait-il? Il brouille les cartes... Malheureuse France! Aux 1.500 millions dévorés par l’Algérie se joindront un ou deux milliards, aux 100.000 soldats qu’elle a détruits, se joindront 100.000 nouvelles victimes. Mais il arrive ceci, et je rentre par là dans mon sujet: cette activité fiévreuse et, pour ainsi dire, soufflée, frappe tous les regards, c’est ce qu’on voit. Le peuple s’émerveille. Ce qu’il ne voit pas, c’est qu’une quantité égale de travaux plus judicieux a manqué à tout le reste de la France ». La France en Algérie ressemble, ajoute-t-il, à cet alchimiste qui dépendait 300 francs pour fabriquer 20 francs de poudre d’or.
On répandait la fable que l’indépendance de l’Algérie mettrait l’ouvrier parisien au chômage, alors que l’Algérie n’a jamais absorbé plus de 2% de notre production et que les profits provenant de cet infime pourcentage n’ont jamais eu aucune commune mesure avec les charges écrasantes de la guerre. Dès 1860, le grand capital, les banques, les sociétés s’en mêlèrent. Les cadeaux furent somptueux. La compagnie genevoise reçut 20.000 hectares. Les journaux étaient pleins de Mexique d’Eldorado. On rêvait d’Icarie et de Texas. Les Saint-Simoniens, Talmabot, Péreire, brassaient les affaires. Ce n’était plus l’or jaune de la Cassauba, mais déjà un or plus fluide... plus secret encore. L’alchimie en était toujours aussi coûteuse pour nos deux peuples. Le pacte colonial en était la sorcellerie. La moralité en était fondée sur le devoir de la « civilisation » de « régénérer » un pays en raison des ressources qu’il promettait. Les affairistes étaient pleins d’espoir. On spéculait sur les surprises d’un Sahara qui paraissait illimité. C’était le temps de « la pluie d’or ».
Le maréchal Randon, qui gouvernait alors à Alger, en ouvrait les perspectives: « le capital est une force capricieuse et indomptable qu’aucune main ne gouverne. On ne peut l’appeler qu’autant que toutes choses lui plaisant. Il n’avance que comme les soldats de la deuxième colonne d’assaut. La première a comblé les fossés de ses morts et dégagé la brèche. La seconde passe pardessus et emporte la place. Ainsi en sera-t-il de notre Algérie. » Pourtant dès 1830, l’abbé de Pradt nous avait mis en garde: « il en sera d’Alger comme des édifices, les devis sont séduisant, mais plus profitables aux entrepreneurs qu’aux propriétaires ».
Les
entrepreneurs étaient alors Louis-Philippe, ses banquiers (dont
Lafitte, Perrégaux, James de Rotschild), et ses chefs de guerre. La
commission de 1833 dut convenir qu’on « voulait coloniser d’Algérie au
prix d’énormes sacrifices, alors qu’on n’avait pas fini de fertiliser
la France ».
.
.
.
.
.
.
http://www.megapsy.com/french/Hist-parjure009.htm
.
.
.
Ce 4-2-07
.
La candidate du Parti socialiste à la présidentielle française, Ségolène Royal, a qualifié la colonisation de "système de domination, de spoliation et d'humiliation" dans un message adressé hier au président Abdelaziz Bouteflika.
"La France, qui a l'ambition de porter un message universel, se doit de regarder son histoire en face, même s'il s'agit de ses pages les plus sombres, comme la colonisation dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un système de domination, de spoliation et d'humiliation", a affirmé Mme Royal dans ce message remis à Bouteflika par son conseiller spécial Jack Lang. La candidate socialiste a ajouté qu'elle souhaitait que les rapports entre la France et l'Algérie soient une "référence dans les relations entre le Nord et le Sud". La femme la plus populaire de l'Hexagone s'est également engagée à faire sa "priorité" du renforcement des relations entre l'Algérie et la France. "Ma priorité, si je suis élue, sera de jeter les bases, avec vous, d'une relation renforcée entre nos deux pays, car mon sentiment profond est que nous pouvons résolument passer à une dimension supérieure dans les liens de coopération qui nous unissent." Elle a également souligné que la relation entre la France et l'Algérie "faite d'intimité, doit se développer dans la confiance et être soudée par l'amitié". La candidate socialiste a également estimé "fondamental" que Paris et Alger " puissent élaborer ensemble une restitution de l'histoire qui tienne compte de notre histoire partagée".
![]()
Jack Lang pour une reconnaissance des crimes commis par la colonisation
Dans
l'après-midi, son émissaire, Jack Lang, qui était l'invité de
l'Institut des études stratégiques globales (IESG), a donné une
conférence sur le thème : "Europe-Maghreb, quel avenir ?" M. Lang, dont
la dernière visite en Algérie remonte à 1996, a plaidé pour une
"reconnaissance (par la France) des crimes commis par la colonisation"
en Algérie, comme alternative aux excuses réclamées par Alger à Paris. "La meilleure façon de s'excuser est de reconnaître la réalité des crimes qui ont été commis par la colonisation en Algérie de 1830 à 1962 (date
de l'indépendance)", a affirmé le conseiller de Ségolène Royal. "Même
quand la page du colonialisme est tournée, il reste ce qui n'est pas
toujours le plus aisé à opérer en soi :
une forme de décolonisation mentale, de décolonisation morale et
spirituelle car la survivance des instincts coloniaux est tenace et
parfois vivace", a-t-il ajouté.
.
.
![]()
.
.
.
Recto
.
.

.
.
.
.
.
.
.

carte postale de LA CALLE, datée du 23 octobre 1909
.
.
.
.
\ Verso
.
.

![]()
La Calle le 23 octobre 1909.
Ma
chère Léonie. Je viens de rentrer d'une corvée plutôt désagréable. On
m'a confié la mission d'aller avec ma compagnie à Yusuf assurer le
maintien de l'ordre pendant l'exécution capitale d'un indigène :
BOUBAKEUR. Parti à 2 heures de l'après midi le 21, je ne suis rentré
qu'hier à midi à La Calle. J'ai dû faire escorter le condamné à sa
descente de train, protéger le montage de la Veuve (qui n'avait rien de
joyeuse) et organiser le piquet pendant l'exécution.
J'étais à 3
ou 4 pas de la guillotine lorsque le couteau tomba. Je ne suis pas
fâché au fond d'avoir vu cela une fois, mais je ne ferais pas
maintenant un pas pour aller voir ce spectacle macabre.
J'abandonne
ce sujet qui manque de gaieté, pour vous annoncer que mon frère quitte
Fougères pour Chinon ? La mutation a paru à l'Officiel.
J'ai
d'excellentes nouvelles de Paulot et de sa maman. Il me tarde de les
rejoindre et je m'ennuie à mourir seul ici.
Je vous embrasse bien affectueusement ainsi que Père.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 .
.
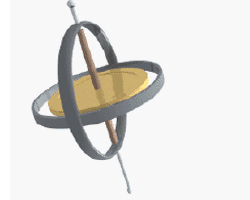



Les commentaires récents