"Ils ont la force, ils pourront nous soumettre, mais les mouvements sociaux ne se maîtrisent ni par le crime, ni par la force. L’histoire nous appartient, ce sont les peuples qui la font."
Salvador Allende, message radiodiffusé le 11 septembre 1973.
Lorsqu'un coup d’accélérateur est donné à l'histoire, tout semble aller si vite que l'on se sent prix dans le tourbillon des événements. Alors que la Révolution souriante de la Silmiya est à son 7e mois en Algérie,le régime multiplie les arrestations ciblées, accentue l'oppression et fait miroiter le spectre d'une violence majeure. Le tout pour lui est de tenir un simulacre d'élection "présidentielle" à même de lui permettre de se régénérer, quitte à mettre le pays à feu et à sang pour instaurer l'état d'urgence, voire l'état d'exception.
Le mouvement populaire en cours est dans un temps révolutionnaire porteur de nouvelles perspectives historiques, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la construction citoyenne de l'espace nord-africain et de l'espace méditerranéen. Son caractère pacifique, son unité, son autonomie, son ampleur nationale à dimension internationale ont permis d'éviter au pays de grandes manœuvres de déstabilisations rendues possibles, d'une part, par l'instabilité régionale qui touche la rive sud de la méditerranée et la région du Sahel ainsi que les manœuvres des bras régionaux des puissances néocolonialistes - à l'image de l'axe Le Caire - Abou Dhabi - Ryad - ou du Qatar, investis dans le combat contre l'accession des peuples de ces régions à la citoyenneté politique. D'autre part, le régime illégitime porteur du syndrome du colonisé se trouve complètement soumis à ce jeu malsain de la géopolitique.
Inapte à la moindre possibilité de réforme, le régime agit à contre-courant de l'histoire en s'entêtant à se maintenir au risque même d'une dislocation de l'armée pouvant provoquer une partition sanglante du pays.
C'est dans ce contexte que le peuple algérien continue à se mobiliser sans relâche et en maintenant le caractère pacifique de sa révolution. Cela dit, ces dernières semaines, des appels à la désobéissance civile ont été lancés. Il est à rappeler qu'à force d'être mobilisée, cette notion a été galvaudée au point d'être mise au registre aliénant et stérilisant des mots-valise. Or, chaque notion, chaque mot, à une histoire, un parcours et une capacité d'impacter positivement ou négativement l'histoire d'un pays.
Alors, qu'est-ce que la désobéissance civile ?
L'HISTOIRE D'UNE NOTION :
Nombreux sont les chercheurs et les théoriciens qui attribuent l'exposé d'une définition initiale, des principes et du mode de fonctionnement de la désobéissance civile à Henry David Thoreau, philosophe, essayiste et poète américain, né le 12 juillet 1817 et mort le 6 mais 1862 à Concorde, dans le Massachussetts.
Dans son livre intitulé "Désobéir", Frédéric Gros, professeur de pensée politique à Sciences Po Paris et à l'ouverture du chapitre 9 portant sur "La promena de de Thoreau", raconte l'histoire de cette promenade : " Henry David Thoreau décide, au matin du 23 juillet 1846, d'aller à Concorde rechercher des chaussures qu'il avait déposées chez un cordonnier à ressemeler. Ces escapades en ville ne lui sont pas désagréables. Cela fait presque deux ans en effet qu'il a fait le pari de vivre en parfaite autarcie, de faire l'expérience d'une "existence naturelle". Il a construit sa cabane tout seul, avec des matériaux de récupération au bord du lac Walden(1), sur un terrain appartenant à son ami Emerson (2) - écrivain reconnu, grand représentant de la philosophie transcendantaliste américaine."
Poursuivant son histoire, Frédéric Gros remonte au centre-ville de Concorde, où "avant d'avoir pu récupérer ses chaussures, Thoreau est interpellé par le fils de l'aubergiste, préposé à la collecte d'impôt, qui lui rappelle qu'il doit à l'Etat, depuis plusieurs années, la taxe de capitation. Thoreau refuse tout net de payer, clamant son indignation de devoir, en réglant ses impôts soutenir la guerre, qu'il juge injuste, redéclarée au Mexique après l'annexion du Texas, sans parler du scandale absolu que représentait à ses yeux l'esclavage dans les états du Sud".
Thoreau conduit en prison, la légende est née !
Alors qu'il n'a passé qu'une seule nuit comme prisonnier, " aux côtés d'un codétenu soupçonné d'avoir incendié une grange" et que "dès le lendemain, un parent...se précipite pour régler les arriérés d'impôts ( et même probablement quelques années d'avance)" effrayé par le scandale", lui permettant ainsi de sortir de prison, la légende, poursuit Frédéric Gros, "veut qu'il ait reçu pendant ce bref séjours derrière les barreaux la visite de son aîné et maître Emerson qui lui aurait demandé : " Mais enfin, que faites-vous ici ?"; à quoi Thoreau aurait répondu : " C'est moi qui devrais vous poser la question : comment se fait-il que vous ne soyez pas assis à mes côtés ?".
C'est dire que le récit historique de la désobéissance civile, réserve une place de choix à l’héroïsme !
Paradoxe : Alors que l'arrestation de Thoreau est citée comme source de jaillissement de la notion de désobéissance civile, le philosophe américain, précise Frédéric Gros, en " tirera la matière d'une conférence qu'il prononcera deux ans après les faits, intitulée" Résistance civile au gouvernement" (1848). C'est seulement au moment de sa reprise dans l'édition des Œuvres complètes (1866), après la mort de son auteur donc, que le texte reçoit comme titre "De la désobéissance civile" ".
A l'ouverture de cet essai d'une quinzaine de pages dactylographiées, le poète américain écrit :
" De grand cœur, j’accepte la devise : « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins » et j’aimerais la voir suivie de manière plus rapide et plus systématique. Poussée à fond, elle se ramène à ceci auquel je crois également : « que le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout » et lorsque les hommes y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu’ils auront. Tout gouvernement n’est au mieux qu’une « utilité » mais la plupart des gouvernements, d’habitude, et tous les gouvernements, parfois, ne se montrent guère utiles. Les nombreuses objections — et elles sont de taille — qu’on avance contre une armée permanente méritent de prévaloir ; on peut aussi finalement les alléguer contre un gouvernement permanent. L’armée permanente n’est que l’arme d’un gouvernement permanent. Le gouvernement lui-même — simple intermédiaire choisi par les gens pour exécuter leur volonté —, est également susceptible d’être abusé et perverti avant que les gens puissent agir par lui."(3)
Pour Thoreau, "l'appareil étatique, c'est une machinerie compliquée, malheureusement nécessaire, à laquelle pourtant chacun doit sans cesse opposer sa "friction", son "frottement" (4)
L'accomplissement de cette "friction" avec l'appareil étatique, sous forme de résistance, ne peut être réduite aux contestations théoriques, aux discours indignés pour accepter à la fin de se soumettre à des lois édictées par des majorités de gouvernement faites pour défendre les intérêts d'une élite restreinte. Désobéir est lié, pour Thoreau, à l'art de vivre son "expérience naturelle" d'élévation de "la conscience individuelle" au-delà de l'obligation d'obéir aux lois du législateur. Ainsi plaide-t-il pour la primauté de la conscience individuelle comme instance souveraine de définition des valeurs et des priorités.
"Ne peut-il exister de gouvernement où ce ne seraient pas les majorités qui trancheraient du bien ou du mal, mais la conscience? où les majorités ne trancheraient que des questions justiciables de la règle d’opportunité? Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer
sa conscience au législateur? A quoi bon la conscience individuelle alors?" demande-t-il avant de trancher : "Je crois que nous devrions être hommes d’abord et sujets ensuite. Il n’est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m’incombe est de faire bien." (5)
La désobéissance civile, chez Thoreau, n'est pas seulement un positionnement opposé à la primauté de l'appareil étatique et de ses lois sur la conscience individuelle. Elle repose également sur ce que Frédéric Gros appelle "une conversion spirituelle". Selon ce dernier, " La désobéissance chez Thoreau s'enracine dans un travail éthique sur soi, une exigence intérieure dont témoignent ses longues promenades qui équivalent aux prières chez Martin Luther King, au filage du coton pour Gandhi. Cette transformation, cette ascèse, c'est le transcendantal éthique de la désobéissance."
"Le sujet indélégable" dans la pensée de Thoreau, n'est pas un être narcissique dont Je serait le nombril du monde. Il s'agit plutôt d'un soi, aussi désobéissant que responsable, irremplaçable dans la mesure où il ne délègue personne à penser à sa place ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, à assumer ses propres choix, à assurer son rôle de servir les autres et à apporter sa propre contribution dans une redéfinition éthique des rapports de l'être humain avec les principes universels, à commencer par celui de la justice de justice.
Cette préoccupation, on en retrouve l'écho, notamment, chez Gandhi et Martin Luther King.
Dans son discours "Sur la non-violence" prononcé en 1922, Gandhi, déclare : " À mon humble avis, la non-coopération avec le mal est un devoir tout autant que la coopération avec le bien. Seulement, autrefois, la non-coopération consistait délibérément à user de violence envers celui qui faisait le mal. J'ai voulu montrer à mes compatriotes que la non-coopération violente ne faisait qu'augmenter le mal et, le mal ne se maintenant que par la violence, qu'il fallait, si nous ne voulions pas encourager le mal, nous abstenir de toute violence. La non-violence demande qu'on se soumette volontairement à la peine encourue pour ne pas avoir coopéré avec le mal. Je suis donc ici prêt à me soumettre d'un cœur joyeux au châtiment le plus sévère qui puisse m'être infligé pour ce qui est selon la loi un crime délibéré et qui me paraît à moi le premier devoir du citoyen. Juge, vous n'avez pas le droit, il vous faut démissionner et cesser ainsi de vous associer au mal si vous considérez que la loi que vous êtes chargé d'administrer est mauvaise et qu'en réalité je suis innocent, ou m'infliger la peine la plus sévère si vous croyez que le système et la loi que vous devez appliquer sont bons pour le peuple et que mon activité par conséquent est pernicieuse pour le bien public."
LECTURE CRITIQUE :
La notion de la désobéissance civile n'a pas le même sens, le même contenu et la même portée en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Revenons à Frédéric Gros. Reprenant "ce qui a été délimité par les théoriciens politiques comme "désobéissance civile"", ce dernier estime qu'elle "désigne le mouvement structuré d'un groupe plutôt qu'une contestation personnelle. Elle suppose l'organisation d'un collectif structuré par des règles déterminées de résistance, un crédo commun, ordonné à un objectif politique précis : le plus souvent, l'abrogation d'une loi ou d'un décret jugés scandaleux, injustes, intolérables."
Les regards portés par les penseurs que sont Henry David Thoreau et Frédéric Gros sur la désobéissance civile sont ceux de deux penseurs émanant de sociétés qui produisent, chacune d'elles, sa propre histoire, en l’occurrence, la société américaine du XVIII siècle et la société française contemporaine.
Cela dit, le contexte de globalisation que vit le monde actuellement remet en question les rapports de l'être humain avec la citoyenneté, exige l'identification de nouvelles sources de pouvoir pour une redéfinition des rapports de celui-ci avec les principes universels, tels que la justice et l'égalité, et adapter sa conception des droits de la personne humaine à une "Raison émergente" (6) servant à lui restituer sa souveraineté face au système globalisé.
Sous cet angle, l'on pourrait citer ce que le penseur Edgar Morin appelle " un humanisme régénéré" qui " veut dire revenir à ce qui avait été son fondement : tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur sexe, ont les mêmes droits et doivent être reconnus comme des êtres humains à part entière. C’est le premier principe. Le deuxième principe, c’est de comprendre que tous les êtres humains sont des enfants de la Terre. Ils sont issus d’une évolution biologique, ils ont une même racine, ont une communauté d’identité et sont d’origine terrestre. Le troisième élément, c’est la communauté de destin terrestre, qui est née de la mondialisation. Aujourd’hui, on est tous embarqués dans la même aventure. Enfin, si on réfléchit un peu, chacun est une parcelle d’une aventure gigantesque qui a commencé à la préhistoire. Ce sentiment que nous sommes maintenant à un moment de l’aventure commune de l’espèce humaine, c’est le dernier élément de l’humanisme régénéré." (7)
Quand il s'agit des sociétés qui n'ont pas leur propre modèle de production de l'histoire, les choses deviennent encore plus compliquées.
C'est le cas, notamment,de la société algérienne ayant subit la tragédie historiquement programmée de l'échec du projet d'une République Algérienne Démocratique et Sociale, prôné par l'Appel de Novembre et porté par le Congrès de la Soummam.
Dans le contexte algérien, surtout en ces temps où l'Algérie vit la situation exceptionnellement historique d'une révolution pacifique, la notion de désobéissance civile est à prendre avec beaucoup de précaution. L'Algérie n'est pas sous un régime démocratique où l'on pourrait s'organiser librement pour contester l'injustice d'une loi ou d'un décret, se dresser contre l'esclavagisme ou la ségrégation tel que fut le cas pour Henry David Thoreau ou Martin Luther King. Elle n'est pas, non plus, sous le régime de l'Apartheid et n'est plus sous l'ordre colonial pour que l'on prenne comme exemples d'un désobéir massif, Mandela ou Gandhi. C'est ce que le sociologue algérien, le Pr Addi Lahouari a rappelé dans un post sur son mur Facebook repris par le journal électronique Le Matin d'Algérie, le 14 août 2019 :
" Ceux qui appellent à la désobéissance civile ne disent pas en quoi consisteraient les actions de la désobéissance civile. Grève à la poste ? Les victimes seront les retraités qui retirent leurs maigres pensions du CCP. Grève des factures d'électricité ? La Sonelgaz est une entreprise nationale et aggraver son déficit est anti-économique car le déficit sera comblé par une subvention de l'Etat, ce qui fera diminuer le pouvoir d'achat des consommateurs. Grève des transports ? Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de voiture? Je ne vois aucun domaine où l'action de désobéissance civile serait organisée sans faire mal aux usagers, c'est-à-dire au public. Par ailleurs, déclencher des actions de désobéissance civile pourrait rendre impopulaire le hirak et donner aux généraux l'occasion de se poser en défenseurs de l'intérêt national et de l'ordre public. Ils n'attendent que cela. Que s'est-il passé en janvier et février 1992 ? Le DRS a poussé les éléments les plus extrémistes du FIS vers la violence, malgré l'opposition d'Abdelkader Hachani, en leur donnant des armes et en les encourageant à prendre le maquis. Résultat ? 200 000 morts et le régime est encore là. Aujourd'hui, le néo-DRS ne manquera pas d'exploiter la situation pour pousser vers la violence et adieu le projet de changement de régime. Pour argumenter, les tenants de la désobéissance civile citent les noms de Gandhi, de Mandela et de Martin Luther King. Gandhi avait appelé au boycott des entreprises britanniques pour faire mal aux intérêts économiques de la puissance coloniale.Je rappelle que le FLN avait fait a même chose en interdisant de fumer des cigarettes pour porter atteinte à l'économie coloniale.
Or aussi inique et autoritaire qu'il soit, le régime algérien n'est pas un régime colonial.
Perturber l'économie nationale ne porte pas atteinte aux intérêts des dirigeants. Quant à Mandela et Luther King, ils ont combattu un apartheid qui n'utilisait les noirs que comme force de travail. La désobéissance civile était une stratégie opportune pour porter atteinte aux intérêts du système de l'apartheid. .
Pour l'Algérie, et comparaison n'est pas raison, je pense que le hirak pacifique est la forme la plus appropriée pour venir à bout de ce régime. Les Algériens ont décidé de faire une révolution sans perturber l'économie et sans faire couler une goutte de sang, civil ou militaire, parce que c'est une stratégie du long terme.
Ils sacrifient leur jour de repos hebdomadaire pour manifester contre ce régime illégitime. Cela dure six mois, et après ? Cela pourra durer un an ou deux ans. Les travailleurs, les employés, les fonctionnaires... seront à leurs postes de travail pendant la semaine, et le vendredi ils manifestent.
C'est ce que devraient faire les étudiants à partir de septembre. Suivre les cours, aller à la bibliothèque, se former et consacrer le mardi matin à la manifestation, et le mardi après-midi à débattre de la situation politique du pays.
Les cours seront suspendus uniquement le mardi. Avec cette stratégie au long cours, l'EM finira par se rendre à l'évidence pour rendre l'Etat au peuple à travers une transition totale, sérieuse et sans coups bas dans l'intérêt du pays et des générations futures."
Même son de cloche chez Djamel Zenati, universitaire et militant du combat démocratique qui, dans "une réaction à chaud", précise :
"Cette notion recouvre un champ très vaste. Il faut la mettre en perspective avec le contexte dans toutes ses dimensions. La dictature algérienne est ancienne, très ancrée et usant de modes très élaborés. La violence est son terrain de prédilection. Le mouvement doit impérativement éviter de recourir à des formes d'action susceptibles d'être instrumentées pour ensuite être retournées contre le mouvement lui-même. Par ailleurs le choix des moyens de lutte doit répondre à des considérations variées. Il ne s'agit pas de puiser dans un menu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En conclusion, la question n'est pas d’être pour ou contre la désobéissance civile. Ainsi formulée, elle n'a pas de sens. Le débat doit porter sur les formes de luttes qui répondent aux nécessités de l’évolution du mouvement et qui soient de nature à renforcer la détermination et à rapprocher du but recherché."
La notion de désobéissance civile a négativement impacté l'histoire récente de l'Algérie. En plus des deux exemples, celui du FLN durant la Révolution de Novembre et celui de l'action menée par le Front Islamique du Salut (FIS) au début des années 1990, cités par le Pr Addi Lahouari dans son post du Facebook, il y a lieu de rappeler celui de "La grève du cartable" en Kabylie (1994-1995). Si l'on se réfère à la définition proposée par Frédéric Gros de la désobéissance civile et citée précédemment dans ce texte, le boycott scolaire de cette époque là en reprend les caractéristiques d'un mouvement "structuré par des règles déterminées de résistance", porteur des mots d'ordre de la reconnaissance officielle de Tamazight et de la libération de Matoub Lounès dont l'affaire du kidnapping - avant celle de son assassinat ! - n'a, à ce jour pas livré tous ses secrets, et " ordonné à un objectif politique précis". Le 22 avril de l'année 1995, un "accord" pour la reprise des cours est "signé" entre "la présidence" et les représentants du Mouvement Culturel Berbère (MCB), sauf ceux des Commissions Nationales et du Syndicat Autonome des Travailleurs de l'Education et de la Formation (SATEF) qui se sont retirés des négociations. Cette accord signé a permis la tenue de "l'élection présidentielle" qui a consacré l'investiture du général Liamine Zeroual à la Présidence de la République et permis, ainsi, au régime de se régénérer.
D'ailleurs, l'histoire récente de l'Algérie montre que l'élection présidentielle à toujours permis au régime de surmonter ses crises. Sauf que depuis le 22 février 2019, l'Algérie a ouvert une nouvelle page de son histoire...
LA DISSIDENCE CITOYENNE EN CONTEXTE RÉVOLUTIONNAIRE PACIFIQUE :
Conceptualiser des événements liés au cheminement historique des nations est un exercice difficile. L'un des concepts qui est confronté à cette difficulté est celui de la dissidence. S'agit-il d'une "objection de conscience quand un individu isolé (soit le lanceur d'alertes) prend le risque de dénoncer les faillites d'une institution", comme le propose Frédéric Gros (10) ? Est-il question d'un désaccord sur un point précis, d'une opposition circonstanciée à un projet de loi, par exemple ? Ou, alors, la dissidence peut-elle recouvrir un sens plus large, celui d'un mouvement collectif pouvant laisser son emprunte sur l'histoire d'un pays ? Pourquoi cette "imprécision" qui fait que Vladimir Boukovski préfère substituer le terme de "résistance" à celui de "dissidence" ? Pourtant, "avec Alexandre Soljenitsyne ou Andreï Sakharov" , il incarne " L'esprit de la dissidence " face au régime soviétique (11) ? Michel Eltchaninoff, le philosophe, essayiste et journaliste français, n'a-t-il d'ailleurs pas fait l'éloge de son livre autobiographique, Et le Vent reprend ses tours, " Ce livre exceptionnel", qui, selon lui, " représente l'un des plus beaux témoignages sur la dissidence" ?
Bref retour aux sources de cette notion :
Selon "Le Robert, dictionnaire historique de la langue française" réalisé sous la direction du linguiste et lexicographe français, Alain Ray et publié en Mars 2000, "Dissidence" est un mot qui a fait son apparition en "1585, XVe siècle. Il est "emprunté au latin dissidentia "opposition, désaccord"...Il s'est répandu à partir de 1787".
L'évolution de ce concept dans le contexte des populations vivant sous le régime soviétique ou dans les démocraties populaires est évoquée par les deux historiens français, Jean Chiama et Jean-François Soulet :
"Autant dans les démocraties de type occidental, le concept d'"opposition" est clair, désignant un rouage essentiel du système politique, autant il est ambigu et officiellement inexistant dans tous les pays totalitaire. Ces difficultés expliquent la floraison des termes utilisés pour rendre compte du phénomène. On parle de contestation, de réformisme, de révisionnisme, de résistance ou de dissidence. Ce dernier mot a eu, jusqu'à présent, le plus de succès en France et dans les pays anglo-saxons, où il prend racine dans le passé. Dès la période moderne, en effet, il désignait tous ceux qui étaient en désaccord (étymologiquement : qui siégeaient à côté) avec une Eglise officielle tels les presbytériens en Angleterre ou les luthériens en Pologne. Ainsi repris dans son sens originel, le terme s'applique bien à l'attitude réservée ou franchement critique d'une partie de la population des pays de l'Est envers la doctrine et la politique officielles. Cependant, on peut lui reprocher d'être trop général et quelque peu faible, exprimant une simple divergence, un désaccord sur un point particulier, plus qu'un engagement actif supposant affrontement et lutte. C'est pourquoi Vladimir Boukovski préférerait voir substituer à ce mot celui de "résistance". " (9)
Ainsi, donc, Vladimir Boulovski, ne trouve pas le mot "dissident" assez puissant pour qualifier ces " simples hommes qui ont appris à penser par eux-mêmes", à ne se référer " à aucun schéma préétabli, ce qui ne les empêche pas par ailleurs d'être d'accord sur de nombreux points et toujours solidaires". (12)
Sous les régimes totalitaires, la condition des dissidents est celle des hommes et des femmes soumis aux différentes formes d'oppression qui vont du harcèlement aux différentes privations, voire à l’exécution physique.
En ce qui concerne l'Algérie, le mot dissidence a été mis dans une perspective historique le liant "aux prouesses libératrices d’hier qui demeurent le patrimoine et la fierté de l’ensemble des Algériens et Algériennes." par le leader politique de l'opposition algérienne et ancien président du Front des Forces Socialistes (FFS), feu Hocine Aït-Ahmed. Il a été, aussi, lié au combat mené depuis l'indépendance du pays pour une construction citoyenne de l'Algérie, sur fond d'une mobilisation pacifique contre la guerre de dislocation de la société, de destruction de la mémoire, d’annihilation de tout espoir de réalisation l'idéal démocratique national et pour la reconquête du droit du peuple algérien d’exercer sa souveraineté.
Dans le message que Hocine Aït-Ahmed a adressé à la session extraordinaire du conseil national du FFS, tenue à Alger le 29 mars 2002, il a rappelé :
" La dissidence citoyenne pacifique et nationale, est née fondamentalement du refus généralisé par notre jeunesse de cette sale guerre qui bat les records de l’ignoble guerre coloniale. Dans sa durée, 10 ans !, dix années d’horreurs entourées d’une omerta maffieuse imposée aux « partenaires étrangers amis de l’Algérie ». Et en terme d’engrenages de haines et de vengeances d’autant plus insupportables qu’ils sont fratricides.
Aucune propagande incantatoire ne peut exorciser le Printemps noir, cette nouvelle tragédie nationale programmée ouvertement par les décideurs pour briser l’unité nationale en croyant pérenniser ainsi leur main mise sur le pouvoir et les richesses du pays.
La répression sauvage ordonnée par les tenants du pouvoir et qui se poursuit toujours a déclenché les extraordinaires manifestations de solidarité et de revendications multiples à l’échelle nationale . Le souci de préserver l’unité du pays et de signifier leur congé aux détenteurs illégitimes de la puissance publique fut la cause directe de la naissance de cette dissidence citoyenne pacifique et nationale." (13)
Tout en reconnaissant que "cette dynamique" était " en dents de scie", il a aussitôt souligné quelle était " sans cesse en développement"et qu'elle demeurait "l’axe principal de l’alternative démocratique à laquelle nous devons continuer de travailler d’arrache-pied."
L'on pourrait céder à la facilité de se demander : " Qu'est-ce qui a empêché cette dynamique d’accélérer le processus de la dissidence, de lui donner la puissance de rendre irréversible le départ du régime ?"
Faut-il se rappeler qu'à l'époque, l'Algérie venait à peine de sortir d'une guerre ayant fait plus de 200 000 morts et de 20 000 disparus que la Kabylie subissait une stratégie de chaos local concoctée dans les laboratoires du Département du Renseignement et de la Sécurité ( DRS).
Aussi, faut-il prendre en compte le contexte de l'après 11 septembre dans lequel le monde a été plongé et qui était favorable au régime, sans oublier de considérer l'étendue de toutes les violences subies par la société algérienne et leur impact sur le rythme historique de son évolution.
Or, cette société a connu une évolution qui fait l'admiration du monde entier ! Cette évolution lui a permis de déclencher une seconde Révolution qui, depuis le 22 février, a réhabilité les vertus du combat pacifique aux yeux des peuples de la planète.
La société algérienne a brisé le mur de la peur. Elle a offert une nouvelle puissance subversive à la parole, reconquis l'espace publique et renoué avec le sens de l'initiative historique.
L'Algérie vit, actuellement, la phase initiale du second temps révolutionnaire qu'elle a initié après celui de Novembre. Cette phase est celle d'une dissidence citoyenne pacifique et nationale. Pourquoi ? Parce que le mouvement populaire en cours a mis le régime dans l'incapacité temporelle de se régénérer via l'organisation d'une élection présidentielle. Preuve en est, deux échéances électorales ont été annulées sous la pression populaire, celle du 18 avril et celle du 04 juillet.
C'est dire toute l'efficacité dont a fait preuve la dissidence citoyenne actuelle.
Cependant, il appartient à toutes les forces citoyennes de proposition et d'initiative, à tous les partis de l'opposition, à toutes les organisations syndicales et associatives autonomes, aux différents producteurs d'idées, aux différents créateurs de rêves, de conjuguer leurs efforts pour faire émerger un nouveau projet historique : le Projet Algérie.
Notre combat porte sur l'ouverture réelle d'une transition démocratique rendant irréversible le départ du régime, la institutionnalisation et l'institutionnalisation du pouvoir via un processus aboutissant à l'élection d'une Assemblée Nationale Constituante et la libération des consciences de la culture totalitaire du système actuel.
Je vous remercie.
Hacène LOUCIF.
Références :
1 - En 1854, Henry David Thoreau publie son récit "Walden; or, Life in the Woods" (Walden ou la Vie dans les bois).
2 - Ralph Waldo Emerson (1803- 1882) est le chef de file de la philosophie transcendantaliste américaine.
3- Henry David Thoreau, "La désobéissance civile".
https://www.desobeissancecivile.org/desobeissance-fr.pdf
4 - Frédéric Gros, "Désobéir" - Albin Michel Flammarion - 2019.
5 - Henry David Thoreau, "La désobéissance civile".
6- Concept forgé par le Pr Mohammed Arkoun (1928-2010).
7- Egdar Morin, « Chacun est une parcelle d’une aventure gigantesque commencée à la préhistoire », Entretien réalisé par Marie Astier et publié sur Reporterre, le 16 février 2017.
https://reporterre.net/Edgar-Morin-Chacun-est-une-parcelle-d-une-aventure-gigantesque-commencee-a-la
9- Jean Chiama et Jean-François Soulet " Histoire de la dissidence, oppositions et révoltes en URSS et dans les démocraties populaires de la mort de Staline à nos jours", Seuil 1982.
10 - Frédéric Gros, "Désobéir".
11 - Michel Eltchaninoff, "L'esprit de la dissidence", Etudes 2013/4 (Tome 418).
https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-4-page-441.htm
12 - Jean Chiama et Jean-François Soulet " Histoire de la dissidence, oppositions et révoltes en URSS et dans les démocraties populaires de la mort de Staline à nos jours"
13 - Message de Hocine Ait-Ahmed à la session extraordinaire du Conseil National du FFS tenue à Alger le 29 mars 2002.
- 17 SEPT. 2019
- PAR HLOUCIF
- BLOG : LE BLOG DE HLOUCIF
https://blogs.mediapart.fr/hloucif/blog/160819/desobeissance-civile-ou-dissidence-citoyenne

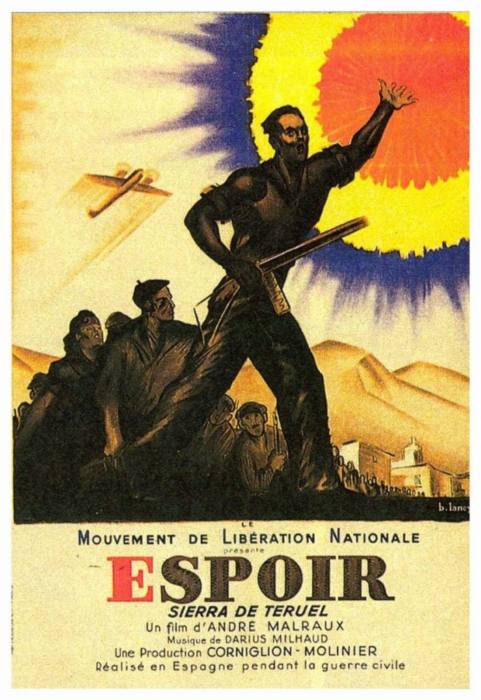
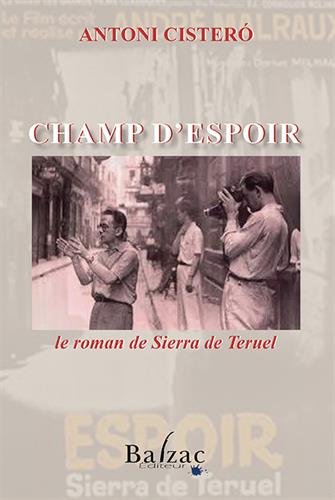




Les commentaires récents