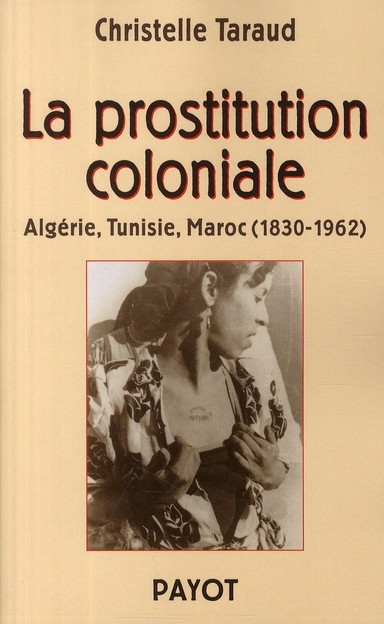
En 1896, la population française d’Algérie s’élève à 366 000 individus dont 47 459 Juifs [1][1] Selon Pierre Darmon dans Un siècle de passions algériennes..... Bien que disposant de la citoyenneté française depuis la promulgation du décret Crémieux en 1870 [2][2] Le décret n? 136 du 24 octobre 1870, dit décret Crémieux,..., ces derniers restent dans une position ambivalente et leur statut réel est contradictoire dans la société coloniale qui va émerger de la conquête entre 1830 et 1900. Les Juifs d’Algérie sont en effet marqués, au moins jusqu’à l’instauration de la IIIe République en 1870, et plus encore jusqu’à la Grande Guerre qui fait incontestablement ici césure, par leur caractère « hybride ». Ils sont en effet à la croisée du monde « indigène », avec lequel ils ont une fort longue histoire, et de l’univers français qui les séduit d’autant plus qu’il leur permet de quitter un statut (celui de dhimmi [3][3] Les dhimmis sont les bénéficiaires de la dhimma, pacte...) et des espaces stigmatisés (les mellahs des anciennes médinas [4][4] Mellah vient du mot arabe mehl qui veut dire sel. Le...), pour se fondre progressivement dans les villes européennes où ils côtoient, dès lors, Français, Espagnols et Italiens, devenus leurs voisins. Dans ces mellahsdésertés par la classe supérieure de la population juive, la grande précarité urbaine, économique et sociale qui sévissait avant la colonisation s’est alors encore accrue, faisant d’eux des espaces en déshérence où populations pauvres et groupes marginalisés tentent de survivre.

Ce statut contradictoire et cette position « hybride » conduisent les Juifs d’Algérie à garder, au moins jusqu’au début du xxe siècle, une certaine ambivalence vis-à-vis de la « francisation », du fait notamment qu’une partie non négligeable d’entre eux reste encore très attachée à la culture judéo-arabe, ce qui les place de facto à l’intersection de différentes catégories d’analyse de la société coloniale : permis/interdit ; tradition/modernité ; privé/public, « indigène »/Français – lesquelles interagissent constamment et fortement avec les questions de genre, de classe, de « race » comme nous allons le voir maintenant.
À l’origine, une représentation problématique des femmes juives
Dès la création, par Eugène Delacroix en 1834, du tableau Femmes d’Alger dans leur appartement, les femmes juives envahissent l’imaginaire occidental. En Algérie, des représentations d’Orientales, parmi lesquelles de nombreuses Juives comme le montrent très bien Clémence Boulouque et Nicole S. Serfaty [5][5] Cf. Clémence Boulouque et Nicole S. Serfaty, Juives..., commencent à alimenter, à partir des années 1860, le déjà prolixe marché de l’orientalisme. Très inspirées de la peinture, les photographies de femmes produites entre 1860 et 1910 révèlent le plus souvent des « clichés » sur un univers féminin algérien – rural et urbain, sédentaire et nomade, public et privé, pauvre et riche – encore totalement clos et inconnu des Occidentaux [6][6] Cf. Christelle Taraud, Mauresques. Femmes orientales.... Cette production alimente en partie le fantasme récurrent du dévoilement, puis du dénudement progressif de ces femmes orientales, Juives autant que Musulmanes, que l’on retrouve continûment dans l’iconographie orientaliste, puis coloniale. Bien que très marquées esthétiquement et idéologiquement, les cartes postales massivement tirées de ces images à partir des années 1920-1930 montrent donc, à travers un voyeurisme largement à l’œuvre, une mise à disposition symbolique des femmes et une sexualisation de plus en plus palpable. En même temps, ces cartes postales sont aussi la trace tangible de l’existence d’individus de l’entre-deux, posant dans les salons des photographes occidentaux, inscrits dès 1830, par la colonisation, en femmes de la mixité (sexuelle, sociale, culturelle) et qui par là même ont brouillé les frontières de l’ordre colonial [7][7] Christelle Taraud, « Genre, classe et « race » en contexte.... C’est ce même monde de la prostitution cosmopolite que l’on retrouve, dans les années 1930, dans un film comme Pépé le Moko [8][8] Julien Duvivier, Pépé le Moko, 1936..
Dans ce contexte, on comprend bien pourquoi les femmes juives ont souvent éveillé des sentiments contradictoires chez les producteurs d’images. Parfois associées à un regard de piété comme les « madones juives » de Rudolf Lehnert et Ernst Landrock [9][9] Sur l’œuvre de Rudolf Lehnert (1878-1948) et Ernst..., ces dernières ont aussi souvent nourri une verve caustique et raciste liée, on s’en doute, à la présence d’un fort courant antisémite en Algérie, notamment depuis le décret Crémieux [10][10] Antisémitisme qui culmine, en Algérie, pendant la longue... : les « grosses juives » et quelques autres femmes incarnent assez bien les « horribles juives » dont il est question dans Les Fleurs du Mal, écrit ainsi Jean Michel Belorgey [11][11] Jean-Michel Belorgey, Leïla Sebbar et Christelle Taraud,.... Iconisées en madones par certains, les femmes juives sont aussi souvent réduites, comme les musulmanes avec qui elles sont ici symbiotiquement associées [12][12] « Proximité » qui dit l’histoire commune, notamment..., à une sexualité vénale, « bestiale » et « aberrante » qui apporterait la preuve évidente de « l’infériorité » de cette partie de la communauté qui, pour des raisons de proximité de classe et de « race » surtout, résiste encore à la totale assimilation au modèle français prônée par la grande majorité des élites juives comme par l’administration coloniale et métropolitaine [13][13] Sur cette question, voir notamment le très beau livre....
Prostituées juives : des femmes de l’entre-deux ?
À l’image de cette population « hybride » tiraillée à partir de 1870 entre le modèle « indigène » et le modèle français [14][14] Modèle qui pour les Juifs se traduit aussi bien en..., les prostituées juives résistent à toute lecture linéaire ou uniforme. Individus frontières [15][15] Christelle Taraud, « Jouer avec la marginalité : le..., ces dernières le sont certainement, et ce statut ambivalent en fait souvent une population inclassable, d’où la difficulté de travailler spécifiquement sur elle [16][16] Sur cette question voir Christelle Taraud, La Prostitution.... Les statistiques de la prostitution en Algérie, pourtant fort nombreuses depuis le milieu du xixe siècle, prennent en effet rarement en compte la donnée « prostituées juives » stricto sensu ; ces dernières, soit considérées comme « européennes », soit assimilées aux « indigènes », sont de ce fait regroupées arbitrairement par l’administration coloniale dans l’une ou l’autre de ces deux catégories. Peu de traces donc de ces femmes dans les archives du réglementarisme colonial, et ce, même si au hasard d’un document quelques informations peuvent surgir [17][17] Ainsi, en 1856, le docteur A. Bertherand, l’un des.... Informations trop lacunaires cependant pour en tirer un modèle global pour l’ensemble des femmes juives qui exercent une activité prostitutionnelle, officiellement (en maisons ou en isolées) ou ponctuellement (dans le vaste monde de la clandestinité).
Grossièrement, la situation générale qui se dégage en Algérie semble donc être celle d’une double prostitution juive, correspondant à des critères de « race » et de classe, située dans deux lieux spécifiques de l’échange sexuel, la ville européenne et le mellah « indigène » (et son corollaire, le bidonville déclassé). Dans la ville européenne, en effet, les maisons de tolérance européennes possèdent toutes leurs prostituées juives. Parlant le français et s’habillant à l’occidentale, ces dernières ont aussi été « laïcisées », ayant abandonné au passage une bonne partie des rituels juifs séfarades de leur communauté d’origine, et, de ce fait, ne se distinguant plus guère de leurs homologues européennes. Dans les mellahs, en revanche, les prostituées juives sont restées très proches de leurs consœurs musulmanes. Elles portent toujours le costume traditionnel composé d’un séroual bouffant ou d’un caleçon – auquel peuvent être adjointes des guêtres imposantes en tissu damassé –, d’une tunique large souvent assortie de glands frangés, de mules brodées et d’un chapeau conique très spécifique de l’appartenance confessionnelle. Parfois, la tenue peut aussi être agrémentée d’un gilet brodé (ghlila), d’une chemise à manches vaporeuses et d’une fouta, sorte de grande étoffe qui recouvre totalement la femme, de la taille aux genoux [18][18] À noter que le costume traditionnel tend à s’alléger....
Partageant un mode vestimentaire commun – lui-même symbole d’une culture à la proximité évidente entre « deux peuples unis dans la même musique, la même misère, le même langage [19][19] Germaine Aziz, Les Chambres closes, Paris, Nouveau... » – les prostituées juives sont insérées dans le même type de relations socio-économiques que les musulmanes. Soumises de manière exemplaire à une double domination – patriarcale dans leur milieu d’origine et coloniale dans la situation de domination instaurée après 1830 –, elles subissent de surcroît de plein fouet la « clochardisation [20][20] J’emprunte ce terme à Germaine Tillion. » accrue, dès la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle, des espaces « indigènes » – mellahs compris. Misérables, notamment parce que ces femmes ont fort peu accès au marché du travail salarié (en dehors du travail domestique très peu rémunérateur), seul gage d’une autonomie réelle, beaucoup d’entre elles sont donc contraintes à se prostituer, survie économique oblige. C’est ce que montre très bien Nine Moati pour la Tunisie coloniale quand elle écrit à propos de ses héroïnes vivant dans la hara (le quartier juif) de Tunis [21][21] À Tunis, le mellah portait le nom de hara qui signifie... :
[...] Avec cette intuition que donne l’enfance malheureuse, elles savaient ce qu’elles devaient à leur oncle. Il leur suffisait de voir leurs amies si jeunes, dont la plupart n’étaient pas encore nubiles, déambuler dans la rue Abdallah Guèche, la rue réservée. Elles étaient peintes comme des idoles. Le khôl qui soulignait leurs yeux apeurés donnait une dimension tragique à leur regard. Leurs mains barbouillées de henné appelaient le passant à la recherche de fraîche aventure. Leur clientèle ne se recrutait pas parmi les hommes fortunés de la ville. Non, c’était des cochers maltais, ou des commerçants arabes qui payaient en petites marchandises, au mieux des maçons italiens. Les mères apprêtaient elles-mêmes les fillettes pour la sinistre vente. Elles leur apprenaient le déhanchement qui plairait à tel client, l’œillade qui séduirait tel autre, et leur fournissaient le lourd parfum à la rose et l’ambre qui, mieux que toute recette, ferait venir les hésitants [...] [22][22] Nine Moati, Belles de Tunis, Paris, Le Seuil, 1983,....
C’est ce que montre aussi très bien Germaine Aziz dans son beau livre sur la prostitution quand elle évoque le destin des ses tantes – femmes sans hommes pour les protéger – qui doivent se prostituer pour survivre dans le mellah [23][23] Christelle Taraud, préface du livre de Germaine Aziz,....
Le cas exemplaire de Germaine Aziz

Dans Les Chambres closes, Germaine Aziz témoigne en effet de la vie et de l’expérience d’une prostituée juive ayant vécu en même temps le système de l’indigénat et celui du réglementarisme colonial. Insérée dans cette double domination masculine et coloniale, Germaine Aziz a expérimenté de surcroît, et c’est ce qui fait toute la force brute de son témoignage, tous les échelons du système prostitutionnel réglementé. Commençant sa « carrière prostitutionnelle » dans une maison d’abattage de Bône au début des années 1950, Le Chat Noir, elle va se retrouver, finalement, dans la plus grande tolérance d’Afrique du Nord, Le Sphinx d’Alger. Entre les deux, elle aura subi l’enfer de l’univers prostitutionnel colonial.

Achetée à Oran comme une vulgaire marchandise par une recruteuse européenne chargée de repérer les filles naïves ou en détresse économique et sociale, Madame Fernande, elle est revendue à la tenancière d’un bordel de Bône dont la clientèle est mixte, « indigène » et européenne. Cantonnée dans une chambre sans fenêtre éclairée par « une ampoule électrique souillée de chiures de mouches », Germaine Aziz, qui n’a que 17 ans, fait le dur apprentissage du dressage (pressions psychologiques, injures, coups, menaces de mutilation au couteau...) et des passes à la chaîne – « la file des hommes devant la porte, nue sous le peignoir, les laver... » –, répétées des dizaines et des dizaines de fois par jour. De sa virginité perdue avec un fonctionnaire français, client de la maison, elle ressort « souillée, irrécupérable », mais garde toujours la rage au cœur et l’espoir de fuir ce système qui réduit les femmes à n’être « qu’un ventre qui ne sert plus qu’au plaisir des hommes ». Réalité d’une criante vérité que le livre de Germaine Aziz dissèque avec une précision chirurgicale.
Grâce à elle, on ne pénètre pas seulement dans l’expérience, extraordinairement vivante malgré l’horreur, d’une femme bafouée, vendue, violentée et finalement quotidiennement partagée par une multitude d’hommes, mais dans un système – le réglementarisme colonial – dont on regarde, avec acuité, l’implacable mécanique. De la « mise en carte » des prostituées (l’enregistrement à la police des mœurs) à la visite sanitaire obligatoire – la fameuse « visite des organes » – on comprend l’ampleur et la violence de la coercition exercée sur les filles par les agents du contrôle (médecins, policiers, juges...), la force et l’irréductibilité de leur emprisonnement aussi par les lois du milieu, au travers des liens inextricables entre tenancières et proxénètes de maisons.
Le témoignage de Germaine Aziz met donc en évidence un système de régulation de la sexualité illicite qui repose essentiellement sur un enfermement systématique des prostituées – d’où le terme de « maisons closes » qui lui est généralement accolé – et sur un accord tacite entre tous les partenaires officiels et officieux pour faire de ces femmes des « esclaves » dociles. On ne s’étonne d’ailleurs pas, dans ce contexte, que le système réglementariste ait nommé les prostituées, « filles soumises ». « Tondues » comme des bêtes de somme, ces dernières sont le plus souvent exclues du commerce de l’argent. Ne possédant rien, même pas réellement leur liberté dans la plupart des cas, elles sont constamment endettées, notamment auprès des tenancières qui jouent de leur position de monopole (la sortie de la maison est généralement interdite ou conditionnée à la surveillance de la sous-maîtresse) pour leur vendre à des prix exorbitants les produits de consommation courante. Comme l’explique très bien Germaine Aziz,
J’ai été vendue comme une marchandise mais je n’en ai jamais su le prix. Je rembourse une somme que je ne connais pas, qui s’est augmentée, s’augmente chaque jour du montant de mes soutien-gorge, de mes slips, des serviettes, du couvre-lit qu’on change quand il est trop sale. Ma nourriture, l’eau que je bois sont comptabilisées. La seule chose que j’ai apprise, c’est le prix que payent les hommes qui viennent me voir, 60 centimes.
Récit d’une force inouïe, disséquant les rouages du système réglementariste, Les Chambres closes est aussi la caisse de résonance d’une époque et la matérialisation d’une situation particulière entre les hommes et les femmes mais aussi, dans le contexte si singulier de l’Algérie française, entre les « indigènes » et les Européens. De confession juive, Germaine Aziz [24][24] Née au milieu des années 1920 d’une mésalliance entre... explique d’ailleurs à plusieurs reprises dans le livre, son empathie avec les prostituées « musulmanes » et son sentiment d’appartenir à leur monde, dans l’espoir, la détresse, l’humiliation ou la révolte :
Pour les Français, juifs et arabes sont unis dans le même mépris : un élément pittoresque, sale mais coloré. Ils viennent nous visiter, nous faisons partie avec le village « nègre » et les souks des attractions, on y amène l’invité, l’ami de la métropole.
Considérés comme une construction de la France, le système réglementariste, ses maisons closes et ses quartiers réservés sont en effet abhorrés par les filles pauvres de confession juive et musulmane qui les assimilent, comme d’ailleurs souvent le reste des populations locales, à l’une des marques les plus insidieuses et les plus violentes de l’occupation française. Liant dans un même mouvement questions de genre, de classe et de « race », le parcours de Germaine Aziz traduit donc, de manière exemplaire, la situation contradictoire et « hybride » des prostituées juives en contexte colonial. Ainsi, quand elle termine sa « carrière » prostitutionnelle au Sphinx d’Alger à l’aube de l’indépendance, Germaine Aziz – devenue « européenne » par son nouveau statut, alors qu’elle était « indigène » au Chat noir de Bône – se voit interdire, par sa patronne, de dire à ses clients blancs qu’elle a couché avec des « Arabes ». On ne serait mieux résumer l’ambivalence de la position des Juives dans l’univers prostitutionnel algérien et, par extension, celle de l’ensemble d’une communauté, française dans le droit, mais encore trop souvent perçue et pensée, pendant toute la durée de la colonisation française [25][25] Ainsi, Germaine Aziz raconte dans son livre la manière..., comme « indigène » dans les faits et les mentalités.
Notes
Selon Pierre Darmon dans Un siècle de passions algériennes. Une histoire de l’Algérie coloniale, 1830-1940, Paris, Fayard, 2009, p. 545. La proportion des Juifs dans la population française totale en Algérie est donc de 13 %.
Le décret n? 136 du 24 octobre 1870, dit décret Crémieux, permet l’accession à la citoyenneté des 35 000 Juifs d’Algérie. Le texte précise en effet : « Les israélites indigènes des départements de l’Algérie sont déclarés citoyens français ; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu’à ce jour restant inviolables. Toute disposition législative, tout sénatus-consulte, décret, règlement ou ordonnances contraires, sont abolis ».
Les dhimmis sont les bénéficiaires de la dhimma, pacte au nom duquel les « gens du Livre » (Chrétiens et Juifs) sont tolérés dans la cité musulmane et « protégés » par le pouvoir central du makhzen, de l’État, dans le Dâr al Islam (le territoire où l’islam est religion majoritaire).
Mellah vient du mot arabe mehl qui veut dire sel. Le terme désigne donc d’abord l’impôt qui frappait les Juifs en Dâr al islam, puis, par extension, le quartier de la médina où le makhzen les avait autorisés à vivre. C’est par commodité que ce terme, utilisé dans l’Ouest algérien à l’instar du Maroc, est ici étendu à l’ensemble de l’Algérie (N.D.L.R.)
Cf. Clémence Boulouque et Nicole S. Serfaty, Juives d’Afrique du Nord. Cartes postales (1885-1930), Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu Autour, 2005.
Cf. Christelle Taraud, Mauresques. Femmes orientales dans la photographie coloniale, 1860-1910, Paris, Albin Michel, 2003.
Christelle Taraud, « Genre, classe et « race » en contexte colonial et post-colonial : une approche par la mixité sexuelle », dans Pascale Bonnemère et Irène Théry (dir), Ce que le genre fait aux personnes, Paris, Éditions de l’EHESS, coll. « Enquête », 2008, pp. 157-171.
Julien Duvivier, Pépé le Moko, 1936.
Sur l’œuvre de Rudolf Lehnert (1878-1948) et Ernst Landrock (1878-1966), voir par exemple Philippe Cardinal, L’Orient d’un photographe, Lausanne, Favre, 1987, et Charles-Henri Favrod, André Rouvinez, Lehnert & Landrock. Orient. 1904-1930, Paris, Marval, 1999.
Antisémitisme qui culmine, en Algérie, pendant la longue crise des années 1896–1902.
Jean-Michel Belorgey, Leïla Sebbar et Christelle Taraud, Femmes d’Afrique du Nord. Cartes postales (1885-1930), Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu Autour, 2006 [réédité en 2010].
« Proximité » qui dit l’histoire commune, notamment depuis la chute d’Al Andaluz en 1492 et le retour des megorashim (mot d’origine judéo-arabe qui désigne les Juifs d’Andalousie exilés au Maghreb au moment de la reconquête espagnole) vers le Maroc puis le reste de l’Afrique du Nord, et la participation évidente à une même culture urbaine.
Sur cette question, voir notamment le très beau livre de Joëlle Bahloul, La Maison de mémoire. Ethnologie d’une demeure judéo-arabe en Algérie (1937-1961), Paris, Métailié, 1992.
Modèle qui pour les Juifs se traduit aussi bien en métropole qu’en Algérie par leur acceptation de la dénomination d’« Israélites » – le modèle israélite, étant généralement considéré comme très localisé dans l’espace et dans le temps et lié au modèle d’intégration « à la française ».
Christelle Taraud, « Jouer avec la marginalité : le cas des filles soumises « indigènes » du quartier réservé de Casablanca dans les années 1920-1950 », dans Christine Bard et Christelle Taraud (dir.), “Prostituées”, Clio. Histoire, Femmes et Société n? 17, Toulouse, PUM, Printemps 2003, pp. 65-86.
Sur cette question voir Christelle Taraud, La Prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc, 1830-1962, Paris, Payot, 2003.
Ainsi, en 1856, le docteur A. Bertherand, l’un des grands médecins réglementaristes d’Alger, répartit les prostituées de la ville dans De la prostitution en Algérie, Paris, 1859, p. 545 comme suit : 189 Mauresques, Kabyles, Noires et Juives (souligné par l’auteur) ; et 256 Françaises, 3 Anglaises, 4 Suissesses, 4 Italiennes, 7 Allemandes et 45 Espagnoles.
À noter que le costume traditionnel tend à s’alléger à mesure de « l’occidentalisation » progressive des femmes juives des mellahs. Chez celles qui gardent encore une certaine proximité avec leur ancienne parure, on retrouve alors un seroual moins encombrant, des tuniques à manches bombées plus pratiques et de simples fichus pour recouvrir la tête.
Germaine Aziz, Les Chambres closes, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2007, p. 27 (1reédition : Stock/elles-mêmes, 1980).
J’emprunte ce terme à Germaine Tillion.
À Tunis, le mellah portait le nom de hara qui signifie simplement « quartier » en arabe. Selon Abdelhamid Larguèche, la hara de Tunis regroupait au milieu du xixe siècle 15 000 habitants dans un espace qui ne dépassait pas 5,5 ha. Ce qui dénotait un surpeuplement réel par rapport au reste de la médina qui s’étalait sur 100 ha, faubourgs compris. Presque 20 % de la population étaient alors concentrés sur 5 % de l’espace dans des conditions très difficiles, comme le précise l’Alliance israélite dans un rapport de 1878 : « L’hygiène faisait totalement défaut dans ce quartier qui était le plus immonde de tous... dans le local malpropre de l’école religieuse « Talmud Thora », sur environ 500 élèves qui fréquentaient l’établissement, on compte chaque jour 50 à 60 malades... ». Cf. Abdelhamid Larguèche, « Prostitution et ordre sanitaire à Tunis : le cas de la hara de Tunis aux xixe et xxe siècles », communication au colloque international de Hammamet, Médecines et politiques d’hygiène en Méditerranée, mai 1993.
Nine Moati, Belles de Tunis, Paris, Le Seuil, 1983, p. 44.
Christelle Taraud, préface du livre de Germaine Aziz, Les Chambres closes, op. cit.
Née au milieu des années 1920 d’une mésalliance entre un père – fil d’un rabbin connu et vénéré à Oran – et d’une mère couturière d’origine très modeste, elle-même fille d’un docker et d’une femme de ménage, la mère de Germaine Aziz, Julie, est enceinte d’elle quand son père, Jacob, demande le divorce pour épouser une femme plus riche, française de métropole. Divorcée et mère célibataire – elle a eu deux enfants, dont Germaine, avec Jacob – Julie n’a d’autre choix que de retourner dans le quartier juif d’Oran. Rapidement orpheline (sa mère meurt lorsqu’elle a à peine 10 ans), Germaine Aziz se retrouve chez sa grand-mère maternelle avec ses tantes Aïcha, Messaouda et Rosette dans un appartement de la rue du Mont Thabor, dans le mellah. Au travers de son récit, on voit émerger des profils de femmes seules, ses tantes qui se « débrouillent » comme elles peuvent, y compris en ayant recours à la prostitution occasionnelle.
Ainsi, Germaine Aziz raconte dans son livre la manière dont les Juifs français ont été traités pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle rappelle sa « honte » d’avoir été exclue de l’école française, parce qu’elle était juive.
par Christelle Taraud
Les commentaires récents